
À la une
Lutter contre les discriminations dans l’accès aux soins : les recommandations de la Défenseure des droits
- Discrimination
- Santé
06 mai 2025
Le Défenseur des droits vous aide à défendre vos droits et vos libertés
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante.
Le Défenseur des droits a été créé en 2011. Il est inscrit dans la Constitution française.
Le Défenseur des droits a 2 missions :
- Défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés
- Permettre l’égalité de tous

Vous avez un problème et vous avez besoin d'aide ?
Vous pensez que vos droits ne sont pas respectés ? Nos juristes et nos délégués vous accompagnent pour faire respecter vos droits.
-
Est-ce que le Défenseur des droits peut vous aider ?
Vous avez besoin d'aide mais ne savez pas dans quels cas nous contacter ?
-
Votre problème fait partie des missions du Défenseur des droits
Nous étudions gratuitement vos demandes
Que fait le Défenseur des droits ?
-
Défendre les droits des usagers des services publics
Lire la suiteDéfendre les droits des usagers des services publics
-
Défendre et promouvoir les droits de l'enfant
-
Orienter et protéger les lanceurs d'alerte
-
Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité
Lire la suiteLutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité
-
Contrôler le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité
Lire la suiteContrôler le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité

Vous pensez être victime de discrimination ?
Une discrimination est un traitement défavorable qui doit remplir deux conditions : être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…) ET relever d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…).
Par exemple quand on refuse la location d’un appartement à une personne en raison de sa couleur de peau, d'un handicap ou parce qu'elle est homosexuelle.
Consultez notre site Antidiscriminations.fr pour :
- Vous renseigner sur les discriminations
- Signaler si vous ou quelqu’un est victime de discrimination
- Échanger avec nos juristes, sur le site ou par téléphone au 3928
Ce numéro est gratuit et anonyme
Nous vous accompagnons près de chez vous
620 délégués du Défenseur des droits sont présents dans toute la France.
Ils représentent le Défenseur des droits près de chez vous.
Ils droits vous reçoivent gratuitement sur rendez-vous.
Ils vous écoutent, vous orientent ou vous accompagnent en cas de problème avec vos droits.

Dernières actualités

Les recommandations du Défenseur des droits pour lutter contre les discriminations dans la fonction publique
26 mars 2025
-

Retour sur le collège déontologie de la sécurité du 20 mars 2025
07 mai 2025
En savoir plus Retour sur le collège déontologie de la sécurité du 20 mars 2025
-
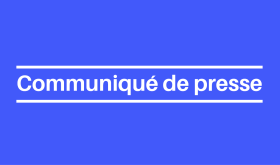
Lutter contre les discriminations dans l’accès aux soins : les recommandations de la Défenseure des droits
06 mai 2025
-

Amendes, évictions, contrôles : une étude sur la gestion des "indésirables" par la police
09 avril 2025
Espace documentaire
L’espace documentaire du Défenseur des droits regroupe toutes les décisions, avis et réformes, règlements amiables et autres publications que le Défenseur des droits rend publics.
À la fin de l’instruction de chaque réclamation dont il est saisi, le Défenseur des droits adopte une « décision ». Numérotées et datées, elles actent le règlement du litige à l’amiable, préconisent des sanctions ou formalisent des recommandations individuelles ou générales adressées aux mis en cause.
Les enseignements de ces situations individuelles nourrissent les avis du Défenseur des droits pour réclamer une meilleure application de la loi ou des changements législatifs ou règlementaires.
Le Défenseur des droits peut intervenir pour concourir à la résolution amiable des différends entre les parties ou des difficultés que rencontre la personne qui lui adresse une réclamation. Ces règlements amiables sont menés par les délégués territoriaux sur l’ensemble du territoire national et par les agents qui instruisent les réclamations au siège.
À partir des enseignements issues des réclamations individuelles qu'il instruit, le Défenseur des droits formule des recommandations pour réclamer une meilleure application de la loi ou des changements législatifs ou règlementaires.
Dans ses décisions, ses avis au Parlement et dans le contenu de ses rapports, le Défenseur des droits propose régulièrement des modifications et des évolutions du droit.
Toutes ces recommandations sont regroupées de façon thématique sur l'espace documentaire.
Le Défenseur des droits est référent national des conventions européennes et internationales et animateur de réseaux internationaux en matière de protection des droits fondamentaux.
Il échange régulièrement avec les institutions européennes, entretient un dialogue soutenu avec le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et la Commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, et coopère avec l’Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux.
La rubrique « international » de l'espace documentaire regroupe tous ces échanges.
Consulter la rubrique « international » de l'espace documentaire