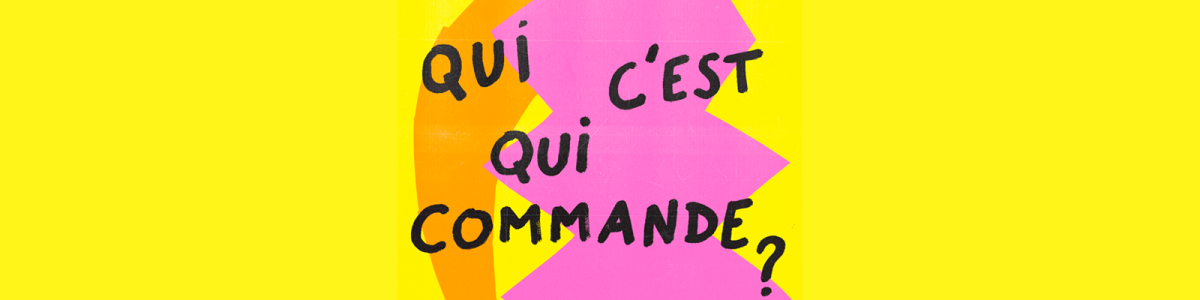
[PODCAST] "Qui c'est qui commande ?"
30 October 2025
Un podcast sur la place des enfants et leurs droits dans notre société. Lolita Rivé donne la parole aux jeunes (et aux moins jeunes) personnes, qui se battent pour leurs droits et imagine un monde plus juste, un monde qui les écoute.
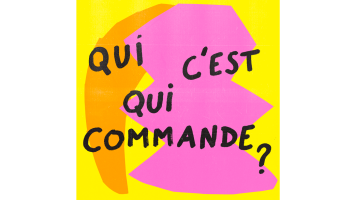
Insupportables, mal élevés, pourris gâtés… devenus des enfants-rois, les plus jeunes feraient la loi dans notre société. Pourtant, études et statistiques montrent qu'ils et elles continuent de subir de nombreuses violences. Alors, qui c'est qui commande ? Lolita Rivé, professeure des écoles, mène l'enquête sur la place des enfants et leurs droits dans notre société.
En France, les jeunes représentent 20% de la population. Ils et elles font partie de notre société et demain, ils et elles décideront de ce qu'elle deviendra. Dans les parcs, les classes, les maisons et les rues : quelle place leur laissons-nous ? Écoutons-les raconter ce que les adultes ont souvent oublié : ce que ça fait de grandir dans un monde de géants.
Avec un ton sensible et rigoureux, Lolita Rivé interroge des spécialistes, des enfants et des parents pour imaginer un monde qui respecte enfin les plus jeunes.
Ce projet a reçu le soutien du Défenseur des droits dans le cadre de ses missions de promotion des droits de l’enfant.
Retrouvez "Qui c'est qui commande ?" sur les plateformes d'écoute :
Épisode 1 : "Au pays des enfants-rois"
Tyranniques, incontrôlables, pourris gâtés, les "enfants rois" auraient pris le pouvoir sur les adultes. Pourtant, études et statistiques montrent qu’ils et elles subissent de nombreuses violences. Ils et elles auraient "tous les droits", mais leurs droits les plus fondamentaux sont souvent bafoués. Comment expliquer ce paradoxe?
Avec un récit intime, des témoignages du quotidien et des analyses de spécialistes, Lolita Rivé, professeure des écoles, nous invite à nous souvenir de nos enfances et à imaginer un monde qui respecte et écoute enfin les plus jeunes.
Qui C'est Qui Commande ? Episode 1
Voix d'enfant : Les adultes, ils ont le pouvoir de contrôler les enfants. Et bien, ils sont plus grand qu'eux, ils leur donnent des règles à faire. Range ta chambre. Fais ton lit. Range tes doudous. Ramasse tes jouets. Brosse-toi les dents. Va dans le bain. Déshabille-toi.
Voix d'adulte : L'enfant roi pire calamité de l'humanité.
Voix d'enfant : Je déteste quand on m'appelle Minus. Gamin. Petit enfant surtout, des fois ça me dit ça. J'ai l'impression que c'est comme s'ils m'insultaient. Il y a beaucoup de choses que les adultes peuvent faire et pas beaucoup de choses que les enfants peuvent faire.
Voix d'adulte : Ça donne des enfants qui, quand on les croise, sont abjects, tonitruants, malpolis, surtout tyranniques.
Voix d'enfant : Pourquoi c'est toujours les adultes qui commandent ? Bah moi ma mère elle me dit que je suis mal élevé, mais alors que c'est elle qui m'a éduqué.
Voix d'adulte : Je vois de plus en plus de petits nazillons dans les familles.
Voix d'enfant : Les enfants c'est aussi des êtres humains en fait, c'est pas des poupées qu'on peut faire n'importe quoi avec.
Voix d'adulte : Moi je les vois dans mon cabinet tous les jours, ils cassent mes plantes, ils cassent tous mes crayons en me regardant dans le blanc des yeux. Ils disent des gros mots.
Voix d'enfant : Je pense qu'on ne peut pas avoir moins de pouvoir parce qu'on n'a déjà vraiment vraiment pas beaucoup de pouvoir.
Voix off : Qui c'est qui commande, une série documentaire de Lolita Rivée sur les enfants et leurs droits. Episode 1, au pays des enfants-rois.
Lolita Rivé : On est le 12 mai 2025, et j'écris ces mots depuis les urgences de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Ébloui par les néons au plafond, je tape ces mots sur mon téléphone. Je ne peux pas parler parce que j'ai un masque à gaz sur la bouche. C'est lui qui fait ce bruit de Dark Vador là. Ça s'appelle un nébuliseur. Il est relié à une bouteille qui me balance des gaz pour dilater mes bronches. Voilà des mois que je fabrique ce documentaire sur les enfants et sur leur place dans la société. Je traverse la France pour enregistrer des profs, des juges, des chercheuses et des psy, et puis des dizaines d'enfants de tous les âges. Les paroles que j'écoute, tout ce que je comprends, ça me bouleverse. J'y repense la nuit dans ma chambre à Paris, tandis que l'air est saturé par le pollen et la pollution. Et voilà comment je me retrouve ici, à minuit. Je viens de faire la pire crise d'asthme de ma vie. La dernière fois que j'ai été hospitalisée, j'étais toute petite, j'avais deux ans. L'asthme, je suis née avec.
Le papa de Lolita Rivé : Mais t'étais courageuse, hein, parce que tu toussais pendant longtemps, longtemps, longtemps, tu pleurais pas, tu râlais pas, mais on voyait que t'était possédée par ta toux.
Lolita Rivé : Cette sensation d'étouffer, de ne pas avoir la place de faire entrer l'air. Ce sont mes premiers souvenirs.
Le papa de Lolita Rivé : Moi j'étais obligé de sortir parce que ça me rendait fou de te sentir souffrir comme ça.
Lolita Rivé : Cette nuit, allongée sur ce lit d'hôpital, trop haut, je comprends encore plus profondément ce qu'est l'enfance, dans ce qu'elle a de plus vulnérable, dépendante des soins des autres, faible, fragile, incapable de parler. D'ailleurs, enfant ça vient du latin infans, littéralement, qui ne parle pas. Et vous, vous vous souvenez ? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez tout petit dans ce monde de géants ? Moi, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, dans un pavillon en Seine-et-Marne, avec deux frères, des parents qui m'aiment, des jeux, de la liberté. Bon, deux, trois fessées et quelques cris aussi. Mais j'ai eu de la chance par rapport à d'autres. Je sais que certains d'entre vous ne revivraient leur enfance pour rien au monde. La mienne était plutôt normale.
Voix d'adultes : Tu verras quand tu seras grande. C'est pas toi qui commande.
Lolita Rivé : Pourtant, je me souviens que j'étais pressée de grandir. J'avais hâte qu'on me prenne au sérieux, que les grands arrêtent d'être condescendants avec moi.
Voix d'adultes : Tu peux pas faire gaffe ? T'es bête ou quoi ?
Lolita Rivé : Je détestais qu'on me demande des comptes tout le temps.
Voix d'adultes : Tu t'es brossé les dents ? T'as fait tes devoirs ? T'as dit merci ?
Lolita Rivé : Ça me gênait qu'on me touche sans me demander.
Voix d'adulte : Allez viens faire un bisou.
Lolita Rivé : Qu'on me fasse du chantage.
Voix d'adulte : Tu sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette.
Lolita Rivé : Qu'on ne m'écoute pas. Enfin qu'on me fasse sentir que je valais moins qu'une adulte. Ça vous rappelle quelque chose ? Qu'est-ce qui vous vexait, vous ? Vous faisait peur ? Vous révoltait ?
Voix d'adulte : Écris la date. Tu peux faire un arc-en-ciel bien sûr.
Lolita Rivé : Et en un éclair, c'est moi qui suis devenue l'adulte. Celle qui doit prendre soin des enfants, s'en occuper, les éduquer, les élever.
Voix d'adulte : T'es trop fort toi ! T'as tout réussi là, bravo !
Lolita Rivé : Les contraindre aussi.
Voix d'adulte : Allez, vous rangez tout ça, s'il vous plaît. Vous rangez, c'est à qui ce doudou, là ?
Lolita Rivé : Je suis journaliste et il y a 6 ans je suis devenue prof des écoles et puis mère d'une petite fille.
Voix d'adulte : Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ok, et toi ?
Lolita Rivé : Je sais ce que c'est que de s'occuper de 30 enfants de 5 ans pendant 8 heures. Être sollicité en permanence.
Voix d'enfant : Je peux aller faire pipi ? Il a dessiné ma carte. Moi il m'embête et il a envie de m'attaquer.
Lolita Rivé : Je sais aussi ce que c'est que de retrouver ma fille de 4 ans le soir après une journée éreintante et de ne pas avoir la patience.
Voix d'adulte : Je suis là, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te prépare à manger. Je peux pas être collée à toi.
Lolita Rivé : Il m'arrive de ne plus en pouvoir, de crier, d'avoir envie d'en emplafonner un, alors que je les aime énormément. Et c'est ce que vous diront la plupart des gens. Les enfants, c'est tellement mignon. Nos enfants, on les adore. On se plie en quatre pour eux. On serait prêts à mourir pour eux !
Voix d'enfant : Ha ha ha ha. Aïe, aïe. Ha ha. Ciao bye-bye !
Lolita Rivé : A tel point qu'aujourd'hui, beaucoup sont persuadés que les enfants ont pris le pouvoir.
Voix d'adulte : Il y a des tyrans de 2-3 ans incroyables. Pas le pot, pas la soupe, tais-toi, non, je me jette par terre, je me mets à gueuler comme un putois, tout le monde croit qu'on l'a battu, quoi, tu vois. On a envie d'ailleurs, hein.
Lolita Rivé : À la radio, à la télé, dans les médias.
Voix d'adulte : Ils flanquent des dictionnaires sur la tête de leurs parents, je vois bien sûr, je le vois très bien. Enfin cela dit, on voit les mêmes au parc et dans les aéroports et dans les gares.
Lolita Rivé : On entend régulièrement des spécialistes s'indigner, psychologues, pédopsychiatres.
Voix d'adulte : Donc des problèmes, moi que j'appelle, des problèmes d'intolérance aux frustrations, et qui selon moi viennent de carence éducative, pas de carence affective comme on nous a tout le temps lanciné.
Lolita Rivé : Didier Pleux, Caroline Goldman ou encore Marcel Rufo, ils et elles ont écrit des livres à succès intitulés « l'éducation bienveillante ça suffit », « de l'enfant roi à l'enfant tyran ». « Qui commande ici? File dans ta chambre ». Tous font le même constat. Depuis Françoise Dolto qui disait qu'il fallait prendre en compte les émotions des enfants et leur parler on est allés beaucoup trop loin. Peut-être que vous aussi, vous pensez que les enfants ne respectent plus rien. Qu'ils sont insupportables, mal élevés. Qu'il ont pris le pouvoir sur nous. Que c'était quand même mieux avant. Et vous ne seriez pas seuls. Trois quarts des Français estiment que les enfants d'aujourd'hui sont moins bien éduqués qu'à leur époque.
Voix d'adulte : Quand t'es pas sage, qu'est-ce qu'on te fait ?
Voix d'enfant : On me donne une fessée.
Voix d'adulte : Tu acceptes ça facilement ?
Voix d'enfant : Non, pas toujours.
Lolita Rivé : Pourtant, l'éducation à la dure est loin d'avoir disparu, contrairement à ce que prétendent ces psys. Les enfants sont peut-être choyés, mais ils sont aussi largement violentés.
Voix d'adulte : Et ça te fait mal ?
Voix d'enfant : Ça dépend quand on me tape fort ça fait mal, quand on ne me tape pas fort ça fait pas mal.
Voix d'adulte : Tu pleures ?
Voix d'enfant : Quelques fois.
Lolita Rivé : D'après le baromètre 2024 de la Fondation pour l'enfance, 81% des parents disent utiliser des VEO, des violences éducatives ordinaires, comme les cris, les privations, les humiliations, le chantage et les menaces. Ça peut aussi être des tapes, des fessées ou des gifles. La violence parentale, ce n'est pas un truc des années 60. On ne fouette plus les enfants avec des martinets, mais avec des câbles de chargeurs de téléphone. Il suffit d'ouvrir ses yeux et ses oreilles pour s'en rendre compte. Tous les jours, dans la rue, au parc ou dans le train, le métro ou à l'école, j'entends comme on leur parle aux enfants, comme on leur crie dessus. Je vois comme on les bouscule, comme on les tape même. Dans mes classes, la majorité des enfants sont concernés. Chaque année, quand je leur explique leurs droits, je leur pose la question. Qui n'a jamais été tapé par un adulte ? Et chaque année, systématiquement, sur 30 élèves, seuls 5 ou 6 lèvent la main. Alors bien sûr, entre une fessée, un jour de pétage de plombs et des tornioles toute la journée, il y a une différence. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, en tant que société, que les plus vulnérables d'entre nous soient giflés, fessés, empoignés, plaqués contre un mur, par ceux censés prendre soin d'eux ? Tous les 5 jours au moins, un enfant meurt tué par son parent. Et grâce au travail de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, on sait maintenant qu'en France, au moins un enfant sur dix est agressé sexuellement. Et quand ils en parlent, deux fois sur trois, les enfants ne sont pas crus. On ne fait rien pour eux. Bien sûr, tout le monde est horrifié par ces chiffres. En théorie, on trouve ça insupportable. Faire mal aux enfants, qu'elle ignominie, c'est inimaginable. Mais ça arrive tout le temps. Moi ça m'interroge, ce gouffre entre tous ces discours sur l'enfant-roi et ces chiffres effarants. Comment les enfants peuvent être à la fois les victimes et les bourreaux ? Comment peuvent-ils nous mener à la baguette et en même temps être les premiers à subir notre violence ?
Claire Hédon : Avancer toujours cette question de l'enfant roi est une façon de ne pas respecter les droits de l'enfant. C'est une façon se donner bonne conscience pour pas respecter les droits de l'enfant.
Lolita Rivé : Claire Hédon est Défenseure des droits. Le Défenseur des droits, c'est une institution publique et indépendante chargée de défendre les citoyens bafoués dans leurs droits.
Claire Hédon : On envisage le rapport à l'enfant comme un rapport de force et moi je n'envisage pas le rapport entre personnes en rapport de force mais même entre adultes. Je trouve qu'il faut sortir de ce rapport de force et donc c'est la même chose avec l'enfant.
Lolita Rivé : Le Défenseur des droits reçoit 140 000 réclamations de citoyens comme vous et moi chaque année. Sur tout un tas de sujets. Et chaque année, ils enquêtent sur des situations où les droits des enfants n'ont pas été respectés. Parce que oui, les enfants ont des droits. Inscrits depuis 1989 dans la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Ratifiée par tous les pays de l'ONU, sauf les Etats-Unis.
Claire Hédon : On ne considère pas les enfants comme sujets de droit. Ça, c'est un des premiers points qui est assez frappant. Et pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle rappelle quelque chose d'important, c'est que l'enfant devient détenteur de l'ensemble des droit de l'homme dès sa naissance. Et notamment le droit d'être protégé contre toute forme de violence. On a progressé dans la défense des droits des enfants. Il faut être réaliste. Mais on ne va pas du tout suffisamment loin. Et puis surtout, moi, qu'est-ce que j'observe ? Finalement, c'est un écart entre le droit annoncé, ce qui est dans nos lois, ce qui est dans la Constitution, ce qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant et la réalité de l'application pour les enfants.
Lolita Rivé : Cette convention, elle dit que les enfants ont le droit d'avoir une identité. De vivre en famille.
Voix d'enfant : En famille, d'être soigné, d'avoir accès à l'éducation et aux loisirs, à une vie privée, à une justice adaptée à leur âge, d'être protégé des violences et de l'exploitation, mais aussi d'être entendu sur les questions qui les concernent.
Lolita Rivé : Ça va bien au-delà de ne pas les frapper, en fait. D'après cette convention, toutes nos décisions devraient être guidées par un principe au-dessus de tous les autres. L'intérêt supérieur de l'enfant.
Claire Hédon : L'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas l'Enfant Roi, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même sujet, parce que c'est toujours le risque de dire mais ça veut dire qu'on fait ce que l'enfant veut. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas cette question-là. C'est de réfléchir, est-ce que là je fais quelque chose qui est vraiment dans l'intérêts de l'enfant ou ce qui m'arrange moi adulte parce que c'est plus pratique. Par exemple, les parents, ils peuvent se poser tout le temps cette question-là. Alors je sais que c'est pas facile d'être parent et qu'il faut pas culpabiliser les parents. Mais se poser régulièrement la question, est ce que je fais pas ça dans mon propre intérêt et pas forcément dans celui de mon enfant. C'est ça que ça veut dire sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
Voix d'adulte : Est-ce que vous avez déjà entendu parler des droits des enfants ? C'est quoi les droits des enfants?
Voix d'enfant : On a le droit de courir, d'aimer, on a le droit de faire des câlins, mais on n'a pas le droit de faire des bêtises ou faire de tout et n'importe quoi et casser des choses, mais par contre on a droit d'être délicat, d'avoir des copains, on a le droit d'aimer l'école.
Lolita Rivé : Les enfants ne me citent aucun de leurs droits de la convention internationale. On ne leur apprend pas à l'école ou quasiment pas, ni dans leur famille.
Voix d'enfant : On a le droit de s'embrasser en cachette.
Lolita Rivé : Et cette ignorance, elle est bien commode, parce qu'elle facilite tous les abus. Je n'ai jamais frappé ma fille, ni mes élèves d'ailleurs. Mais est-ce que ça suffit pour considérer que je les traite comme il faut? Que je respecte leur intérêt supérieur? Bien traiter les enfants, ce n'est pas seulement ne pas leur infliger le pire, c'est aussi leur offrir un cadre sécurisant, prendre en compte leurs besoins, ne pas chercher à étouffer leurs émotions si elles nous dérangent. Ça commence par écouter ce qu'ils ont à dire, même si ça ne nous arrange pas.
Voix d'enfant : Moi je pense qu'on nous écoute vraiment pas assez, parce que c'est toujours les adultes qui décident. C'est plutôt leur décision qui les importe et pas trop celle des enfants. Moi je trouve que les parents et les enfants ils sont différents mais en même temps les deux sont des humains donc les enfants aussi ils ont le droit d'être un peu plus pris au sérieux. Tu peux pas faire changer d'avis les adulte, après ils vont te dire c'est pas toi qui décide, on est plus grand que toi. Ok, en fait on peut rien faire sur ce sujet-là.
Claire Hédon : Le droit d'être écouté, d'être entendu, de participer aux décisions qui concernent les enfants, évidemment que c'est la clé pour respecter les autres droits. Écouter l'enfant, comprendre qu'est-ce que lui il souhaiterait, pourquoi, quelles sont ses difficultés, lui donner la parole, prendre en considération ce qu'il dit, ne pas être méprisant vis-à-vis de lui parce qu'il ne dira pas les choses de la même manière qu'un adulte ça ne veut pas dire suivre tout ce qu'il dit, mais ça veut dire qu'on a quand même entendu ce qu'il voulait et de temps en temps, ça peut éclairer la décision.
Lolita Rivé : Est-ce que, si on n'écoute pas les enfants en France, c'est parce qu'on considère qu'ils ne sont pas dignes d'être pris au sérieux? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'il sont incompétents, voire qu'il faut se méfier d'eux. Il y a un pays qui a peut-être une réponse à nous apporter. C'est la Suède. Si en France, un enfant meurt tous les 5 jours tué par un de ses parents, là-bas, c'est un enfant tous les 2 ans. Marion Cuerq est spécialiste des droits des enfants et de la culture suédoise.
Marion Cuerq : Le filtre de la méfiance, ça va être cette idée que l'adulte se sent souvent attaqué par l'enfant.
Lolita Rivé : Inspiré par le docteur en psychologie danois John Sommers, Marion Cuerq parle d'un filtre de la méfiance, à travers lequel on interprète les comportements des plus jeunes en France. Un filtre qui nous incite à réagir de manière autoritaire.
Marion Cuerq : On va attendre de l'enfant qu'il se soumette à nous, d'une façon ou d'un autre. Donc on va être dans cette méfiance où, quand un enfant va faire quelque chose, on va beaucoup plus avoir tendance à y voir une provocation, un défi de notre autorité. Et donc on va vouloir reprendre le contrôle puisqu'on s'imagine qu'on le perd. Je dirais qu'en Suède, c'est plutôt l'inverse. Et là, pour le coup, on est vraiment sur deux opposés. Il y a vraiment cette représentation de l'enfance libre. L'enfant qui questionne le pouvoir, l'enfant qui se laisse pas faire, l'enfant qui n'a pas sa langue dans sa poche, avec des figures très connues comme Fifi Brindacier, où c'est vraiment cette idée de l'enfant qui va un petit peu comme ça s'amuser avec le pouvoir des adultes. Les Suédois aiment beaucoup les enfants, surtout les jeunes enfants qui ont du répondant, où en France on va dire que c'est de l'insolence, en Suède on va dire que c'est des enfants justement qui n'ont pas leur langue dans leur poche et c'est quelque chose de très positif.
Chanson – Fifi Brindacier : Faut commencer l'aventure J'peux faire des bonds sur ma couette Réveiller Monsieur Dufond Ou bien porter d'une main en oncle Alfred J'peux danser en cadence Mettre de la magie sur terre
Lolita Rivé : Fifi Brindacier. Cette petite fille orpheline et libre. Tellement forte qu'elle soulève son cheval d'une main. Elle est aussi la plus gentille du monde.
Chanson – Fifi Brindacier : Que ferais-je aujourd'hui ? Que ferons-nous aujourd'hui ? Que ferai-je, aujourd'hui, où va ma vie ?
Lolita Rivé : Elle adore se moquer des adultes et de leurs règles. Astrid Lindgren a créé le personnage en 1941. Fifi est une icône nationale dans le pays. C'est ça leur regard sur l'enfant en Suède. En 1979, c'est le premier pays à interdire les châtiments corporels. 40 ans avant nous. Et pour rendre possible cette révolution éducative, ils ont adopté des politiques publiques concrètes. Les jeunes parents peuvent demander du soutien et des conseils gratuits à des professionnels. Et ils disposent aussi de congés parentaux de 480 jours rémunérés. Si le regard qu'on porte sur les enfants n'est pas le même partout, si on ne les traite pas de la même manière dans tous les pays, c'est bien que c'est une construction sociale, et donc qu'on peut faire mieux. Les jeunes de 0 à 17 ans représentent 15 millions de personnes en France. Ça fait 1 Français sur 5. Ils sont loin d'avoir tous la même vie. Certains grandissent dans le confort, d'autres dans le besoin. Rappelons que 2500 enfants dorment encore dans la rue en France, mais ils partagent tous et toutes le même statut, celui de mineur. Les enfants dépendent entièrement du bon vouloir des adultes. Ils ne peuvent quasiment rien choisir pour eux-mêmes. Ils ne décident pas de ce qu'ils font de leur journée, de ce qui ils mangent, de ce qu'ils apprennent à l'école. Ils ne peuvent pas se déplacer librement et encore moins voter. La place qu'on donne aux enfants dans notre société, c'est pas un sujet qui ne concerne que les parents ou les gens qui travaillent avec les enfants. On a tous et toutes été enfants. Et même si on n'en a pas soi-même, on en côtoie, on vit avec. Ils font partie de notre société. Et demain, ce sont eux qui décideront de ce que le monde va devenir. La façon dont on traite les enfants, c'est pas une question individuelle, de famille, de chacun fait comme il veut. C'est une affaire collective, exactement comme les droits des femmes. Pendant des siècles, on a privé les femmes de leurs droits pour leur bien. On leur interdisait de voter pour qu'elles n'aient pas trop de responsabilités sur les épaules. Elles ne pouvaient pas avoir de compte bancaire parce que ça aurait été trop compliqué pour elles de gérer de l'argent. Et on ne les laissait pas faire de sport parce qu'il ne fallait surtout pas abîmer leur corps. Aujourd'hui, ça nous semble impensable. Alors qu'est-ce qui, dans 20, 30 ou 50 ans, nous paraîtra aberrant d'avoir fait aux enfants pour leur bien ?
Voix d'adulte : Est-ce que vous savez pourquoi on est là tous ensemble ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?
Voix d'enfant : On va dire ce que ça fait d'être un enfant et ça on va l'enregistrer.
Lolita Rivé : Pendant un an, j'ai parcouru la France pour rencontrer des enfants et des grandes personnes qui nous aident à imaginer un monde plus juste. Dans ce podcast, vous entendrez des enfants qui racontent ce que nous adultes avons souvent oublié. Ce que ça fait de grandir dans un monde pas fait pour nous.
Voix d'enfant : Moi je dirais, vous pouvez vous rappeler de vous quand vous étiez enfant et après vous comprendrez mieux, peut-être.
Voix d'adulte : L'idée qu'il y aurait une crise de l'autorité, que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect envers leurs aînés, elle est extrêmement ancienne.
Lolita Rivé Vous entendrez des chercheurs, des chercheuses, des philosophes, des sociologues, des psy qui analysent le regard qu'on porte sur l'enfance.
Voix d'adulte : La femme était mise au même niveau que l'enfant, il n'y a pas si longtemps que ça. Les enfants en fait, on en est un peu au point zéro encore, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une catégorie sociale qui est complètement immature et incompétente dans sa capacité à prendre une place dans notre démocratie et dans les politiques qui les concernent.
Lolita Rivé : On cherchera des pistes pour réinventer nos liens, comme à Nantes, avec un groupe de parents qui ont accepté de me raconter leurs doutes.
Voix off : Oui j'ai envie d'être non-violent, ok, mais là il se passe ça, comment je fais face, comment j'agis. On n'apprend pas à pas être violent, et puis la société ne nous aide pas, on n'est pas aidés.
Lolita Rivé : Vous entendrez aussi d'anciens enfants placés.
Voix d'enfant : En quatre ans, je fais 10 placements. 10 placements. Ça renvoie quand même tout le temps au truc de bah t'es pas assez bien et en fait t'es tout le temps en train d'essayer de faire tes preuves.
Lolita Rivé : Et des juges pour mineurs délinquants.
Voix d'adulte : On entend qu'il faut réformer, créer des nouvelles procédures, aller encore plus vite, donc on est assez inquiets parce qu'on craint que sous prétexte de vitesse on aille dans la précipitation et qu'on renonce à tout ce qui fait l'intérêt de la justice des mineurs.
Lolita Rivé : On ira dans le Tarn, dans une école démocratique. Une école faite par et pour les enfants.
Voix d'enfant : Je pense qu'ici, on apprend beaucoup plus ce qui va en fait réellement nous servir dans la vie. Pas que les matières classiques mais plein de choses, le vivre ensemble, etc.
Lolita Rivé : On imaginera une ville à hauteur d'enfant, qui leur laisse de la place, comme à Lille.
Voix d'enfant : Je suis très content qu'il y ait la rue aux enfants et ce qui est incroyable c'est que c'est la rue qui est bloquée juste pour que nous on puisse jouer. Je trouve ça incroyable.
Lolita Rivé : On entendra des enfants et des adolescents qui s'engagent en politique.
Voix d'adulte : Les jeunes aujourd'hui, ils parlent énormément de réchauffement climatique et donc si le problème n'est pas pris en compte par les politiciens, par le gouvernement, etc. Du coup, nous on se dit, en fait, on s'en fiche de ce que nous on a à dire.
Lolita Rivé : Je vous emmène dans le futur, à la découverte d'un autre monde possible. Une société qui protège les enfants des violences, de la nôtre y compris, avec une justice adaptée à leur âge, une éducation qui les laisse s'émanciper, et des espaces publics qui les incluent et les rendent autonomes. Un monde qui les écoute, les fait participer aux décisions qui les concernent. Ça s'appelle « Qui c'est qui commande » et c'est un podcast sur les enfants et leurs droits. Dans le prochain épisode, on plonge au cœur du sujet. La domination des adultes sur les enfants.
Voix off : Écoutez l'épisode 2, « C'est pour ton bien ». Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.
Épisode 2 : "C’est pour ton bien"
« C’est pour ton bien » : vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, enfant, pour justifier des cris, des humiliations voire des coups infligés par les adultes.
Qu’est-ce qui, dans nos institutions et nos habitudes collectives, rend ces violences possibles ? Qu’est-ce qui fait qu’on n’arrive pas à respecter les droits des enfants ?
Avec des experts, Lolita Rivé explore la culture française des « violences éducatives ordinaires », leur histoire et leurs effets durables sur le corps, le psychisme et la confiance. Elle interroge aussi ce concept nouveau et éclairant : l’adultisme, la domination quotidienne des adultes sur les enfants.
Comment briser la chaîne des violences pour inventer d’autres façons de vivre ensemble, où les émotions des enfants sont entendues et leurs droits enfin respectés ?
Qui C'est Qui Commande ? Episode 2
Voix off : Attention, cet épisode évoque des scènes de violence.
Voix d’enfants : Moi j'aurais utilisé le coup physique, je l'ai appris de tout, je lui donne des baffes, je la frappe avec la ceinture et après voilà, ça va lui apprendre. Moi je suis d'accord parce que c'est bien qu'on frappe les gens parce que comme ça ils vont bien comprendre. Comme les parents eux ils frappent, donc Aaron nous comprend bien. Si elle t'écoute pas, faut un peu la crier dessus, tu peux être un peu nerveuse, comme ça elle comprend.
Lolita Rivé : J'ai demandé à des enfants ce qu'ils feraient à ma place, quand ma fille de 4 ans ne veut pas m'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'à 8 ou 9 ans, ils m'incitent aussi naturellement à être violente avec mon enfant ?
Voix d’enfant : Mon papa, il me donnait des fessées, mais je m'en souvenais. Et mon papi aussi, je m'en souviens toujours. Ça m'a fait beaucoup mal. Et à chaque fois que je pleure, je pense à ça. Ça m'a marqué. Moi, il y a des personnes qui me tapent avec la ceinture, avec les mains, ou parfois... Ou parfois, ils me tapent avec un balai.
Lolita Rivé : On a tous été enfants. Ce que vous entendez, je sais que beaucoup d'entre vous pourraient le raconter. Peut-être que vous vous dites que c'est pas grave, que vous aussi vous en avez reçu des coups, que vous en êtes pas morts. Peut-être que vous pensez que ces raclées, ces humiliations, vous les aviez bien méritées.
Voix d’homme : Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants.
Lolita Rivé : Peut-être même que vous pensez que ça vous a aidé à devenir ce que vous êtes.
Voix d’homme : Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter. Lors que finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus, au-dessus d'eux, l'autorité de rien et de personne. Alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie.
Lolita Rivé : Je suis convaincue que la plupart des parents veulent le bien de leurs enfants. Mais je pense qu'on est tous empêtrés dans ce paradoxe. Vouloir leur bien et leur faire du mal. Des gifles, des fessés, des tapes, des cris, des humiliations, c'est ce qu'on appelle des violences ordinaires. 81% des parents disent en utiliser sur leurs enfants. Quand ça arrive, c'est souvent qu' on est à bout, dépassé.
Voix de femme : Pareil, c'est toi l'adulte, tu ne devrais pas arriver à des états d'énervement, mais pour rien en plus quoi.
Lolita Rivé : Mais on frappe rarement son patron, le commerçant du coin ou sa mère quand ils nous exaspèrent. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte sur nos enfants? En signant la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989, la France s'est engagée à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence.
Voix d’homme : D'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle.
Lolita Rivé : Alors pourquoi continue-t-on d'infliger tant de violences aux plus vulnérables d'entre nous ? Qu'est-ce qui dans notre société, nos institutions, nos façons de fonctionner rendent possible ces violences ? Je suis Lolita Rivé, journaliste, mère de famille et prof des écoles et je cherche comment faire pour qu'on respecte enfin les droits des enfants.
Voix off : Qui c’est qui commande une série documentaire de Lolita Rivet sur les enfants et leurs droits. Épisode 2, c'est pour ton bien.
Lolita Rivé : Une grand-mère qui tire son petit-fils de 2 ans par le bras, en lui criant qu'il est insupportable et qu'elle va tout raconter à ses parents. Un père qui secoue sa fille de 6 ans, sanglotante, par les épaules, en lui hurlant dessus à 2 cm du visage. Une mère qui menace son fils de 11 ans de le gifler, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ses devoirs de maths. Un père, qui tire violemment sur la queue de cheval de sa fille adolescente, parce qu elle ne lui a pas obéi assez vite. Une mère, qui arme son bras et frappe son fils de 10 ans sur la tête, sans un mot. Pendant qu'il essaie de se protéger. J'ai assisté à toutes ces scènes dans la rue ou dans les transports. Alors imaginez ce qui arrive entre les quatre murs d'une maison.
Daniel Delanoë : Parmi toutes ces violences, il y en a qui sont extrêmes, en effet, qui relèvent de la maltraitance, mais d'autres comme une petite tape sur les mains qui paraissent complètement anodines, qu'on ne remarque même pas comme telles. Donc il y a toute une gamme, si vous voulez, de la petite tape au coup de ceinture, par exemple.
Voix off : Daniel Delanoë est psychiatre, anthropologue et membre de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, l'AOVO. En 2017, il publie les châtiments corporels de l´enfant.
Daniel Delanoë : Ces violences s'intègrent dans ce qu'on appelle la violence éducative. Donc, il y a ces violences physiques, mais aussi des violences psychologiques, des violentes émotionnelles qui sont beaucoup plus fréquentes, surtout actuellement. Les violences physiques semblent diminuer en intensité et en fréquence. Ce n'est pas forcément le cas pour les violences psychologiques. Une violence psychologique, c'est menacer un enfant. “Si vous continuez à vous disputer dans la voiture, On va s'arrêter, on va vous laisser. En bord de la route, on viendra vous chercher demain”. Ça peut être des humiliations, ça peut être des insultes, voilà. Ça, on est vraiment dans vraiment les interactions du quotidien. Et ces violences éducatives sont invisibles, sont tellement intégrées qu'on ne se rend pas compte.
Enfant : Mon père, il dit que je dis des conneries. Et des fois, il dit, “arrête”, il me crie dessus. Il me dit que moi je dis des merdes. Parfois, je continue à faire des bêtises comme ça, ils en auront marre de me taper, ils vont plus me taper quand je ferais des bêtises.
Voix de femme : Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un nous tape ? Qu'est-ce que t'as ressenti, toi ?
Enfants : De la tristesse, de la colère. En fait, de la peur. Oui, de la peur, plus de peur.
Lolita Rivé : Dans mes classes, je parle de leurs droits à mes élèves, et notamment celui de ne pas subir de violences dans leur famille. Et quand ils en parlent à leurs parents, ça ne passe pas toujours.
Voix d’enfants : Ta maîtresse elle ment. Je fais ce que je veux de mon enfant. Si tu n’es pas contente, la porte elle est là.
Daniel Delanoë : Beaucoup de parents sont convaincus que les violences sont nécessaires à l'éducation. Alors, les parents ont l'idée que s'ils ne punissent pas leur enfant, il va mal se développer, il va devenir un délinquant.
Voix off : Daniel Delanoë reçoit des parents depuis 30 ans dans son cabinet.
Daniel Delanoë : Un papa m'a dit, qu’il tapait violemment son fils. Il m'as dit, vous savez docteur, quand je vais dans la rue avec mon fils et qu'on voit passer un camion de police, lui dit... Tu vois, c'est pour ça que je te tape, parce que je ne veux pas te retrouver un jour au commissariat ou en prison. Donc, les gens sont persuadés qu'en tapant leur enfant, ils vont lui apprendre à être un bon citoyen et pas à être un délinquant. Les parents pensent le faire pour le bien de l'enfant. On se dit, il faut imposer des limites à l'enfant et donc il faut le frustrer, il faut le contrôler, sinon ça va devenir justement un enfant tyran, un enfant roi. Donc, il y a cette idée qui remonte à l'Antiquité que l'enfant est mauvais par essence est mauvais par nature. Et que si on ne le tape pas... Il va devenir la cause du malheur de ses parents. On trouve ça déjà dans la Bible. Il y a des versets dans la Bible qui disent tape ton enfant, fouette-le. Sinon, cet enfant sera ton malheur pour toi.
Voix off : Proverbe 22,15 de l'Ancien Testament. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts.
Daniel Delanoë : C'est parfois ce que dit la psychanalyse, par exemple, qui a beaucoup de qualités, qui a donné la parole à l'enfant. Ça a été aussi une découverte de l'enfant comme sujet. Mais pour Freud, c'est l'enfant est pervers polymorphe. Il faut le castrer symboliquement dit Dolto. Comme si l'évolution spontanée de l'enfant allait vers la construction d'un individu impulsif, manquant de respect, foncièrement égoïste.
Voix d’enfants : Annabella, mozzarella, pile ou face, caravanes, Osa, Osa.
Lolita Rivé : J'aimerais bien savoir ce que les enfants pensent de tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Pendant plusieurs semaines, je me suis rendue en banlieue parisienne au rugby olympique de Pantin, un club où les équipes sont mixtes. Tous les mercredis, avec 9 enfants, on s'assoit en cercle, je branche mon micro et ils me racontent comment ils vivent leur enfance. Ils ont entre 7 et 10 ans.
Enfants : Un jour, j'ai failli quitter vraiment la maison de chez Papy et Mamie tellement que j'étais énervé à cause d’Eva. Moi, je pars directement dans ma chambre. Je dis des gros mots, mais dans ma tête, dans ma tête, mais je dis pas devant les parents. Moi, j'dis à ma mère, ton crâne. Mais ça veut dire ta grosse tête. Dans ma tête, bien sûr ! Des fois quand ma mère m'énerve, je vais dans ma chambre, et des fois elle me dit je vais te donner une baffe, attention ! Et après moi, tellement je suis en colère, je dis, ah ouais tu vas me donner une baffe ? Eh bien je l'attends, vas-y mets-la mo i! Et moi je dis t'es plus ma mère, t'est plus mon père, par exemple, t’es plus mes parents quoi ! Et il y a une grosse chose que je dis beaucoup. Tellement que je suis énervé, je dis “Je vais me suicide”. Tellement que je suis énervé, je dis ça. C'est pas pour leur faire du mal, je le pense vraiment. Je pense que je devrais même pas être né, moi. Des fois, quand je suis tellement énervé, je pense que j'aurais même pas été né.
Daniel Delanoë : Il y a des études qu'on a portées sur les violences physiques et les violentes psychologiques. Et les études ont montré que la claque et la fessée en particulier ont des effets sur le psychisme de nos enfants. Ça augmente l'agressivité, ça augmente l'anxiété, la dépression, ça diminue les capacités de concentration de l'enfant. Un enfant qui ne se concentre pas à l'école, un enfant qui est agressif, il faut voir s'il subit pas des violences éducatives. Ça favorise l'échec scolaire. Ça favorise des maladies somatiques, ça favorise les maladies immunologiques, l'obésité, des troubles cardiovasculaires aussi. On a montré par des études de neuroimagerie cérébrale qu'il y a une altération des structures cérébrales qui permettent de contrôler l'impulsivité, qui sont responsables de l'empathie et du contrôle de soi.
Lolita Rivé : En 2015, le Conseil de l'Europe, organisme européen de défense des droits de l'homme, condamne symboliquement la France, parce qu'elle ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels sur les enfants. En 2019, une loi interdisant les violences éducatives est enfin votée, 40 ans après la Suède.
Présentatrice TV : Les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent pas user de violences physiques ou psychologiques à l'encontre de leurs enfants. La phrase sera bientôt ajoutée au Code civil. La proposition de loi contre les violences éducatives a été adoptée hier soir à l'Assemblée.
Lolita Rivé : Surnommé la loi anti-fessé, elle est très mal reçue.
Voix de femme : Qu'est-ce que ça recouvre ? Et le problème, c'est que ça recouvre des choses extrêmement larges. Et on confond tout. Et c'était une intrusion dans la vie des gens.
Journaliste : Vous dites que ça dépouille les parents de leurs prérogatives ?
Lolita Rivé : Pourtant, elle se résume en une phrase, intégrée à l'article 371-1 du Code civil
Voix d’homme : L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique.
Claire Hédon : Non, elle n'a pas été bien reçue au moment où elle a été votée. Avec toujours cette idée, finalement, du droit de correction. Mais qu'on retrouve encore aujourd'hui, cette question de droit de correction. Que des violences légères, c'est pas grave, que ça se justifierait pour des questions pédagogiques, pour éduquer l'enfant.
Voix off : Claire Hédon, Défenseure des droits.
Claire Hédon : Non, on n'a pas le droit de faire... Ce qu'on veut avec un enfant dans sa famille, non, c'est pas sa chose, c'est pas sa propriété, un enfant. Et c'est bien pour ça que l'État a un rôle de protection vis-à-vis des enfants.
Lolita Rivé : Malgré ça, en 6 ans, les pratiques parentales n'ont pas beaucoup changé. Et dans les médias, les discours qui prônent la violence sur les enfants résistent encore.
Robert Ménard : Il y a des gens qui sont intervenus pour dire qu'une fessée sur la couche d'un enfant, quand vous tapez comme ça, c'était inadmissible.
Voix off : Robert Ménard, 2024.
Robert Ménard : Que quand même on n'allait pas taper sur la main d'un enfant qui mettait les doigts dans la prise électrique.
François Bayrou : Ce n'était pas du tout une claque violente.
Voix off : François Bayrou, Premier ministre, 2025.
François Bayrou : C'était une tape en effet de père de famille, pour moi ça n'est pas de la violence.
Lolita Rivé : Aujourd'hui, la loi de 2019 reste une loi de papiers. Il est extrêmement rare que des parents soient condamnés par la justice pour des violences ordinaires sur leurs enfants. En avril 2024, la Cour d'appel de Metz a même relaxé un père de famille policier condamné en première instance pour des violences sur ses enfants. Des gifles, des fessés, des étranglements, plaquages contre le mur. Et ça, au nom du droit de correction. Les juges ont estimé que les violences avaient été proportionnées au manquement commis. Les enfants n'avaient pas bien rangé le linge, avaient eu des mauvaises notes à l'école et n'avait pas obéi assez vite à leur père. Des recours ont été déposés devant la cour de cassation.
Voix d’enfants : À cette époque, maintenant les parents n'ont plus le droit de taper les enfants, mais il y en a quelques-uns qui continuent. En tout cas, moi je dis que les parents, quand ils sont fâchés là, c'est trop là. Parce qu'ils nous frappent avec du chargeur, des ceintures, et nous ça nous fait mal. Ils pensent que ça ne fait pas mal. Nous, on n'est plus à l'époque, on a pas le droit à frapper les enfants. Et eux, ils disent que c'était pour notre bien. Est-ce que ça c'est normal ?
Voix de femme : Moi, la fatigue, je la gère très, très mal et ça génère beaucoup de cris. Ça m'est arrivé de pousser mes enfants. Forcément, c'est à ce moment-là qui est très bûche et qui s'ouvre la lèvre.
Lolita Rivé : Je suis allée à Nantes rencontrer des parents qui ont des jeunes enfants.
Parents : Ben moi c'est Lou. Je suis Julien. Maella. Houria. Et Charlotte.
Caroline Robineau : Bienvenue à toutes et tous. Du coup, on se voit aujourd'hui pour cet atelier qu'on a appelé « Comment accompagner ses enfants sans violence ». Moi, je suis Caroline Robineau, je suis consultante en parentalité et formatrice depuis sept ans.
Lolita Rivé : On est assis en cercle sur des chaises, on ne se connaît pas.
Caroline Robineau : À titre personnel, moi je crois que j'ai compris ce qu'était vraiment, enfin en tout cas ce qu était la violence éducative ordinaire. Il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, depuis que globalement que j’ai commencé à cheminer sur ma parentalité. Je crois qu'avant, ce n'était pas de la violence pour moi ce qui se passait avec mes enfants. Pourtant, je punissais, je mettais au coin, je criais très régulièrement. Il est arrivé, alors peut-être pas moi, mais peut-être mon mari, de faire une douche froide carrément à un de mes fils. Pour moi, la violence, c'était seulement la fessée et taper, quoi. Et en fait, quand j'ai compris que la violence c'est aussi dans ce que l'on pouvait observer, des rapports, par exemple, entre nos parents, assister à des disputes quotidiennes ou très régulières de nos parents. C'est, aussi, de la violence. Assister à, par exemple, mon père qui tape mon animal de compagnie, mon chien, très fort. C'était aussi de la violence que, moi, j'ai vécu. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit... Ah, mais en fait... J'ai vécu beaucoup de violence et j'en ai fait vivre à mes enfants.
Voix de femme : Moi je m'appelle Lou, j'ai deux enfants, je suis accessoirement autiste TDAH et mes enfants le sont probablement aussi donc ça rajoute un bon niveau de difficulté autant pour moi que pour eux. Il y a deux comportements que j'aimerais changer, c'est d'abord la violence parce que je crie facilement, je me fâche facilement et il y a des fois où il y'a des petites tapes sur la cuisse qu'ils peuvent partir.
Voix de femme : Ce qui est difficile dans la parentalité, c'est d'être dans l'accueil de mes enfants, de leurs émotions, des courbes comme ça. En même temps que moi, j'ai mes courbes avec une maladie chronique, donc pas toujours la capacité à accueillir. Et donc je finis par gueuler parce que je ne peux plus, mais j'essaye de verbaliser en disant, là, là maman, il n'y a plus, là. Maman, on n'existe plus, je ne veux plus entendre maman. Vous m’oubliez. Stop.
Voix de femme : Des fois, je m'énerve en deux secondes et demie, et je me dis, mais pourquoi tu te mets dans des étapes pareilles ? C'est toi, l'adulte, tu devrais pas arriver à des états d'énervement, mais pour rien, en plus, quoi. Et je crie, je cries souvent, ça, j'aimerais réussir à crier moins. Et puis, j'ai eu des moments aussi où, voilà, je l'attrape par le poignet, je l'attire parce que, bah là, faut y aller. Et ça, ouais, beaucoup de culpabilité après des gestes comme ça, et à me dire, mais il faut que j'arrive à faire mieux.
Voix de femme : On veut mettre les enfants dans des cases aussi et il faut que les enfants soient calmes, qu'ils écoutent, qu'ils respectent les règles, tout ça. Et finalement, on ne leur laisse pas la liberté de s'exprimer dans la société en général. Donc je pense que ça joue aussi sur le fait que nous, après, il y a toute la patience, tout le jugement autour de nous, on se dit qu'est-ce qu'on va dire de nous. Tout ça, ça rentre en compte aussi.
Maîtresse d’école : Allez on rentre voilà, on rentre, tout le monde rentre. On met pas les chaussures, j'ai pas dû mettre les chausseurs. Est-ce qu'il y a des enfants qui mettent leurs chaussures ? Non, on met pas des chaussures. Qu'est-ce que vous faites ? Eh, eh, eh stop, stop. Tu lâches ça ? Qui est dehors là ?
Lolita Rivé : Moi aussi, je crie parfois en classe, quand je me sens dépassée, impuissante, fatiguée. Il m'est aussi arrivé d'être violente physiquement, de saisir un enfant par le bras quand il ne m'écoute pas après dix répétitions.
Maîtresse d’école : C'est quoi, ça ? C'était des coupages, là ? Pas possible. C'étais n'importe quoi. C'était quoi, ce bazar ? Qui a découpé tous les coloriages ?
Lolita Rivé : Quand ça arrive, quand la colère éclate, je vois la peur sur leur visage. Un changement soudain dans leurs yeux. Et ce regard-là, il me fait immédiatement redescendre.
Maîtresse d’école : Non, non, non. Non, ça va dans le casier ça.
Lolita Rivé : Quand ça m'arrive, je m'excuse, je rassure l'enfant. Mais voilà le mal est fait. Je sais ce que mes éclats doivent à ma fatigue, mais aussi aux conditions anormales dans lesquelles on nous met. Les conditions matérielles dans lesquelles on s'occupe des enfants, favorisent la violence aujourd'hui.
Lolita Rivé : Si on était plus nombreux à s'occuper d'eux, si on travaillait moins, qu'on était reposé, moins stressé, si on avait plus d'espace et plus de temps, de relais aussi, je suis convaincue qu'on supporterait mieux la vitalité des enfants. Leur excitation et leur cri. Les enfants, c'est un peu la décharge publique de notre épuisement. La station d'épuration de nos frustrations, de nos échecs, de notre hommage. Avoir du pouvoir sur eux, ça nous donne l'illusion d'en avoir un peu plus sur nos vies qui nous échappent.
Maîtresse d’école : Est-ce que ça marche mieux quand je vous crie dessus ?
Enfants : Non !
Maîtresse d’école : C'est pas agréable quand quelqu'un crie dessus. En plus je vous dis de ne pas crier, donc si je crie...
Lolita Rivé : Pour autant, je pense que la fatigue et le stress ne sont pas les seules raisons qui font que je craque. La violence, elle survient aussi parce qu'elle est possible. Parce que je me l'autorise. Je pense que si on se permet de traiter les enfants comme ça, c'est aussi parce que l'on peut le faire. Parce qu'ils ne vont pas se défendre. Cette différence de traitement qu'on fait entre les adultes et les enfants, c'est ce qu' on appelle la domination adulte. Les sciences sociales se penchent dessus depuis peu en France. C'est le psychologue américain Jack Flasher qui, en 1978, a défini l'adultisme comme le pouvoir que les adultes ont sur les enfants, fondé sur la croyance en une infériorité naturelle des enfants. Pour comprendre, il suffit de faire le parallèle avec le sexisme. L'adultisme, c'est la considération que les « adultes » sont supérieurs aux enfants, comme le masculinisme considère que les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc être enfantiste c'est se battre pour que les enfants aient la même reconnaissance et les mêmes droits que les adultes. Et cette domination des adultes sur les enfants, ce n'est pas seulement les violences qu'on leur fait subir. C'est beaucoup plus large, c'est un continuum. C'est leur parler de manière peu respectueuse, se moquer de leur façon de s'exprimer, ne pas écouter leur avis, les toucher comme bon nous semble.
Marion Cuerq : Alors cette idée que la petite tape ou la petite fessée c'est absolument pas pareil que la torgnole ou la raclée, dans l'absolu c'est vrai, ça n'est pas pareil.
Voix off : Marion Cuerq, spécialiste des droits des enfants.
Marion Cuerq : Mais le problème c'est que les violences faites aux enfants c'est une pyramide. C'est à dire qu'en bas on va avoir le socle de la pyramide avec peut-être l'humour constant sur les enfants qui déprécient les enfants. Ensuite, on va avoir les comportements coercitifs du type... De ne pas se laisser marcher dessus, de les punir, de voilà. Ensuite on va augmenter, comme ça on va tomber sur les violences psychologiques. En gros, ça va faire crescendo, comme on va arriver aux violences physiques, les petites violences, les petites entre guillemets, puis après on va avoir les grosses violences physiques, puis après, on va voir les infanticides quoi. Donc de la même manière qu'en fait, on peut dire une main aux fesses, c'est pas un viol. Oui, mais le problème, c'est que si on se met à accepter les mains aux fesse, et qu'on dit, bon, une main au fesse... Le problème, c'est que les médias vont commencer à dire que les mains aux fesses, ce n'est rien. Si la main aux fesse n'est plus un sujet, les statistiques de viols vont exploser. Parce qu'on crée une tolérance, on ouvre une petite fenêtre et après c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Gabriel Allégret : Parler de continuum dans les violences faites aux enfants c'est une façon d'éviter de tomber dans l'opposition entre d'un côté des enfants violentés, maltraités et d'autre côté des enfants qui seraient épargnés.
Voix off : Gabriel Allégret est doctorant en sciences sociales à l'ENS de Lyon.
Gabriel Allégret : Du point de vue de la domination adulte, tous les enfants sont concernés dès leur naissance par ce système de domination et donc tous les enfants vont y être exposés et être exposés à certaines formes de violence mais à des degrés qui vont être très différents. Ce continuum, ça permet aussi de se remettre en question en tant qu'adulte et d'éviter de reproduire une distinction entre les bons adultes versus les mauvais adultes, les adultes qui sont violents et les adultes qui sont non-violents. Certains de ces adultes bien sûr vont avoir des comportements qui sont extrêmement graves, d'autres adultes vont péter un câble pendant 30 secondes puis ensuite se ressaisir… mais en fait, on est toutes et tous prises dedans. Et si on veut aller vers une société qui soit plus égalitaire dans les rapports entre adulte-enfant, c'est très important de réfléchir à comment est-ce qu'on se situe à la fois sur le continuum de ce qu'on a subi et comment est-ce qu’on se situe sur le continu de ce que l'on est en train de reproduire.
Enfant : Mais si les parents nous frappent, ce n'est pas leur faute parce que c'est leurs parents qui ont appris à frapper les enfants parce que les parents tapent leurs enfants et quand ils grandissent, ils nous tapent et pourtant les parents disent qu'on n'arrête de taper mais c'était eux qui nous montrent l’exemple.
Lolita Rivé : Les violences, c'est un cercle vicieux, une chaîne infernale. Certains enfants les reproduisent à leur tour, sur plus petits que, sur leurs camarades.
Enfants : T'as fait des belles lignes, tu vas aller au coin, ok ? C'est compris ? C'est pas bien, hein ? C'ES PAS BIEN, hein ! Sinon, je vais appeler les autres maîtresses et après, tu vas aller au bureau de la directrice !
Lolita Rivé : Et en grandissant sur leurs partenaires, voire sur leurs propres enfants. Essayons de nous rappeler de ce que nous avons subi enfant, des petites humiliations aux grandes violences. Et demandons-nous qu'est-ce qu'à notre tour nous faisons subir comme injustice aux enfants. On n'est pas là pour se flageller ou culpabiliser, mais pour prendre conscience du rôle qu'on joue chacun à sa façon dans ce grand théâtre de la domination adulte. Pour peut-être changer un peu de façon de faire, pour briser une chaîne pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous.
[musique] Voix de femme : Il disait qu'il m'aimait. Il disait que c'était pour pouvoir exprimer cet amour qu'ils me faisaient ce qu'il me faisait. Il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Il disait que s'il avait commencé à s'approcher de moi de cette manière, à me toucher, à me caresser, c'est parce qu'il avait besoin d'un contact plus étroit avec moi. Parce que je refusais de me montrer douce. Parce que ne lui disais pas que je lui aimais. Ensuite, il me punissait de mon indifférence à son égard par des actes sexuels. Il me promettait que, tant que j'en parlerai à personne, il ne ferait rien aux autres enfants.
Voix off : Neige Sinno, Triste Tigre
Lolita Rivé : Toutes les trois minutes en France, un enfant est agressé sexuellement. D'après les chiffres de la CIIVISE, la Commission indépendante sur les violences sexuelles et l'inceste, au moins un enfant sur dix est concerné. C'est-à-dire en moyenne deux à trois enfants par classe. C'est sûrement plus en réalité, parce que ces chiffres s'appuient sur les déclarations d'adultes qui s'en souviennent. On ne comptabilise pas ceux qui ont fait des amnésies traumatiques, ceux qui sont morts prématurément, les gens qui sont à la rue, pourtant surreprésentés dans les parcours de vie violents, ni même ceux qui n'osent pas en parler du tout. Et plus les enfants sont vulnérables, ou rendus vulnérable par exemple parce qu'on les place dans des institutions, plus ils sont attaqués. Ainsi, les enfants handicapés sont jusqu'à 5 fois plus exposés aux violences sexuelles que les enfants valides.
Simon Protar : En fait, les violences sexuelles subies par les enfants sont un phénomène beaucoup plus ordinaire, sinon banal, que les représentations qu'on peut en avoir.
Voix off : Simon Protar est doctorant en sciences politiques à l'ENS de Lyon. Il a travaillé sur les rapports sociaux d'âge, les violences sexuelles et la protection de l'enfance. Pour lui, la médiatisation des affaires de violences sexuelles s'est focalisée sur un seul type d'agresseur, empêchant une prise de conscience collective.
Simon Protar : Depuis les années 80, 90 particulièrement, il y a eu un travail médiatique qui a permis de construire une figure qui est celle du pédophile, le pédophile qui est généralement donc quelqu'un qui viole les enfants et potentiellement qui les tue, qui est souvent représenté comme un homme blanc d'une cinquantaine d'années, potentiellement qui a un imperméable, une camionnette. Or, cette figure-là, elle s'appuie sur un certain nombre d'affaires isolées, particulièrement spectaculaires. Mais qui ne traduisent pas du tout la réalité banale et ordinaire des violences sexuelles subies par les enfants, qui sont en fait majoritairement le fait d'hommes, de la parenté ou du cercle proche, pratiquement toujours d'homme qui sont connus des enfants.
Lolita Rivé : Dans 92% des cas, les enfants connaissent leur agresseur. C'est un père, un oncle, une tante, un cousin, un grand-père, ou encore un entraîneur, un prof, un voisin.
Simon Protar : Une des principales difficultés que pose cette focalisation sur la figure du pédophile, c'est qu'en construisant le danger comme quelque chose d'extérieur aux familles, on détourne collectivement le regard de ce qu'est la réalité des violences sexuelles subies par les enfants. Et donc on peut aller jusqu'à se poser la question, quelle est vraiment la fonction de ces figures médiatiques-là ? En tout cas, un des effets qu'on peut observer, c'est qu'elles permettent la perpétuation de violences sexuales sur les mineurs.
Lolita Rivé : Ne pas regarder le problème en face, ça nous empêche de lutter contre. On est tous horrifiés par ces chiffres, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Est-ce que l'on dit aux enfants que c’est interdit ? Est- ce qu'on les écoute quand ils nous racontent ? Une des clés pour informer les enfants et prévenir les violences, c’est de faire de l’EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est obligatoire depuis 2001 pour toutes les classes, dans toutes les écoles. Mais la loi est très peu appliquée, notamment parce que des mouvements réactionnaires s'y opposent farouchement.
Voix de femme : Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initiés à la pratique de l’annulingus. C'est surréaliste.
Lolita Rivé : Tout ceci est évidemment faux.
Simon Protar : Ces résistances, elles peuvent être expliquées en partie par le fait que la réalité statistique des violences est absolument incompatible avec l'idée de la famille telle qu'elle domine dans notre société, à savoir un espace de protection, d'épanouissement, d'amour. Accepter que la famille ait un cadre privilégié des violences, c'est une remise en cause qui serait potentiellement trop forte de ce socle idéologique qu'est la famille aujourd'hui. Si on envisage les choses vraiment sous le prisme de la domination adulte, on peut aussi dire que, en défendant la famille, les adultes défendent un mode d'organisation sociale dans lequel ils sont dominants. Et que donc, les remises en cause de la famille sont souvent des remises de pouvoir des parents.
Lolita Rivé : Dans Le berceau des dominations, une anthropologie de l'inceste, Dorothée Ducy présente les violences sexuelles comme l'expression la plus extrême de l'idée que le corps des enfants appartient à leur famille et aux adultes en général. Dans son rapport de 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles a estimé le coût des violences sexuelles sur les enfants à presque 10 milliards d'euros par an. Loin de s'en tenir à ce constat, la CIIVISE a émis 82 recommandations pour faire reculer les violentes sexuelles. Parmi elles, systématiser le repérage des violences chez les enfants dans les écoles et par les médecins. Former tous les professionnels de l'enfance au recueil de la parole de l´enfant et aux réactions à adopter pour les protéger. Créer des lieux de prise en charge et d'accueil des enfants victimes et de leurs familles, accompagner les agresseurs pour qu'ils n'agressent plus, lancer une grande campagne d'information sur les droits des enfants et aussi former les premiers concernés à réagir aux violences.
Voix de femme : Est-ce que vous savez pourquoi on est là, pourquoi vous êtes là ?
Enfant : Oui ! On va apprendre à s'autodéfendre.
Voix de femme : Et se défendre contre quoi ?
Enfant : Contre les personnes qui nous embêtent !
Lolita Rivé : Le collectif féministe CLAF’outils, créé en 2015, organise des ateliers d'information et d'autodéfense des enfants. Pour cette session à la Cité Fertile à Pantin, lors du festival enfantiste, une douzaine d'enfants de 5 à 10 ans sont venus participer.
Voix de femme : Donc là on est là pour prévenir les agressions, donc pour empêcher qu'on fasse du mal aux enfants. Qu'on vous fasse du mal. On va parler de quelque chose qui s'appelle subir une agression sexuelle. C'est quand quelqu'un vous touche votre sexe. Donc le sexe ça peut être la zézette, la vulve, ou le zizi, le pénis. Ou quand quelqu'un vous touche les fesses ou autour. La poitrine et la bouche.
Enfant : C'est que l’agression sexuelle, c'est quand une personne nous touche et qu'ils n'ont pas notre consentement.
Voix de femme : On peut avoir dit oui, mais que ce soit quand même une agression. C'est interdit, quel que soit ce qu'on a dit, ce qu’on n’a pas dit. C’est pas de notre faute.
Voix de femme : Là on va jouer cette scène donc ça va être Marjolaine qui va faire semblant d'être un enfant de votre classe qui s'appelle Sam et c'est Justine qui va jouer l'oncle de Sam. Un, deux, trois…
Lolita Rivé : Pour aborder les questions de harcèlement ou d'agressions sexuelles, les animatrices de CLAF’outils utilisent le théâtre forum, une technique d'éducation populaire. Elles jouent des scènes en faisant participer les enfants, puis modifient le scénario pour trouver des solutions ensemble.
Voix de femme : Dans cette scène, à votre avis, comment s'est senti Sam ?
Enfant : Son oncle, dans la scène, il lui a fait un bisou, sans lui demander. Et en plus, je crois que c'était sur la bouche. Il avait un peu de honte.
Voix de femme : Ouais, de honte !
Enfant : On dirait qu'il a été stressé. Il baissait un peu la tête. Il lui a dit qu'elle allait lui acheter une Nintendo switch. Ça, ça s'appelle du chantage et c'est pas du tout bien.
Enfant : Et en plus, à la fin, il lui dit ça, ça sera qu'entre nous deux. En vrai, c'était bien qu'il le dise à un adulte.
Voix de femme : Qu'est-ce que Sam pourrait faire pour essayer de garder ses besoins? Ses besoins d'être en sécurité, ses besoins d'être fort et ses besoins d'être libre.
Enfant : Essayer de se défendre en le tapant, en partant. Il peut tout simplement s'exprimer et dire non.
Voix de femme : Est-ce que vous pensez que c'est facile de dire non à un adulte ?
Enfant : Nooooon. Parfois, parfois. Parfois… Ca dépend.
Voix de femme : En tout cas, ce que nous, on veut vous dire, c'est que vous avez le droit de dire non, ok ?
Enfant : Ils pourraient dire à la tante ?
Voix de femme : Voilà, donc ils pourraient en parler à quelqu'un. Ça c'était une idée très importante, en parler un adulte. Ça veut dire que c'est à son oncle de se comporter bien.
Claire Hédon : Ce travail d'information sur les droits de l'enfant est absolument indispensable. Dans les enquêtes qu'on a pu mener, les enquête sur l'accès aux droits, une personne sur deux si elle est en situation de voir une atteinte au droit des enfants ne fait rien, ne fait aucun recours. Mais par contre, la personne en fait un peu plus si jamais elle est au courant des droits des enfants. Donc la question de l’information, de la formation aux droits, que ce soit les adultes ou les enfants, est indispensable si on veut que les droits de enfants soient protégés.
Voix off : Informer les jeunes et les enfants sur leurs droits, c'est aussi ce que font les jades. Les jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits. Ils sensibilisent près de 50 000 enfants chaque année.
Jeune ambassadrice des droits : En cas où s'il y a une photo qui circule de vous sur les réseaux sociaux ou d'autres, vous pouvez par exemple contacter le 38 et ils peuvent essayer de supprimer ces contenus-là des raisons d'interne à tout le coup. En 24 heures. Et vous devez aussi les propager si vous êtes victime ou témoin d'harcèlement ou de cyber harcèlement.
Voix off : Les jades se rendent dans des écoles, des foyers, des centres de loisirs ou des hôpitaux. À part une poignée d'associations, ce travail n'est pas collectivement pris en charge. Si bien que 62% des enfants ne connaissent pas l'existence de la Convention internationale des droits des enfants. Et parmi les enfants qui affirment la connaître, 2 sur 3 sont incapables d'en citer le contenu.
Jeune ambassadrice des droits : On le fait ensemble, à trois, un, deux, trois. “J'ai besoin d'être en sécurité, j'ai besoin d'être forte, j'ai besoin d'être libre.”
Lolita Rivé : Former les enfants, c'est indispensable, mais pas suffisant. Les parents que j'ai rencontrés à Nantes ont tous dit la même chose. Il faut aussi s'occuper des adultes, les aider, les écouter, les soutenir.
Voix d’adulte : Déjà, je trouve qu'on doit s'éduquer nous-mêmes parce qu'on n'apprend pas à ne pas être violent. Et puis la société ne nous aide pas, on n'est pas aidés. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, même avant d'être parent. Moi, j'aurais adoré avoir, en parallèle de mes cours de préparer l'accouchement, des cours de préparation à être parent, non violent.
Claire Hédon : Sur les questions de protection de l'enfance, si on veut avancer, il faut travailler sur la prévention. Et travailler sur la prévention, c'est prévoir un soutien à la parentalité. Et j'ai très envie de vous lire l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit, bon, “si élever un enfant, évidemment de la responsabilité première de ses parents, l'État doit accorder l'aide appropriée aux parents dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever leurs enfants.” C'est ça le soutien à la parentalité. Ce n'est rien d'autre. Et donc c'est bien un droit de l´enfant. On pourrait penser que c'était un droit pour les parents, mais non, c´est un droit POUR les enfants, d'avoir des parents qui sont accompagnés en cas de difficulté. Ça veut dire quoi ? Ça veut que il faut plus de moyens dans les PMI, qu'il faut aussi plus de moyens pour des travailleurs sociaux pour faire ce soutien à la parentalité, qu'il faut un soutien bienveillant. Et donc de la bienveillance entre adultes. De comprendre aussi les difficultés que les parents peuvent rencontrer, qu'ils aient des endroits où ils peuvent parler librement. S'ils se sentent jugés en permanence, ils ne vont pas venir dans ces endroits de soutien à la parentalité. Si le risque c'est que son enfant soit placé, ils ne viendront pas. C'est aussi toute la question, par exemple, de l'accès aux crèches. Il faut un accès beaucoup plus large à des systèmes de garde d'enfants, justement pour soulager les parents à certains moments. Et les réponses qui sont faites à des parents qui sont au chômage, à qui on dit « vous n'avez pas le droit à la crèche » ou « vous avez pas le droit à la cantine », on le voit assez régulièrement. Mais à quel moment on a pensé que c'était dans l'intérêt de l'enfant de faire ça ?
Voix d’enfant : [pleurs]
Lolita Rivé : Soutenir les parents, les professionnels et les enfants, ça passera aussi par un changement de rapport à nos émotions.
Laelia Benoit : Ce qu'on apprend aux enfants très tôt, c'est que leur comportement doit être ce qu' on attend d'eux et qu'en fait, peu importe leurs émotions. Qu'on n'a pas très envie de s'intéresser à leurs émotions.
Lolita Rivé : Pour Laelia Benoit, pédopsychiatre et chercheuse à l'Inserm et à Yale, aux Etats-Unis, on est tous et toutes des anciens enfants qui ont été brimés sur le plan de nos émotions. C'est pour ça qu'on a tant de mal à accueillir la colère et la frustration des enfants...
Laelia Benoit : Quand un enfant est puni, brimé pour ses émotions, ce qu'il apprend c'est que ses émotions sont dangereuses. Que s'il sent monter de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice, et que temporairement il est un peu dérégulé sur le plan de son comportement, tout ça c'est très grave. Et ce qu’il va apprendre à se dissocier sur le point émotionnel, c'est à dire à se couper de ses émotions. Quand il sent monter quelque chose, une émotion désagréable, il va s'en couper. Ce qui se passe avec nos émotions quand on les accueille, c'est qu'elles vont pouvoir monter comme une vague. Et ensuite elles vont redescendre, elles vont s'écouler et elles vont s'apaiser. Et donc c'est une vague, mais c'est pas jusqu'à l'infini. À un moment donné, on arrive en haut et puis on redescend doucement. La plupart des gens ont déjà fait l'expérience en pleurant parce que la tristesse est une émotion qui est quand même un petit peu acceptée. On sait que si on va pleurer, on s'isole pour pleurer. Qu'en fait, on va pleurer, pleurer, pleurer et puis après, ça va passer. On va se sentir fatigué mais soulagé et qu'on va aussi avoir des nouvelles pensées qui vont venir à ce moment-là à des choses avec peut-être plus d'espoir, avec d'autres perspectives etc. Puisque le corps a fait ce travail de digestion émotionnelle.
Lolita Rivé : Mais alors on fait quoi face à une crise d'enfant incontrôlable ?
Laelia Benoit : En fait ce qu'il faudrait faire c'est les co-réguler. La manière dont on apprend c'est qu'au lieu de dire tu vas dans ta chambre et t'es en time-out puni tout seul, c'est de dire... Je vois que tu as une émotion forte et que tu n'arrives pas à te contrôler. Ça ne veut pas dire je vais te laisser tout détruire dans la maison. Ça veut juste dire je vois que tu as des émotions très fortes que tu n’arrives pas à contrôler. On va aller ensemble dans ta chambre. On va s'isoler ensemble. Je reste avec toi dans la chambre, je m'assieds par terre et on reste ensemble jusqu'au moment où tu te sens mieux. Et d'ailleurs, je vais même te montrer que moi, pour me calmer, je prends des inspirations. Je respire, je souffle. Et voilà, et en fait on reste ensemble, ça c'est la co-régulation.
Voix d’adulte : Hummmmmmm Tch, tch, Tch Hummm. Ca va. Ah t'es crevé là !
Lolita Rivé : Ce que nous explique Laelia Benoit donne une réponse à un grand débat qui avait eu lieu sur le time-out. Cette technique prônée par certains psy qui revient à dire à un enfant qui fait une crise « Fille dans ta chambre, je veux pas voir ça, reviens quand tu seras calmé. » Envoyer son enfant dans sa chambre parce qu'on n'en peut plus n'est pas un drame. C'est même bien si ça évite des violences. Mais penser que c'est comme ça qu'on lui apprend à apprivoiser ses émotions est une erreur. C'est tout le contraire.
Laelia Benoit : Quand on montre la co-régulation à l'enfant, petit à petit, au fur et à mesure des années, il apprend l'autorégulation. En faisant ça, on montre à l'enfant qu'il n'a rien fait de mal, que son émotion débordante ne nous fait pas peur. Et ça, c'est très important que l'enfant sente dans le regard de l'adulte, que l'adulte n'ait pas peur de cette émotion. Et surtout, qu'on ne le punisse pas d'avoir été débordé de son émotions. On reste avec.
Voix d’adulte : Donc on va acheter les gâteaux au chocolat et après on va à la piscine. On fait comme ça ? Fais comme ça, chérie ?
Voix d’enfant : Oui. On fait comme ça.
Lolita Rivé : Allez, on récapitule. Qu'est-ce qu'il faut pour faire reculer les violences faites aux enfants ?
1. Changer notre regard sur l'enfant. Ne pas le voir comme un être qui agit contre nous, mais quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute et qu'on prenne en compte ses émotions.
2. Soutenir la parentalité, avec des cours pour devenir parent, mais aussi des moyens de garde accessibles pour tous.
3. Former correctement tout le personnel qui travaille avec les enfants et les payer dignement pour revaloriser ses métiers.
4. Systématiser le repérage des enfants qui vivent des violences et financer des parcours de soins et d'accompagnement.
5. Prendre en charge les agresseurs.
Et pour finir,
6. Organiser de grandes campagnes d'information sur les droits des enfants et les former à se défendre.
Lolita Rivé : Si vous avez besoin d'aide dans votre parentalité, vous pouvez appeler le numéro vert Allô parents en crise au 0805 382 300.
Voix off : Dans l'épisode 3, on parlera de justice, celle qui protège les enfants victimes et celle qui juge les enfants hauteurs de violence.
Gabriel Attal : Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salies, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Muriel Eglin : On ne peut pas construire une justice des mineurs sur quelques actes particulièrement graves. C'est oublier qu'un mineur est un être en construction.
Lolita Rivé : Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.
Épisode 3 : Les enfants peuvent-ils se défendre ?
Lorsque les enfants subissent des violences, que leurs droits ne sont pas respectés, que peuvent-ils faire ? Comment peuvent-ils se défendre face à leurs parents ou aux institutions censées les protéger ? Louise et Natacha racontent leur enfance placée, marquée par les fugues, les foyers, les familles d’accueil. À travers leurs voix et celles de la juge Muriel Eglin, de la sociologue Aude Kerivel, de la Défenseure des droits Claire Hédon, se dessine un système en crise, parfois protecteur, souvent maltraitant.
Lolita Rivé, professeure des écoles, mène l'enquête : pourquoi tant d’enfants sortent de l’Aide Sociale à l'Enfance (ASE) abîmés, précarisés, parfois happés par la rue, la prostitution ou la délinquance ? Et surtout : que faudrait-il changer pour que l’État tienne enfin sa promesse de respecter les droits des enfants, et donc de les protéger ?
Qui C'est Qui Commande ? Episode 3
Voix-off : Attention, cet épisode évoque des scènes de violence.
Lolita Rivé : Les enfants sont vulnérables, parce qu'ils dépendent entièrement des adultes qui prennent soin d'eux. Alors ceux qui subissent des violences dans leur famille sont les plus vulnérables d'entre eux. Ceux-là, comment peuvent-ils se défendre ?
Louise : Et puis là, quand je rentre, ma mère m'attend et puis là c'est physique, elle se met à me taper, je me défends. Je sais que si je ne quitte pas le logement maintenant, je vais me suicider. Je sais c'était la mort qui m'attend, je sais que mon mental est en train de lâcher. Je me dis j'ai 14 ans, je ne tiendrai pas jusqu'à 18. Je pars en courant, je suis là avec mes chaussures roses, puisque je suis une petite fille et je ne reviendrai que dix jours après. Alors dix jours, c'est rien, quand on en parle comme ça, mais dix jours dans la rue, c'est énorme. Quand je reviens de ces dix-jours, je ne suis plus la même personne. Je ne suis pas une enfant, je suis plus une petite fille. Ce que je ne savais pas, c´est qu'il y a un vrai signalement, vraiment comme les enfants portés disparus, qui avait été déclenché avec les affiches et tout le patafoin. Suite à ça, bah je suis auditionnée par la police et puis en fait, il me pose une question, il me dit est-ce que tu veux revenir chez ta mère ou pas ? Je ne sais pas à quoi correspond le ou pas, mais je dis non, instantanément. Je dis non. Et à partir de là, je suis placée en foyer d'urgence. Et puis voilà, c'était... Ça y est, la machine était enclenchée.
Lolita Rivé : Aujourd'hui, Louise est adulte. Elle nous raconte son histoire, terrible mais banale. Chaque année, comme elle, 400 000 enfants sont placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Hélas, il ne suffit pas de parler pour que les violences s'arrêtent. Une fois pris en charge, ces enfants sont-ils vraiment protégés ? En signant la Convention internationale des droits de l'Enfant, la France s'est engagée à prendre…
Voix d’homme : toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, de brutalité, d'abandon, de mauvais traitement par toute personne à qui il est confié.
Lolita Rivé : Quant aux enfants qui commettent des délits, vous allez en écouter dans cet épisode, l'État a aussi la responsabilité de les protéger. Parce que, délinquant ou non, un enfant est d'abord un enfant. Mais l'État est-il un bon parent ?
Voix-off : Qui C'est Qui Commande ? Une série documentaire de Lolita Rivé, sur les enfants et leurs droits. Troisième épisode, les enfants peuvent-ils se défendre ?
Lolita Rivé : L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, on l'appelait la DAS, jusqu'en 2010, ou encore l'assistance publique, si vous êtes nés avant 1960. La moitié des enfants qu'elle prend en charge le sont dans leur famille, avec l'intervention de travailleurs sociaux. L'autre moitié sont retirés à leur famille et placés dans des familles d'accueil ou des foyers.
Voix d’homme : Ces enfants sont aujourd'hui sauvés ou sur le point de l'air. Dans cette maison, ils vont en classe comme d'autres enfants. Il y en a des centaines de milliers qui sont en danger.
Lolita Rivé : La protection des enfants en danger, c'est une mission de l'État depuis l'ordonnance de 1945. Une mission qu'il a déléguée aux départements en 1983. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Dans l'idée c’est super, ça a permis de s'adapter au plus près aux réalités locales, aux besoins des enfants. Dans les faits, ça rendu la prise en charge des enfants très inégale. Si vous êtes un enfant pris en charge par l'ASE en Seine-Saint-Denis ou dans les Bouches-du-Rhône, vous ne serez pas protégé de la même manière, car le budget investi n'est pas le même. Or, les départements ont plusieurs missions cruciales. L'accueil en foyer d'urgence, le placement des enfants retirés à leur famille, l'intervention d'éducateurs dans les familles qui ont besoin d'aide, ou encore le contrôle des lieux qui hébergent des enfants placés.
Louise : Moi, petite, mon beau-père. Elle faisait des albums photos, des beaux souvenirs à la piscine.
Lolita Rivé : Après des violences physiques et psychologiques infligées par sa mère, Louise fugue à 14 ans et finit par être placée.
Louise : Je suis envoyée dans plein de familles d'accueil, donc je vais faire plein de familles d’accueil comme ça sur des très courtes périodes. J'atterris par exemple chez une famille d'acceuil qui était, je pense que c'était une personne qui était dépressive et c'est une personne qui ne se levait jamais. Elle restait allongée, elle ne me faisait pas manger. C'est quelqu'un qui était tout le temps dans son lit, en train de regarder la télé. On était plusieurs dans la famille d'accueil. Donc je me retrouve à cuisiner des coquillettes ou ce que je trouve dans les placards pour subvenir à mes propres besoins. Il y a une autre famille d’accueil où ça se passe très mal où en fait je suis mais morte de faim parce qu'en fait les portions qui me proposent ne suffisent pas à mon corps d'adolescente. Mais là les portions sont petites en fait. J'ai faim, j'ai vraiment faim. Et une nuit, je descends en cachette pour aller prendre une banane. Il y a un rapport qui a été fait en disant que j'avais volé dans la maison. Et cette putain de banane, on va me le faire payer cher puisque je suis exclue de cette famille d'accueil. En quatre ans, je fais 10 placements. 10 placements. J'ai constamment l'impression de devoir faire mes preuves, l'impression en fait qu'on ne m'entend pas, qu'on ne m'écoute pas, que... Que de toute manière je suis le mouvement et d'ailleurs en fait je suis complètement passive. On me dit d'aller là, je vais là, j'sais pas trop ce qui se passe.
Lolita Rivé : Régulièrement, Louise participe à des audiences avec le juge des enfants pour parler de son placement, de ce qui se passe bien ou mal, mais aussi d'un possible retour dans sa famille, comme le réclame sa mère.
Louise : Et puis c'est le cirque, mais vraiment ça ressemble à un cirque. Les gens s'insultent, enfin les gens, mes parents s'insultent eux, insultent les gens de l'ASE, insultent le juge des enfants, se hurlent dessus, mais vraiment des hurlements de bête, et ça se met debout, et ça claque les chaises, enfin... Je ne comprends pas ce qui est en train de se jouer, pourtant c'est de ma vie dont il s'agit. Et un jour... Je ne sais pas comment cette idée m'est venue, mais vraiment, par contre, je me trouve très intelligente, vraiment, je tiens à le dire. Je me trouve super intelligente. Je pense que j'ai dû voir dans une série qu'on pourrait, on pouvait avoir un avocat. On n'a jamais dit que j'avais le droit à une avocate, jamais. J'ai demandé à avoir un avocat, et enfin, je m'en souviens parce qu'en fait, le mec qui m'a reçu, il était éberlué, il se dit mais c'est quoi cette petite nana qui arrive et qui demande à avoir un avocat ? Et plusieurs semaines après, j'avais mon avocate. J'avais mon avocate qui était d'une douceur, d’une patience, d’une bienveillance incroyable, qui était à mon écoute, qui n'était que pour moi, qui était là pour me défendre moi et uniquement moi, et défendre mon point de vue, qui prenait le temps de m'écouter. Là, je n'avais plus besoin d'essayer de parler. J'avais quelqu'un qui portait ma voix. Et puis j'avais quelqu'un qui pouvait aussi m'expliquer ce qui se passait.
Muriel Églin : Les enfants ont droit à un avocat dans la procédure d'assistance éducative. Ce n'est pas une obligation de leur en désigner un, mais une loi de 2022 a permis une avancée parce qu'elle permet désormais au juge des enfants d'office de désigner un avocat pour un enfant, même s'il ne demande rien. Avant, il fallait qu'il y ait une demande soit de sa part, soit des parents.
Lolita Rivé : Murielle Églin est juge des enfants et présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.
Muriel Églin : Très régulièrement, on désigne un avocat pour qu'à la première audition avec le juge des enfants, il soit accompagné d'un avocat qui a pu s'entretenir avec eux avant, qui a pu les préparer à l'audition, les rassurer parce que c'est toujours inquiétant de venir en justice et les aider à formuler leur demande. On voit une vraie amélioration dans la capacité à prendre en compte les enfants comme une personne à part entière.
Lolita Rivé : Après plusieurs placements qui se passent mal, Louise trouve une famille dans laquelle elle se sent bien. Mais après quelques mois et sans explications, la famille décide de ne pas la garder.
Louise : Est-ce que j'ai fait quelque chose peut-être que je n'aurais pas dû faire, mais je ne sais pas quoi. J'avais vraiment l'impression que ça se passait bien, mais elle ne me garde pas. Et c'est violent. C'est hyper violent parce qu'en fait, ça renvoie quand même tout le temps au truc de bah te n’es pas assez bien et en fait t'es tout le temps en train d'essayer de faire tes preuves. On se sent de toute manière aimé et accepté de personne. On est seul. Parce qu'une équipe éducative, ça ne remplacera jamais une famille.
Lolita Rivé : Ca va ? T'as bien dormi Zuzo ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Quand je prends ma fille dans mes bras le matin, encore toute chaude de sommeil, et que je la caline, je me dis que tous les enfants devraient avoir droit à ça. Des raisons administratives ou budgétaires, un manque de famille d'accueil ou de place en foyer, font que beaucoup de ces enfants sont privés d'amour et de tendresse.
Aude Kerivel : Je pense que... ce sujet de l'amour, mais aussi du temps, du quotidien auprès de l´enfant, du temps où on est là, où on est disponible, de la disponibilité fait partie de ce dont les enfants ont le plus besoin.
Lolita Rivé : Après une enquête de 15 ans à l'aide sociale à l'enfance, la sociologue Aude Kerivel a publié « Protéger l'enfance. Tenir notre promesse aux enfants ».
Aude Kerivel : Être là, jouer à un jeu, aller se promener, écouter, faire un câlin, faire la cuisine avec l'enfant, toutes ces choses qui sont fondamentales, eh bien elles ne sont pas reconnues. Mais ça dit aussi beaucoup de choses sur les hiérarchies dans la société, c'est-à-dire que ces métiers-là ont été dévalorisés, il y a eu à un moment une grande réforme où on a mis des corps intermédiaires qui étaient les éducateurs référents Et donc, on a dévalorisé les personnes qui étaient au quotidien avec les enfants, où on a mis plutôt des personnes moins formées. Il y a eu cette idée que les professionnels doivent avoir une distance vis-à-vis de l'enfant, la bonne distance professionnelle, et donc ne pas trop s'attacher. Sauf qu'en fait, c'est ce dont les enfants ont besoin. C'est de l'amour et de l´attachement des adultes qui s'occupent d'eux au quotidien. Et ça, c´est quelque chose qui fait souffrir les enfants. Mais qui fait aussi beaucoup souffrir les professionnels au quotidien parce qu'ils sont dans cette injonction complètement infaisable.
Lolita Rivé : En tant qu'enseignante, j'informe mes élèves de l'existence du 119, le numéro d'urgence pour les enfants qui subissent des violences ou en sont témoins. Mais je suis toujours mal à l'aise, parce que pour l'avoir appelé plusieurs fois ce numéro lorsque je voyais des enfants maltraités dans la rue, je sais qu'il est rare d'avoir quelqu'un au bout du fil. En 2022, le 119 a reçu 390 000 appels. Seulement 26 000 ont été transférés à un écoutant professionnel. Ça veut dire que 94% des appels n'ont pas abouti.
Marguerite Aurenche : Ce que l'on constate à la lecture de ces procédures, et notamment lorsque l'enfant dépose plainte pour des faits de violences sexuelles, ce sont des enquêtes dans lesquelles il y a parfois très peu de diligence accomplie.
Lolita Rivé : Marguerite Aurenche est cheffe du Pôle défense des droits de l'enfant au Défenseur des droits.
Marguerite Aurenche : En réalité, il y a certainement un manque de moyens aussi chez les forces de l'ordre. On voit par exemple que parfois l'entourage de l´enfant n'est pas questionné. On n'entend pas non plus les voisins ou que les professionnels qui sont au contact tous les jours de l'enfant ne sont pas non-plus entendus dans le cadre de cette enquête. On voit aussi des délais d'enquête très importants. Dans une affaire, on a pu constater par exemple un délai de 17 mois entre le moment où l'enfant va être entendu, va déposer plainte et le moment où le mis en cause est entendu. Pendant ce temps-là, l'enfant lui, il continue à vivre dans le même environnement que celui dans lequel il a dénoncé des faits pourtant très graves.
Lolita Rivé : Le rapport 2023 de la CIIVISE a révélé que seulement 8% des enfants victimes de violences sexuelles qui révèlent les faits sont crus et protégés. 30% des enfant ne sont pas crus du tout. Et c'est encore pire s'ils sont porteurs de handicap : c'est 60% des enfants qu'on ne croit pas. La protection de l'enfance subit le même sort que la plupart des services publics. Les métiers du social ont été dévalorisés. Leurs travailleurs sont moins bien formés et moins bien payés. Les décisions sont prises par des cadres dans leur bureau sans les acteurs de terrain.
Aude Kerivel : Aujourd'hui, c'est un secteur qui va extrêmement mal. Dans certains départements, dans certaines associations, il y a presque la moitié des postes qui sont vacants. On n'arrive pas à recruter des professionnels diplômés. Dans certains services de la protection de l'enfance, dans certaines maisons d'enfants à caractère social, on va prendre des intérimaires. Les enfants nous disent, un avocat, il a un diplôme pour devenir avocat. Un médecin, il a un diplôme. Pourquoi un éducateur qui s'occupe de nous alors qu'on a beaucoup de difficultés, pourquoi il n'a pas de diplôme ? Un intérimaire, ça veut dire qu'un enfant de 3 ans ou de 4 ans ou 8 ans, tous les matins, il va être réveillé par un professionnel différent. On parle de protection de l'enfance. Protéger l'enfance, la base, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la permanence des personnes. Et aujourd'hui, les enfants ne sont même plus en capacité de citer le nombre d'éducateurs qu'ils ont eu.
Voix de femme : C'était une enfant. Elle avait 15 ans, elle s'appelait Lili. La semaine dernière, elle s'est donnée la mort dans sa chambre d'hôtel où elle a été placée par l'aide sociale à l'enfance.
Voix de femme : Elle s'appelait Hayden, elle avait 7 ans et elle est morte dans des conditions d'une violence inouïe, en état de dénutrition très avancé, le corps couvert de coups et une partie de son oreille manquante. Je suis désolée de parler crûment mais c'est la situation de cette petite fille.
Lolita Rivé : Ces dernières années, une série de drames ont mis en lumière l'asphyxie du système de protection de l'enfance. En octobre 2024, à Châteauroux, s'ouvre un procès hors norme.
Voix de journaliste : Violences physiques, sexuelles, humiliation, travail forcé, des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance du Nord, anciennement appelés la DASS, qui vont être envoyés dans des familles d'accueil sans aucun agrément.
Lolita Rivé : Une soixantaine d'enfants du nord de la France ont été placés par leur département dans des familles de l'Indre sans aucun contrôle. Ces familles maltraitantes ont reçu près de 630 000 euros en échange de l’accueil de ces enfants, entre 2010 et 2017. En décembre 2024, des peines de 10 mois à 6 ans de prison ferme ont été prononcées à l'encontre des principaux coupables. Un scandale qui a bizarrement épargné le département du Nord, pourtant responsable de ces enfants. Mais le non-contrôle de ces lieux de placement ne semble pas être une exception. 68% des familles d'accueil de l’ASE déclarent n'avoir jamais été contrôlées. En mars 2024, des travailleurs sociaux signent une tribune dans le journal Le Monde pour alerter sur leur détresse, sur leur salaire qui frôle le SMIC et sur les 10% de postes vacants. En mai, une commission parlementaire enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance.
Voix d’homme : Ensuite, on a été placés en famille d'accueil. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que les deux familles d'accueil étaient à 600 mètres l'une de l'autre et que de mes 3 ans jusqu'à mes 11 ans, on n'a jamais eu le droit de se voir.
Lolita Rivé : D'anciens enfants placés, des travailleurs sociaux ou encore des juges sont entendus.
Voix de femme : Si j'aurais su qu'il allait se passer ça, peut-être que j'aurais même pas été dit qu'est-ce qui se passait chez moi.
Voix de femme : J'ai grandi en ayant eu l'impression d'être un monstre, l'impression que je ne méritais pas d'être au monde et de vivre. Mon placement à l'ASE m'a appris à me détester
Voix de femme : 240 mineurs qui relèvent des maisons Solidarité Roubaix-Tourcoing qui ne bénéficient d'aucun suivi par un référent de la social alliance. Aucun, 240 enfants qui ne sont pas suivis.
Lolita Rivé : Après un an d'enquête et d'audition à l'Assemblée nationale, le rapport Santiago conclut que l'aide sociale à l'enfance est traversée par une crise profonde de son écosystème, qui hier était à bout de souffle et aujourd'hui dans le gouffre. Le rapport dénonce même des violences institutionnelles. Les enfants subissent un continuum de violence depuis celle du foyer familial jusqu'à celle qui interviennent trop souvent dans le cadre du placement. Ce n'est plus seulement un lot de faits divers. C'est la conclusion d'un rapport, écrit noir sur blanc. Mais ce rapport ne parle que des enfants à qui on a trouvé une place.
Murielle Églin : L'un des pires dysfonctionnements de la justice des mineurs, c'est l'inexécution des décisions courant.
Lolita Rivé : Muriel Églin, juge des enfants et présidente du tribunal pour enfants de Bobigny est la première témoin de ce scandale.
Muriel Églin : On peut imaginer dans un monde idéal qu'un juge rend une décision, elle est exécutée tout de suite. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, quand on prononce une mesure éducative pour un enfant qui est en danger dans sa famille et pour lesquels il y a besoin d'une action éducative auprès des parents pour les aider à prendre en charge leurs enfants correctement, pour écouter les enfants qui sont dans la détresse, eh bien la mesure éducative se mettra en œuvre entre 18 mois et 2 ans après la décision du juge des enfants
Lolita Rivé : En 2024, 77% des juges des enfants disent avoir déjà renoncé à prendre des décisions de placement car ils savent qu'il n'y a pas d'endroit pour accueillir ces enfants. Selon le Défenseur des droits, il y aurait des milliers et des milliers d'enfants en danger qui attendent toujours que leur placement soit exécuté. On parle d'enfants victimes d'inceste, de coups, de négligences graves qui en attendant, restent dans leur famille.
Murielle Églin : Quand une mesure éducative ou une mesure de protection qui a été prise parce qu'il y a de bonnes raisons. C'est pas dans le doute, c'est parce qu’il y a des bonnes raisons qui ont été repérées. Quand la mesure éducative n'est pas mise en œuvre, non seulement la situation s'aggrave, mais en plus la confiance que l'enfant pouvait avoir dans les adultes, ses parents, le jeu des enfants, les éducateurs et dans les institutions, eh bien elle est atteinte puisque les adultes qui ont le pouvoir rendent des décisions, font des promesses qui ne sont pas tenues. Les violences intra-familiales, les maltraitances, on sait que leur impact est d'autant plus fort qu'elles durent longtemps. Et quand on fait attendre les enfants alors qu’on sait qu'ils sont en danger et qu'on leur a promis d'intervenir, ce coup se creuse et les enfants perdent une chance d'aller bien quand ils sont adultes.
Voix de femme : Je viens de l'incendie, et il coule encore dans mes veines. Comme si j'abritais un volcan, sa lave à brûler tous mes rêves. Mon enfance, jetée dans les flammes, calcinée, en cendre. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. Je viens de l’incendie. Regarde les brûlures de mon âme. Marquée au fer rouge comment faire. Ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Me bouffent jour et nuit. Comment soigner l'inguérissable ? Kenny Arkana, je viens de l'incendie.
Lolita Rivé : Parmi les 400 000 enfants pris en charge par l'ASE, environ 70 000 sont placés dans des foyers. Louise en fréquente à 6 en tout. Si elle dit que le placement l'a sauvé, elle raconte aussi une vie en foyer souvent violente, à cause d'éducateurs maltraitants, mais pas seulement.
Louise : Et donc là, on met plusieurs dizaines de jeunes extrêmement abîmés en un même endroit. Ça ne peut que mal se passer en fait. Les bastons qu'il peut y avoir, c'est les nanas qui se jettent du haut de l'escalier, c'est de l’eau chaude renversée sur une autre fille. Et puis, il faut encaisser aussi tous les soucis psys de ces personnes-là qui deviennent vos amis, enfin, ma meilleure amie de l’époque, je l'avais retrouvée en sang dans sa chambre parce qu'elle s'était ouverte les veines. Et voilà, donc moi j'assiste en direct à l'émergence de la prostitution. Les filles du foyer faisaient un truc qu'elles disaient qu'elles pigeonnaient les mecs. Ça consiste à trouver un mec en général qui est plus vieux que toi, qui a un peu de fric et qui est prêt à te faire des cadeaux tant que tu te balades à son bras. Il n'y a rien de sexuel en échange. C'était une pratique qui était ultra courante. Mes amis pigeonnaient ou michetonnaient, et puis en fait il y en a une qui a commencé à dire, bah voilà, moi le mec il m'a donné tout ça comme argent, je me suis allongée sur le lit, j'ai attendu que ça passe, je serrais les dents. Et puis là je vois, y'en a une, elle le regarde, elle fait « Ah ouais, t'as fait ça et tout ! » mais avec des yeux de respect, d'envie, waouh quoi, tu l'as fait ! Là, le curseur a commencé à... Ça a changé quoi, enfin, on était plus juste sur... Je vais faire envie au gars, c'était, bah je vais lui donner ce qu'il veut et il va me payer en échange.
Lolita Rivé : 15 à 20 000 adolescentes seraient concernées par la prostitution en France. Une majorité sont des enfants placés.
Voix de femme : Du coup, déjà, j'étais vraiment très, très mal. Et puis, un soir, je me rappelle, et il me dit, bon, écoute, tu sais que je t'aime, que je serai toujours là pour toi, tu seras toujours là, pour moi. Toi et moi, c'est pas pareil que les autres.
Lolita Rivé : Dans Comme si j'étais morte, le documentaire de Benjamin Montel, on suit plusieurs d'entre elles.
Voix de femme : Et du coup, il me dit oui, il faut que tu viennes demain et puis que tu commences à bosser pour moi. Du coup, moi, je me rappelle, je lui dis attends, je réfléchis deux minutes et je coupe mon téléphone et je pleure.
Lolita Rivé : Dans la commission d'enquête parlementaire, les élus ont observé que les réseaux de prostitution recrutent au sein même des structures d'accueil.
Aude Kerivel : Le proxénète, ce n'est pas quelqu'un qui est un méchant inconnu qui sort de nulle part. En général, c'est un proche, un petit ami, c'est une amie. Parfois, c´est des membres de la famille. Dans certaines maisons d'enfants à caractère social, il va y avoir un proxénète, une proxénète qui va accrocher des filles pour pouvoir les faire entrer dans le réseau de prostitution. Ils savent que c'est des lieux où les filles sont plus vulnérables et donc ce sont des proies faciles.
Lolita Rivé : Dans le même documentaire, on entend aussi la révolte d'une chef de service dans un foyer de l'ASE. Elle se bat quotidiennement pour extraire ces jeunes filles de la prostitution.
Voix de femme : Il y a des hommes qui achètent l'accès au corps d'enfants. Je suis désolée, 13, 14 ans. Non mais il faut voir le nombre de voitures qui tournent autour des foyers. Je me souviens de personnes qui me disent, enfin écoute, excuse-moi, Christine, mais enfin, elles veulent aussi, là, qu'ils sont des sacs à main, elles veulent avoir des produits de luxe, elles veulent pouvoir s'acheter des choses ou des choses comme ça. De toute façon, elles sont consentantes, elles le choisissent. Putain, mais merde, enfin, je veux dire, t'as envie de dire aux gens, mais si quelqu'un veut tellement un sac à main à ce point-là, ça dit quelque chose de la valeur qu'il se donne.
Lolita Rivé : Ces enfants qu'on délaisse deviennent des proies pour la prostitution, pour la délinquance et même pour le terrorisme. Les frères Kouachi, qui ont attaqué Charlie Hebdo en 2015, Mohamed Mera, auteur des tueries de Toulouse et de Montauban en 2012, ou encore Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles en 2014, tous ont eu un parcours à la protection de l'enfance. Évidemment qu'être un enfant placé ne vous prédit pas une carrière de meurtrier, mais ne pas avoir été protégé enfant crée des fragilités qui peuvent orienter des destins. Et dans leur cas à eux, est-ce que des graves carences n'auraient pas pu être évitées ? Alors qu'elle a 16 ans, Louise cherche un moyen de gagner de l'argent.
Louise : Il n'y a pas mille façons de se faire de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a la prostitution, pour moi c'est absolument hors de question. Et puis il y a... La drogue. J'ai une opportunité pour vendre de la drogue, puisqu’en fait un de mes amis sort de prison, mais il n'a plus d'argent. Il me propose en fait que... Ce soit moi qui l'aide à reprendre son business. Il y a beaucoup de drogue, on ne parle pas d'une petite quantité. J'avais acheté pour 2000 euros de matière première, c'est du crack. Et en fait on a été arrêtés au moment de la vente. Donc je suis embarquée tout de suite par la police et en fait il y a un des policiers qui veut me casser la gueule, l'autre qui lui dit non, elle est mineure, surtout ne lui fait pas de marques.
Lolita Rivé : À l'époque, Louise a 16 ans. Elle est suivie par la protection judiciaire de la jeunesse. À son procès en appel, tandis qu'elle est majeure, elle écope de six mois de prison avec sursis.
Louise : Voilà, je tombe dans la délinquance, clairement, je suis souvent pour des petites histoires.
Lolita Rivé : Je continue après ça.
Louise : Avant ça et après ça, ce ne sera pas ma première, ce n'est pas ma dernière garde à vue. Ce qui m'arrête finalement, c'est de me poser avec quelqu'un, c'est con, ça fait un peu niais, mais de tomber amoureuse, de rencontrer quelqu'un qui est sain, et qui ne trempe pas dans les histoires, ni de justice, ni d'ASE. Et ça, ça me calme en fait. Je sors de tout ça en fondant une famille. Comme toutes les jeunes de l'ASE, le font si bien avec un enfant très très jeune, à 19 ans. Puisqu’évidemment, on veut montrer à tout le monde qu'on fera mieux que nos parents. Je pense que c'est un peu le truc.
Voix de femme : Le petit en aluminium là tu l'as pas non ? Ah bah non il est là !
Voix de fille : Mwa mwa mwah mwa
Voix de femme : Zouzou, elle en met pas de boule au milieu. En fait, en plus, elle n'en a pas assez.
Voix de femme : Et je m'en occupe.
Voix d’homme : Ha ha ha ha !
Lolita Rivé : Comme beaucoup d'enfants des classes moyennes et supérieures, mes parents ont financé ma vie pendant que je faisais mes études. J'ai pas été autonome financièrement avant mes 27 ans. Et aujourd'hui, mes parents continuent de m'aider en s'occupant de ma fille plusieurs fois par semaine. En France, l'âge moyen de départ des enfants de chez leurs parents, c'est 25 ans. Mais quand on est un enfant de l'ASE, on vous demande de grandir bien plus vite que les autres.
Aude Kerivel : Les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et surtout ceux qui sont placés savent qu'à 16-17 ans, il faut qu'ils préparent la fin du placement. On leur demande d'avoir un projet, on leur demande de se préparer à l'autonomie, d'avoir aussi des études qui soient faisables. Et ça, ils l'évoquent, il ne faut pas que ça soit trop long parce qu'il faut que... Ils puissent les terminer avant la fin du contrat jeune-majeur, s'ils ont un contrat jeune majeur. C'est vraiment un passage à l'âge adulte qui est extrêmement anticipé. C'est extrêmement violent, ça n'a pas de sens dans une société où la moyenne d'âge du départ de chez les parents, elle est autour de 25 ans, que le premier CDI est autour de 27 ans, qu'il y a beaucoup de jeunes qui continuent de bénéficier de soutiens matériels et de soutiens immatériels de par leurs parents. De se dire qu'à 18 ans, ils vont être autonomes, c'est complètement absurde. Et ils le vivent comme une peur.
Lolita Rivé : “Moi, je m'appelle Natacha, j'ai 26 ans”. Comme Louise, Natacha a été placée à 13 ans dans une famille d'accueil, après s'être rendue d'elle-même à la gendarmerie parce que son père la violentait. Dix placements plus tard, elle a enfin 18 ans et rêve de grandes études.
Natacha : Moi, clairement, on ne m'a pas fait de contrat jeune majeure parce que j'ai pris la décision de faire des grandes études mais de ne pas les faire là où j'étais.
Lolita Rivé : Le contrat jeune majeur, c'est un accompagnement auquel les jeunes de l'ASE ont droit jusqu'à leurs 21 ans. L'objectif, c'est de les accompagner et de leur financer une formation, un premier emploi, un logement. La demande doit être faite par le jeune motivé et signé de sa main.
Natacha : Et à ce moment-là, on m'a dit ben non, puisque tu changes de région, on ne peut pas te financer ton contrat de jeune majeur. La Gironde, ils ne te connaissent pas, donc ils ne vont pas financer pour toi. Et à la fois, la Vendée, ils m'ont dit « du coup, tu pars de la Vendée, donc pourquoi on te financerait ? » Moi, ça a complètement été ça. J'ai été placée du coup de mes 13 à 18. Et puis pas vraiment à la date de mon anniversaire des 18 ans. Plus aucun contact avec une éducatrice, plus rien du tout. Je suis débrouillée comme une grande, avec beaucoup de difficultés en ramassant bien, en faisant des très grosses erreurs qui m'ont mis dans la merde et à la fois en m'en sortant.
Lolita Rivé : Et même si depuis la loi Taquet de 2022, les départements sont tenus d'accompagner les jeunes majeurs jusqu'à leurs 21 ans, dans les faits, 1 sur 2 se retrouvent abandonnés le jour de ses 18 ans.
Natacha : Donc moi, je me suis retrouvée à 18 ans, à faire des grandes études, à vivre juste avec les bourses et à m'en sortir. Mais il y a plein de jeunes pour qui les barrières, elles étaient déjà mises et pour qui on les a déjà orientés vers des formations courtes.
Lolita Rivé : Seulement 17% des jeunes placés passent un bac général, contre 51% des jeunes de leur âge. Beaucoup se retrouvent même à la rue. Vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre effarant. Un jeune sur trois à la rue est un ancien enfant placé. Les enfants de l’ASE peuvent perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Ils ont deux à trois fois plus de maladies cardiovasculaires, de cancers et de maladies respiratoires. Les conséquences de cette protection de l'enfance exsangue ont un prix. 35 milliards d'euros par an. Ce sont les coûts en santé, en accompagnement social, en insertion, en délinquance, en justice. À quel moment a-t-on tenu notre promesse de protéger ces enfants en danger ? La juge Murielle Églin, présidente du tribunal pour enfants de Bobigny.
Murielle Églin : Et ce qu'on constate très malheureusement dans les tribunaux pour enfants, c'est qu'un certain nombre de jeunes qui devraient bénéficier d'une mesure de protection de l'enfance de placement ou même de mesure de milieu ouvert n'en bénéfient pas parce qu'il y a des délais d'attente trop longs et qu'au cours de leur parcours, ensuite ils commettent des actes de délinquance. On peut peut-être penser que s'ils avaient été accompagnés, s'ils avaient reçu la protection à laquelle ils ont droit, ils ne se seraient pas retrouvés là…
Lolita Rivé : Plus de la moitié des mineurs délinquants sont suivis en protection de l'enfance. Ça veut dire que plus d'un enfant sur deux qui commet un délit est lui-même victime de négligence ou de maltraitance dans sa famille.
Voix d’homme : Sans parler des bandes de jeunes qu'on voit là hier à Clichy-sous-Bois ou à Corbeille-Essonne, etc. Quelle est la démonstration ? La démonstration, c'est qu'effectivement on a laissé faire un ensauvagement qui n'est pas puni par la loi, il y a une absence de répression totale, moi j'entends la prévention si vous voulez.
Voix de femme : On a effectivement affaire à une génération qui n'aime pas la France et qui ne comprend, à mon avis, que le rapport de force. C'est-à-dire qu'ils sont passés à travers les mailles des filets des ambitions éducatives, de la réponse sécuritaire, de la réponse pénale.
Lolita Rivé : À chaque drame qui implique un ou une mineure, on entend le même refrain dans les médias. Pourtant, la délinquance des mineurs est en baisse, moins 25% depuis 10 ans. En revanche, la réponse de la justice, elle, est de plus en plus sévère. En 2023, Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans, est tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier. Dans de nombreux quartiers populaires, des révoltes éclatent.
Voix de journaliste : Des tirs de mortiers qui résonnent dans la nuit. À Nanterre depuis trois jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Mais hier, la tension est montée d'un cran. Face aux policiers, des émeutiers qui brûlent du mobilier urbain et des voitures.
Muriel Églin : La vision de l'enfant qui a été relayée à ce moment-là, c'était une vision d'un enfant qui fait peur. On a parlé d'ensauvagement de la société, on parlait essentiellement des adolescents. C'est là qu'est revenu le discours, ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus violents, discours qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui ne correspond pas à une réalité. Quand on a entendu ce discours-là, on était inquiets pour nos missions. On sait bien qu'il y a des jeunes qui sont en très grande difficulté. Et qui nécessitent une fermeté et le prononcer de sanctions. Et d'ailleurs, on le fait au quotidien dans les tribunaux pour enfants qui prononcent des peines d'emprisonnement, qui prononce des sanctions pénales pour plus de la moitié des décisions qu'ils prennent. Mais on sait bien que pour d'autres jeunes, il faut prendre le temps, un travail éducatif est nécessaire, un vrai accompagnement et une forme de bienveillance et d'écoute et de protection. Et que si on ne passe pas par ce chemin-là, on n'arrivera à rien avec eux.
Gabriel Attal : Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salies, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Lolita Rivé : Gabriel Attal, alors Premier ministre, propose de durcir la réponse pénale à la délinquance des mineurs.
Muriel Églin : Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on pousse à considérer les jeunes comme des adultes. Donc on ne tient pas compte de leur immaturité. Et c'est l'idée même de Justice des mineurs, la première raison pour laquelle elle a été créée, qui est mise de côté parce que ça ne serait pas efficace. Ça n'est fondé sur rien. Sur aucune étude, sur aucun constat. Et à ne parler que de l'ensauvagement et de la crainte qu'inspire la jeunesse, on se retrouve dans une forme de délégitimations du travail éducatif et de la protection qu'on doit aux adolescents. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que si on est dans la sanction sans éducation et sans protection préalable, on produit une forme violence qui ne va pas aider les jeunes en tant que groupe à se reconnaître dans la société que leur proposent les adultes, qui ne va pas les aider non plus à devenir des adultes apaisés, qui eux-mêmes seront en capacité de transmettre quelque chose de positif et de constructif à leurs propres enfants. Et il faut qu'on soit vraiment vigilants à ce qu'on construit comme avenir pour nos enfants, dans nos discours et dans nos actes.
Lolita Rivé : Comme la protection de l'enfance, la justice des mineurs manque de moyens. Il y a environ 500 juges des enfants en France. Selon Murielle Églin, il en faudrait 250 de plus. En Seine-Saint-Denis, où elle exerce, il peut se passer 6 mois avant que les mesures éducatives prescrites aux enfants qui ont commis un délit soient appliquées.
Muriel Églin : Des délais aussi importants, si un enfant est sur une trajectoire de délinquance, s'il commence à être pris dans un réseau de délinquance ou à ne pas respecter le cadre qui est posé pour lui par sa famille, si on attend six mois avant que l'éducateur intervienne, évidemment qu'il y aura de nouvelles affaires derrière. Alors est-ce qu'on va être plus sévère alors qu'on n'aura pas su tenir nos promesses ? C'est toute la question.
Lolita Rivé : Dès lors qu'un enfant se rend coupable d'un délit, on oublie trop souvent que c'est un enfant. Plusieurs recherches ont montré que les jeunes hommes, noirs et arabes, sont beaucoup plus fréquemment contrôlés que les jeûnes perçus comme blancs, à situation comparable. En 2025, le Défenseur des droits parle de 4 fois plus de risques d'être contrôlé pour ces jeunes hommes. Et même 12 fois plus, de faire l'objet d'un contrôle poussé. Fouille, palpation, conduite au poste.
Voix de femme : Les gens qui manquent d'amour, les gens qui voient devant eux tout cet amour qui existe, qui existe vraiment, et qui existe en quantité suffisante pour tout le monde. Les gens voient qu'il y en aurait pour tout l'monde en principe, mais qu'ils ne voient jamais redistribuer vers eux. Ces gens-là, ces enfants-là ils se mettent à réfléchir différemment, à agir différemment. Ils se disent que quelque chose leur a été interdit, que quelque chose leur a été repris. On prend soin du drame qui va prendre place. Et le drame va arriver, parce que ceux qu'on a rendus fous d'amour en leur faisant penser qu'ils étaient indignes de tout ce love, ils finissent toujours par se faire du mal ou par en faire aux autres. Lauren Marx, portrait de Rita.
Lolita Rivé : Alors comment faire mieux ? La Défenseure des droits a étudié le problème et rendu ses recommandations, tout comme la commission d'enquête parlementaire qui en formule 92. Beaucoup recoupent ce que réclame le militant Lyes Louffok, un ancien enfant placé qui a créé le comité de vigilance de l'ASE. Il demande.
Lyes Louffok : 1. Il faut que l'Etat reprenne la compétence sur l'aide sociale à l'enfance. 2e mesure : Il faut revaloriser les métiers du travail social. 3e mesure : Je rendrais obligatoire pour chaque enfant placé d'être assisté par un avocat. 4e mesure : J'interdirais aux départements de mettre à la rue les enfants placés à l'âge de 18 ans ou de 19 ans.
Lolita Rivé : Mais aussi le respect de l'interdiction des placements en hôtel pour les enfants, que les établissements de l’ASE puissent être visités par les députés, et la création d'une autorité indépendante pour contrôler les foyers. Pour la juge Murielle Églin, améliorer le sort des enfants qui ont affaire à la justice, ça passera par la prévention et l'aide aux familles. Justement pour éviter d'en arriver à la Justice, déjà surchargée.
Muriel Églin : La France a choisi pour l'instant un mode de fonctionnement qui est très judiciaire. C'est-à-dire que la protection des enfants se fait à 80% par l'intervention de la justice alors que d'un autre pays c'est 20%. Et ça fait peser sur la justice des mineurs une charge qui est quand même très lourde. Donc c'est maintenant qu'il faudrait pouvoir changer les choses, investir massivement dans la protection de l'enfance, dans la prévention d'abord, mieux s'appuyer et mieux aider les familles pour qu'elles puissent trouver en elles-mêmes les ressources pour... S'occuper de leurs propres enfants, y compris les familles élargies, recréer du lien social et permettre à la communauté de s'occuper de ses enfants plutôt que de vouloir être tout le temps dans une substitution de l'institution à la famille. On voit bien que les institutions produisent aussi de la maltraitance institutionnelle. La protection de l´enfance, c'est une chaîne qui commence par le fait d'offrir à tous les enfants et toutes les familles des services qui leur permettent de bien s'occuper des enfants et de tous les enfants.
Lolita Rivé : Les enfants handicapés restent les plus vulnérables. Si 4% des enfants français sont en situation de handicap, ils représentent 25% des enfant placés. L'absence de politique publique pour ces enfants, qui ont des besoins spécifiques, les fragilisent d'autant plus. Les structures ne sont pas adaptées pour les accueillir et les éducateurs ne sont formés pour les accompagner. Et puis, il y a des enfants qu'on préfère considérer comme des adultes, pour ne pas avoir à les prendre en charge. Comme les MNA, ces mineurs non-accompagnés qui n'ont pas de papiers et qui peinent à prouver qu'ils sont des enfants. En octobre 2025, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a même accusé la France de violations graves et systématiques de leurs droits. Entendre les enfants qui vivent des violences, mieux les protéger et les aider à grandir dans l'amour, en fait c'est possible. En 2023, les départements ont consacré 11 milliards d'euros à la protection de l'enfance. Pour pallier les défaillances du système, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, estime qu'il faudrait à peine 800 millions d'euros de plus chaque année. Dans le prochain épisode de « Qui c'est qui commande ? », “à quoi sert l'école ?” L'école est un droit pour tous les enfants. Mais est-ce qu'au sein même de l'école, les droits des enfants sont respectés ? Dans certaines écoles, les enfants choisissent chaque jour ce qu'ils font, les règles qui s'y appliquent, et on s'adapte à leur rythme et à leurs besoins.
Voix de fille : Qui va en fait réellement nous servir dans la vie, pas que les matières classiques mais plein de choses, le vivre ensemble etc.
Voix-off : Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.
Épisode 4 : "À quoi sert l’école ?"
L’école promet l’égalité, la mixité, l’épanouissement. Pourtant, un enfant sur deux un enfant sur deux n’a régulièrement pas envie d’aller à l’école, et beaucoup racontent l’angoisse, les humiliations ou la peur de l’échec.
Lolita Rivé, elle-même professeure, interroge le rôle de l’école : que transmet-elle, entre apprentissage et contrainte ? A travers les paroles d’élèves, de parents et d’enseignants, les analyses du chercheur Sébastien Charbonnier, de la Défenseure des droits Claire Hédon et l’expérience de pédagogies alternatives telles que la « classe dehors », elle explore d’autres façons d’apprendre et de vivre ensemble.
Qu’est-ce qu’une école qui respecterait enfin complètement les droits des enfants ? Que faudrait-il changer pour que chaque élève puisse s’y sentir à sa place, entendu, reconnu et libre de grandir ?
Qui C'est Qui Commande ? Episode 4
Salle de classe : On va continuer les jeux qu'on avait fait hier. Tiki tiki tiiiik, attention ! Si je suis devenue instit’, c'est parce que j'aime être avec les enfants. Là on montre des parties du corps, et on doit deviner lesquelles c’est.
Salle de classe : Hier, on avait fait le nez, l'oreille et le dos… Bravo !
Lolita Rivé : J'aime leur transmettre des choses, les faire grandir, les aider à comprendre le monde et à s'y sentir bien. Ce qu'on appelle les éduquer en somme. Mais être enseignante, ce n'est pas seulement ça. C'est même souvent ça.
Classe bruyante : Ok, stop, stop, ce n'est pas possible ce bruit, ça ne va pas ou quoi, tu n'es pas d'accord, c'est comme ça quand même, tu vas aller là bas sur le fauteuil bleu, dépêche toi de rentrer, tu lâches ça, tu rentres, tu viens ici, tu ne mettes pas à côté, silence.
Lolita Rivé : Je passe beaucoup, beaucoup de temps à les contraindre, à les surveiller, à leur donner des ordres, à leur interdire des choses, à crier même. Vous vous souvenez de votre scolarité, vous ? Est-ce que vous avez adoré ? Ou est-ce que vous en êtes traumatisé ? L'an dernier, ma fille a eu trois ans. Je me suis beaucoup posé la question de sa scolarisation.
Pleurs d’enfant : Je veux rester à la maison !
Lolita Rivé : Dans ces moments-là, je me demande ce qu'elle vit, si elle n'est pas malheureuse à l'école, et si d'autres enfants ne ressentent pas la même chose tous les matins. Au départ, l'école, c'est une belle promesse républicaine. Celle d'offrir à tous les enfants la même instruction et donc les mêmes chances, de lutter contre les inégalités sociales, de favoriser la mixité. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, Je lis que l'école doit viser à favoriser l’épanouissement...
Voix d’homme : Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses potentialités.
Lolita Rivé : On ne peut pas dire qu'on remplit toutes ces promesses. À quoi ressembleraient une école qui respecte pleinement les droits des enfants ? Quel est le prix et l'effort collectif à faire pour que l'école soit le lieu d'épanouissement de tous les enfants ?
Voix off : Qui c’est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivé sur les enfants et leurs droits. Épisode 4, à quoi sert l'école ?
Voix de garçon : Oh, moi, l'école, je kiffe parce que c'est trop bien. On peut jouer avec ses amis. Et moi, surtout mon truc préféré, c'est surtout les calculs parce que moi, je suis très fort en maths.
Lolita Rivé : L'école, c'est bien plus qu'un lieu de passage.
Voix de petite fille : Moi, j'adore l'école, les choses préférées que j'adore, c'est la récréation et que j'aime lire.
Lolita Rivé : Les enfants y passent près de 15 ans de leur vie.
Voix de garçon : Je n'aime pas trop l'école parce que quand on est à l'école, on n'a pas le droit de beaucoup jouer avec nos amis et de profiter.
Lolita Rivé : Ils s'y font des amis, ils découvrent le vivre ensemble.
Voix de garçon : Et moi, j'aime pas aussi l'école parce qu'il y a des gens qui sont aussi méchants à l'école, dans notre école.
Lolita Rivé : S'il y a bien un endroit où les droits des enfants devraient devenir réalité, c'est à l'école. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer à l'école ?
Garçon : J'aimerais bien que la classe soit un petit peu plus grande parce qu'elle est tout petit et qu'on doit être serré comme des sardines.
Garçon : Moi, je veux sortir, prendre de l'air parce que moi, je suis tout le temps à l'intérieur à faire des devoirs, travailler. Je suis tout le temps collé, moi, aux choses. Ça va me prendre malade. Moi, j'ai envie de prendre de l'air, sortir dehors, aller à la plage.
Lolita Rivé : Une enquête de l'UNICEF, de 2024, a révélé qu'en France, un enfant sur deux n'a régulièrement pas envie d'aller à l'école. Un enfant sur trois dit n'avoir aucun adulte à qui se confier s'il ne se sent pas bien à l'école. Et 65% des enfants sont angoissés de ne pas réussir. C'est aussi ça que génère l'école, la peur de l'échec.
« L'échec scolaire, c'est l'école qui le fabrique », a écrit Georges Pasquier. Un enseignant suisse. L'école publique promet d'accueillir tous les enfants, et cette mixité sociale, elle est fondamentale si on veut construire une société capable de bien vivre ensemble. Mais c'est contradictoire avec le fonctionnement de l'école aujourd'hui. On attend d'enfants aux vécus très différents, aux milieux sociaux divers, d'acquérir les mêmes compétences au même moment.
Sébastien Charbonnier : Finalement, l'école est plutôt un rouage au service d'une certaine reproduction sociale.
Lolita Rivé : Sébastien Charbonnier est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université de l'île Troyes. Il a écrit La fabrique de l'enfance aux éditions lundi matin.
Sébastien Charbonnier : Le rôle fondamental qu'elle joue, c'est pas dans tous ces contenus, en physique, en histoire, en géo, etc., mais c'est autre chose. Ce qu'on appelle le curriculum caché, c'est-à-dire des choses que les élèves ont réellement appris, mais qui n'étaient pas dans le programme. Et ça, c'est le boulevard à la reproduction sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont apprises inconsciemment par le corps, par les relations de pouvoir quotidiennes au sein de l'école. Ça peut être apprendre à se taire, apprendre à rester assis toute la journée. Apprendre que c'est normal une société dans laquelle il n'y a pas des places pour tout le monde. Donc apprendre la compétition et en accepter les conséquences parfois très violentes.
Lolita Rivé : Malgré toute la bonne volonté des profs, l'école peine à lutter contre les inégalités entre les enfants. Seulement 13% des enfants d'ouvriers obtiennent un diplôme bac plus 5, contre 55% des enfants de cadres. Les élèves les plus performants dans cette grande compétition scolaire, ce sont les enfants qui sont socialement privilégiés dès le départ. Ceux qui grandissent dans des familles maîtrisant la langue française, qui peuvent aider pour les devoirs, qui les emmènent au musée, qui ont des contacts pour le stage de 3e et les moyens de payer des profs particuliers. Et surtout, des enfants qui n'ont pas de handicap.
Présentatrice TV : Tous les parents d'enfants en situation de handicap sont habités par la même angoisse à chaque rentrée scolaire. Mon enfant sera-t-il accompagné cette année ? Le gouvernement promet la création de 2000 postes d'ici 2025 d'AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap qui manquent cruellement aujourd'hui dans les écoles.
Lolita Rivé : Sur les 520 000 enfants porteurs de handicap en France, beaucoup n'ont que quelques heures d'école par semaine, voire aucune. À cause du manque de place en IME, les instituts médico-éducatifs, ou du manque d'AESH, les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Un métier par ailleurs extrêmement précaire et mal payé. Alors, ce serait quoi ? Des écoles qui respectent les droits et les besoins de tous les enfants ? Une cousine, agricultrice dans le Tarn, m'écrit qu'elle a envoyé ses deux enfants dans une école démocratique. Démocratique. Rien que le terme me fascine. Je décide d'aller voir.
Voix SNCF : L'île sur Tarn
Lolita Rivé : J'arrive à l'école de Loupiac, un grand bâtiment plat au milieu de la place de ce village de 500 habitants.
Voix : Bonjour, merci. Bonjour…
Voix de fille : Je m'appelle Adélie, j'ai 14 ans, donc quand on arrive on est juste en face de la grande salle, c'est la salle collective où on se réunit le matin et l'après-midi.
Lolita Rivé : La salle est chaleureuse, un canapé rouge, des ordinateurs, une bibliothèque, des étagères avec des exercices en libre-service et une grande table de réunion.
Voix de fille : On a la salle d'art et de bricolage. On a du bois, des outils, du papier, de la peinture. Et on a aussi une salle de musique.
Lolita Rivé : À l'école démocratique, il y a deux classes d'une quinzaine d'élèves. Les païdos, qui ont entre 7 et 10 ans, niveau élémentaire, et les kaïros, qui ont entre 11 et 15 ans, c'est le niveau collège. Là-bas, les élèves peuvent arriver entre 8h30 et 9h00. Quand je pense à la galère que c'est le matin avec ma fille pour la réveiller, la faire manger, s'habiller et partir à l'heure pour arriver avant 8h30 à l'école,
Voix de parents : Et tes céréales tu les manges quand ? Chaussures ! on y va Zouzou !
Lolita Rivé : Je me dis que cette amplitude permettrait qu'on soit tous moins stressés le matin. D'autant que de nombreuses études ont montré que reculer l'heure de début de classe permet aux enfants, et surtout aux ados qui se couchent plus tard, d'améliorer leur attention, leur humeur et leur performance scolaire.
Voix de fille : Annonces ! C'est les annonces !
Lolita Rivé : Tous les matins à 9 heures donc, chaque groupe se réunit pour la présentation des cours et les élèves choisissent.
Maîtresse : Oui, alors ce matin, en premier temps, moi je vous propose du coup la suite de l'activité sur Antigone. Du coup, ça se passe ici dans la grande salle. Pour les personnes qui choisissent plutôt de faire des mathématiques, il y a quelques nouvelles ressources que vous trouverez dans l'étagère des mathématiques, notamment résoudre des équations, il y a un petit fichier.
Victor : L'enjeu d'avoir du choix dans les apprentissages, c'est de construire un rapport à l'apprentissage qui soit sain et qui soit enthousiasmant.
Lolita Rivé : Victor est professeur du groupe des Kaïros, les collégiens.
Victor : Après, ça n'empêche qu'on est assujetti et on y croit, toute l'équipe, aux exigences de la loi par rapport au socle commun. Il semble important d'avoir un ensemble de bases, de connaissances, de compétences et de cultures, voilà, c'est vrai, pour évoluer dans la vie. Et donc ça, on met en place des outils pour que les enfants voient un peu tout, et on les accompagne sur les choses pour lesquelles ils ont le plus de mal. L'idée c'est que ça puisse se faire en fonction de leur rythme, en fonction de leur méthode d'apprentissage. Si le manuel n'attire pas du tout, peut-être qu'on va faire un livret, peut-être qu'on va faire une activité. Et l'idée c'est d'aller, de répondre aux besoins des gens tout simplement, au lieu d'essayer de les gaver avec un entonnoir.
Maîtresse : Morgane, pareil, tu viens au français ce matin ?
Enfants entre eux : Toi, tu vas faire quoi, ce matin ? L'activité d’hier, Antigone. Ok.
Lolita Rivé : Qu'est-ce que ça donne quand on laisse les enfants choisir ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font rien ?
Voix de fille : En fait, on peut pas choisir de rien faire parce qu'il y a quatre temps dans la journée et genre dans le premier temps on peut faire soit maths, soit français. On est obligé de le faire et à chaque fois il y a des il y a des profs qui passent dans chaque salle pour voir ce que les personnes font. Voilà. Moi je préfère travailler comme ça parce qu'on n'a pas de pression. Il n'y a pas de notes et donc quand je prends plaisir à travailler bah j'apprends plus je genre je l'imprime plus dans mon cerveau. Et au lieu de passer trois mois à apprendre l'imparfait, eh ben ici on peut avancer à son rythme. Si on a besoin d'un an pour le connaître bien, eh ben on peut le prendre et au contraire si on a besoin de deux jours, en fait on peut aussi. Donc ça c'est vraiment chouette.
Olivia : Oui quand un élève arrive en général du système classique et qu'il découvre le fonctionnement où il doit choisir et s'organiser, il y a tout le temps ce moment « Error 404, comment ça on me demande de choisir ? » et c'est vraiment hyper compliqué.
Lolita Rivé : Olivia, professeure à l'école démocratique.
Olivia : En général, oui ça prend quelques semaines pour que les élèves redécouvrent ce qu'ils ont envie de faire. Il se questionnent sur « qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? » parce qu'ils n'ont jamais appris ce qu'ils avaient envie d'apprendre et aussi découvrir sa manière d'apprendre parce que il y a plein de manières d'apprendre.
Sébastien Charbonnier : Et quelque chose qui est assez spécifique à l'Occident, c'est d'avoir associé l'éducation à la transmission.
Lolita Rivé : Sébastien Charbonnier.
Sébastien Charbonnier : Et l'anthropologie est vertueuse parce qu'elle nous montre que c'est une spécificité à nous, ce n’est pas quelque chose de naturel ou d'universel. Et qui dit transmission, dit que l'enfant ne pourra apprendre que ce que nous consciemment on a souhaité. Lui passer. Et pourtant la meilleure chose, et ça c'est un consensus en ce sens de l'éducation philosophique depuis longtemps, la meilleure chose qu'on puisse faire pour apprendre à mieux se connaître, s'orienter, prendre des décisions, c'est d'expérimenter, de tâtonner, d'essayer, c'est à dire de découvrir par soi-même.
Voix de fille déclamant un texte : Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte, on dirait des chiens qui lâchent tout ce qu'ils trouvent. Moi je veux tout tout de suite et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste moi et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage.
Lolita Rivé : On pourrait faire tout un podcast sur les programmes officiels, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on n'apprend pas et qui décide de ses programmes. Comme on pourrait questionner le fait qu'il n'y a pas dans les emplois du temps de créneaux dédiés à l'apprentissage des émotions, à la résolution de conflits, au ménage ou à la fabrication de cabanes par exemple. Car qu'est-ce qui est dans l'intérêt des enfants d'apprendre ? Et quelle façon d'apprendre permet leur épanouissement, le développement de leurs dons. Et de leurs aptitudes mentales et physiques. Les théories sur ce qu'on apprend à l'école, mais aussi sur comment on apprend, ont beaucoup évolué depuis la création de l'école. À la fin du 19e siècle, il y a les pédagogies nouvelles qui émergent, avec des figures comme l'italienne Maria Montessori, le belge Decroly, l'américain Dewey, ou encore le français Célestin Freinet. Cette nouvelle façon de penser l'éducation des enfants, elle replace l'enfant au centre de l'école. Il ne s'agit plus de gaver les élèves de savoir et de leur demander de recracher par cœur. Pour bien apprendre, pour bien grandir, il faut que les enfants expérimentent, manipulent, et ne pas oublier qu'ils n'ont pas qu'une tête, qu'ils ont aussi un corps qui ressent des choses, et qui a besoin de s'exprimer. Et enfin, ces pédagogies, elles misent sur l'apprentissage du vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a plein d'enseignants qui s'inspirent de ces pédagogies dans leurs classes, en créant des classes flexibles et autonomes par exemple, où les enfants peuvent se déplacer, s'asseoir sur des ballons, écrire debout, travailler à leur rythme.
Sébastien Charbonnier : Un des acquis de la philo de l'éducation et aussi des pédagogies féministes, c'est de considérer que ce qui est émancipateur, ce n'est pas les contenus de ce qu'on apprend, c'est la forme relationnelle dans laquelle on apprend et on pense. Ce n'est pas de se dire on va mettre un peu plus d'autrice-femme que d'auteur-homme et on va parler de sujets d'écologie dont on ne parlait pas avant, mais vraiment comment on organise l'école, quels sont les processus de pouvoir. Qu'on veut éviter, comment est-ce qu'on veut s'organiser pour qu'il y ait plus d'horizontalité, etc. Donc c'est vraiment ces questions de manière de « relationner » et de faire société. En tout cas, on se présente nous comme des sociétés démocratiques. Pour préparer à ça, on assume que les enfants vont être formés dans un espace qui n'est pas du tout démocratique. Et ça, c'est hautement paradoxal. Et c'est vraiment le point sur lequel des pédagogues comme Freinet, Dewey et d'autres ont beaucoup insisté. L'expérience de l'école doit être la première expérience démocratique pour préparer à une société et à une vie démocratique.
Voix de fille : Donc s'il vous plait, on va commencer l'Ecclésia.
Lolita Rivé : Retour à Loupiac, où se prépare un des temps les plus importants de l'école, l'Assemblée démocratique à laquelle tout le monde participe deux fois par semaine.
Voix de fille : C’est notre réunion pour décider de toutes nos règles. Vraiment on décide ensemble en fait et du coup c'est super chouette parce que si t'es pas d'accord tu peux le dire, tu peux expliquer pourquoi t'es pas d'accord et on va trouver une structure qui convient vraiment à tout le monde. Donc on décide de notre école ensemble en fait. On a du pouvoir sur ce qui arrive à notre école et donc ça nous implique beaucoup plus dans l'asile collective et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on respecte peut-être plus les règles parce qu'on sait à quoi elles servent.
Lolita Rivé : Chaque personne, enfant comme adulte, a une voix. Les sujets changent chaque semaine en fonction de ce qui se passe à l'école, et l'assemblée est toujours animée par un ou une élève. Aujourd'hui, c'est le tour d'Adélie.
Adélie : On va passer au sujet numéro 5, poêle sales et trucs sales dans l'évier, Victor.
Victor : Deux fois la semaine dernière, j'ai pris des poêles toutes grasses qui étaient à sécher contre le mur là, sur les crochets. Et en fait j'en ai marre de prendre des poêles toutes grasses, je trouve ça vraiment dégoûtant.
Garçon : Moi je pense tout le temps le même sujet, c'est le sujet de la vaisselle. Tout ce qui est mal fait à la vaisselle. On essaie de mettre plein de trucs en place, mais au final les gens ils n’y arrivent toujours pas, c'est énervant.
Lolita Rivé : Pour ne pas s'interrompre tout en participant, tout le monde s'exprime par des gestes silencieux. Par exemple, pour dire qu'on est d'accord, on remue les mains comme des marionnettes au niveau de sa tête. Et pour demander la parole sur le même sujet, on met les mains face à face, en les bougeant de haut en bas en décalé.
Adélie : On va passer au sujet, hockey sur gazon, matériel, organisation tournoi de foot, agrafe, agrafe, qui a un de ces sujets ? Volant perdu au badminton. Donc on peut clore le sujet ? Oui. Est-ce qu'il y a des sujets à rajouter ? C'est juste pour aussi les dépenses, en ce moment on dépense beaucoup. Donc on va voter cette proposition au consentement dans 3. Donc la proposition est acceptée. On va pouvoir clapper l'Ecclésia dans 3, 2, 1.
Olivia : Le rapport au collectif pour moi quand un élève sort d'une école classique. Il a beaucoup plus été habitué à cette logique d'humiliation, de compétition, toute cette logique avec les notes, avec se comparer, enfin tout ça. Pour moi, ça crée quelque chose de très individualiste en fait. Il y a très peu de moments où ils doivent s'organiser ensemble les élèves, où ils doivent co-construire des choses, où ils doivent finalement vivre ensemble en fait. Et ça, pour moi, ça manque dans la société. On le voit, je suis dans une association et quand il s'agit d'animer des réunions avec des adultes, mais les gens se coupent la parole. Il suffit d'aller sur les débats télé, en fait, les gens se coupent la parole. Ils n'apprennent pas à s'écouter, à attendre que l'autre ait fini. Voilà, ils n'apprennent pas à prendre en compte les besoins de l'autre, exprimer ses limites, exprimer ses besoins, enfin voilà, tout ça. C'est des compétences qui sont... Très peu développés, ce n'est oublié dans les écoles classiques.
Lolita Rivé : Je me demande à quoi ressemblerait notre assemblée nationale ou nos réunions de co-pros si tout le monde avait appris à pratiquer la démocratie comme ça, dès le plus jeune âge. En Suède, l'apprentissage de la démocratie, c'est une priorité dès l'école maternelle. C'est ce que m'a expliqué Marion Cuerq, spécialiste des droits des enfants et du modèle suédois.
Marion Cuerq : La pré-école suédoise, où les enfants vont de 1 an à 5 ans, c'est vraiment le temple de la culture de la relation. C'est là où les enfants, parce que la société est garante de leurs droits, vont apprendre, tous les enfants, peu importe d'où ils viennent, qu'ils ont une individualité, qu'ils doivent être respectés, qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord, qu'ils ont le droit de le dire, qu'il faut coopérer avec les autres, qu'il ne faut pas être dans l'écrasement, qu'on fait les choses ensemble. Qu'on n'est pas là pour être meilleure que les autres, qu'on a tous la même valeur. Dans le programme suédois où c'est écrit que le prendre soin, le développement et l'apprentissage forment un tout. Un enfant, pas ce qui va être bien en lien avec l'enseignant, qui va avoir finalement une correction de confiance, il va se développer, sinon il ne se développera pas. Et c'est ainsi qu'il pourra apprendre. Donc c'est cette idée qu'un enfant qui n'est pas bien dans sa sécurité physique, émotionnelle, il ne pourra ni se développer ni apprendre. Donc on met encore une fois la relation au cœur de l'apprentissage.
Enfants : Là tu peux lui faire des pâles hein, t'entends pas ? Oui, je sais. J'ai pas envie d'aller là-bas. Faut commencer le jeu !
Enfants : Vas-y, vas-y, rattrape ça !
Lolita Rivé : Je crois que c'est ce qui me marque le plus dans l'école du Tarn. La relation que les enfants ont avec les éducateurs. Et le regard que les adultes portent sur eux. Un regard confiant, respectueux, que j'ai très rarement vu dans les écoles que je fréquente.
Enfants : Passe-moi la balle Léonie !
Lolita Rivé : En général, on a plutôt de la défiance vis-à-vis des élèves, ce filtre de la méfiance dont on a déjà parlé. On se méfie d'eux a priori parce qu'ils peuvent tricher, mentir, ne pas respecter le cadre, faire toutes sortes de conneries. J'ai entendu des profs dénigrer des élèves. J'ai aussi vu des enfants se faire crier dessus comme du poisson pourri, être physiquement bousculé. La première raison, c'est que beaucoup de profs sont épuisés. Nerveusement à bout à cause de conditions matérielles intenables, des journées trop longues, parfois sans aucune aide, des enfants en situation de handicap dont on doit s'occuper sans être formés, des programmes interminables, des classes sans chauffage ou sans fenêtre, des établissements qui s'effondrent. Et parfois, il y a aussi des adultes qui pensent que c'est comme ça qu'on « tient » des enfants, quand on est un bon éducateur. En France, il est très difficile de remettre en question les méthodes d'un enseignant. Et ça, ça a permis que des enfants subissent les pires violences à l'école.
Présentateur TV : C'est l'affaire qui a poursuivi François Bayrou pendant ces 9 mois à Matignon. L'affaire Bétharram, cet immense scandale de violence dans une congrégation catholique de la région de Pau. Plus de 200 plaintes, autant de témoignages glaçants, une commission d'enquête parlementaire fleuve.
Voix d’homme : C'est des coups de règle. C'est des doigts en sang. C'est des visages en sang. Je me dis, c'est ça l'école en fait, l'école, il faut se tenir à carreau et si on prend du coup, ma foi, c'est qu'on les a bien mérités.
Lolita Rivé : Les gifles, les coups de poing sur la tête, des enfants mis dénudés sur le perron en hiver, les agressions sexuelles dans les douches et les dortoirs. Ces violences extrêmes ont choqué l'opinion publique, à raison. Mais elles ne doivent pas nous faire croire qu'en dehors de ces cas gravissimes, tout va bien.
Claire Hédon : Il faut arrêter de parler au passé. Ça perdure aujourd'hui. Peut-être moins en violence physique, encore qu'on en voit encore, mais en violence psychologique, ça reste important.
Lolita Rivé : Claire Hédon, Défenseure des droits.
Claire Hédon : Je peux vous donner un exemple très précis sur une décision qu'on a rendue récemment d'une enseignante qui à la fois avait bousculé un enfant, mais avait dit aussi « Vous êtes d'accord, il n'est vraiment pas malin, il ne fait pas bien son travail, mais va t'acheter des yeux » ou « Tu as le temps d'aller chez le coiffeur, mais tu n'as pas le temps de faire tes devoirs ». Qu'est-ce qui s'est passé pour cette enseignante ? On est juste allé la mettre dans une autre école, voilà. Donc quel suivi, quel accompagnement ? Comment on s'assure qu'elle ne répète pas même chose avec un autre enfant ?
Lolita Rivé : J'ai rencontré les adolescents du Conseil Communal des Jeunes d'Issy-les-Moulineaux. Ils ont entre 14 et 17 ans. Je leur ai demandé de me parler de leur scolarité.
Voix de fille : Moi, l'année dernière, j'avais une professeure de mathématiques. En fait, je crois qu'elle avait un peu un problème contre moi parce que je comprenais pas ses cours. Et du coup, quand je demandais de me réexpliquer, enfin, quand je levais la main, elle disait non, je te réexplique pas, parce qu'il y a que toi qui comprends pas le cours. À un moment, j'ai un camarade qui a posé une question qu'elle a jugé débile. Elle a dit donc Sacha, tu commences à voir le cerveau de Léonie.
Voix de fille : Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est levée de sa chaise. Elle était hyper énervée. Elle a pris les lèvres par l'oreille. Elle l'a emmenée jusqu'au porte-manteau. Et elle l'a accrochée au porte-manteau avec lui à l'intérieur.
Voix de fille : Le prof, quand il a une haine marre, il s'est levé de son bureau et il est venu devant la table du camarade. Il l'a pris par le col et il l'a passé par-dessus la table en le portant comme ça. Et après, il l'a traîné dans la classe et il l'a jeté dans le couloir.
Voix de fille : Elle lui a dit « Viens te laver les mains, parce que t'as les mains sales, t'as volé quelque chose ». En fait, elle lui dit « Vas-y, mange le savon maintenant, ça va te nettoyer ». Vraiment, on s'est retrouvé avec un petit qui mangeait du savon devant toute une classe.
Voix d’homme : Article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant.
Claire Hédon : Les questions, par exemple de harcèlement, ne viennent pas forcément sur n'importe quel terrain. S'il y a de la bienveillance, et si la bienveillance est prônée des adultes vers les enfants, on a plus de chance qu'entre enfants elle ait lieu. Cette bienveillance, elle marche en chaîne comme la violence peut marcher en chaîne.
Lecture : Le prof de maths continuait de nous ignorer, celle de SVT de faire voler plein de projectiles, et le lendemain même du sermon, l'enseignante de français scotcha sur le front d'Anabelle un post-it où il était écrit « Facultés intellectuelles limitées ». Les adultes avaient dénoncé la violence entre élèves. Ils nous avaient fait la leçon. Mais pas une fois ils n'avaient remis en question leur propre violence. Ni celle de l'école. Nous étions violents car le milieu scolaire générait cette violence. Le collège créait les conditions de notre haine fratricide. Il était comme une arène dont pour sortir vainqueur il fallait être un putain d'oppresseur. Ou à minima, un valet transparent.
L’école est finie, Maylis Adhémar (Editions Stock, 2025)
Lolita Rivé : Les violences physiques et psychologiques sont bien sûr inacceptables. Mais comment réguler les comportements d'enfants qui sont inadaptés aux cadres scolaires ? Existe-t-il des punitions qui respectent leur dignité ? À mes débuts d'instit' à l'école primaire, j'avais un tableau de comportement : les élèves sages sont dans le vert, dans le orange si ça dérape, et dans le rouge si ça ne va pas du tout. Avec des mots aux parents ou même des lignes à copier. Et je trouvais ça incroyablement moderne par rapport au coût de règle qu'avaient reçu mes parents. Mais si les conséquences sont incomparables, la logique reste la même. Mes élèves ne respectent pas les règles parce qu'ils les ont choisis et comprises, mais parce qu'ils ont peur de moi. Ça leur apprend surtout à dissimuler et à se dénoncer entre eux. Petit à petit, j'ai tout supprimé. Je le constate avec mes élèves. Quand ils savent qu'ils n'auront pas de punition, quand ils ont confiance en moi, Ils sont beaucoup plus enclins à reconnaître leurs torts et à les réparer. Parce qu'au lieu de les accuser et de les exclure, je les responsabilise. Ça met du temps à se construire, j'en conviens. Mais c'est la différence entre la punition, qui humilie individuellement, et la sanction, qui répare collectivement. C'est ce que m'expliquent Olivia et Victor.
Olivia : L'épreuve de l'école démocratique. Quand un élève arrive du système classique, je vois qu'il a ce filtre-là en lui. Qui va avoir un comportement où il va essayer de contourner la règle ou de cacher par exemple son téléphone ou de vite fermer un cahier parce qu'il me voit arriver et il me voit avec la croyance que je suis là pour l'empêcher de quelque chose, etc. Et moi à ce moment-là, je leur dis très clairement « Ah là, s'il y a ce rapport-là qui s'installe entre nous, moi je vais développer de la méfiance envers toi » et je crois que c'est pas ça que j'ai envie de développer.
Victor : Il nous tient beaucoup plus à cœur de travailler sur les raisons qui fait qu'une règle a été transgressée, les besoins qui n'ont pas été nourris chez une personne, qui ont fait que cette personne est allée au-delà des règles, et de trouver une solution pour que ce soit arrangé. L'idée n'est pas de punir la personne qui a fait du mal, l'idée est de faire en sorte que tout le monde aille bien.
Olivia : On n'est pas l'incarnation des règles en tant qu'adultes. Le fait de pas respecter les règles, ce n'est pas un moyen pour eux de s'exprimer. Et moi, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Quand on ne respecte pas une règle dans l'école classique, c'est aussi un moyen de dire « mais ça ne me plaît pas en fait ». Ici, ils ont des moyens de dire que ça leur plaît pas.
Lolita Rivé : Mais évidemment, tout ça vole en éclats quand on parle du comportement d'élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, un handicap ou qui vivent des violences chez eux. Ces enfants-là ont besoin d'un traitement particulier, d'une aide individualisée. On ne peut pas laisser les profs se débrouiller seuls. Et pour ça, il faut plus d'adultes pour s'occuper des enfants, mieux rémunérés et mieux formés. Contrairement à la France, en Suède, les profs de maternelle ont une formation différente de ceux du primaire. Ils ont une connaissance précise du développement des plus petits et de leurs besoins. Et au centre du temps passé à l'école,
Marion Cuerq : Les suédois, ils veulent pas d'enfants à 2-3 ans qui savent écrire, ou voilà, qui sont sur une chaise, ou qui vont... Non, les enfants, ils sont dehors, ils sont pleins de boue, ils jouent dans la neige...
Lolita Rivé : Marion Cuerq
Marion Cuerq : On dit aussi que les enfants crasseux sont des enfants heureux. C'est encore cette idée que l'enfance heureuse, en tout cas, c'est comme ça que la construction de l'enfance, elle est faite en Suède beaucoup. C'est une enfance dans la nature, c'est une enfance... Au contact vraiment des éléments, de l'eau, de la terre. Et c'est pas l'enfant assis à une chaise, qui bouge pas, qui tient son stylo, qui lève la main.
Lolita Rivé : La Suède, mais aussi l'Allemagne ou la Suisse, ont depuis longtemps intégré le plein air à leur pédagogie.
Voix d’enfants : Et puis bon, bah du coup, il faut absolument qu'on enlève la menthe, hein. Il faut qu'on enlève des coccinelles !
Lolita Rivé : Les enfants français, eux, passent 10 fois moins de temps dehors qu'il y a 30 ans. Près de 40% des enfants de moins de 10 ans ne jouent jamais dehors en semaine.
Voix de femme : Wouhou! Venez par ici!
Lolita Rivé : Partout en France, des profs essaient de changer les choses dans leur classe.
Garçon : Et moi j'ai vu des gendarmes, des coccinelles, des escargots, des vers de terre. On trouve des vers de terre !
Garçon : Moi, la dernière fois, j'ai trouvé une sauterelle.
Lolita Rivé : Virginie Sigaud et Laetitia Raguin enseignent depuis 20 ans.
Maîtresse : Nos jonquilles ont fané, pas dans tous les bacs, mais dans certains bacs, elles ont fané.
Lolita Rivé : Ensemble, elles ont décidé de faire classe dehors, grâce à un espace vert prêté par la ville de Lyon.
Maîtresse : Qui ont fait leur bourgeon plus tard, Sabrine ?
Enfant : Parce que, bah, ils poussent pas en même temps.
Maîtresse : Ah ! C'est un peu comme des enfants. Ça pousse pas en même temps, les plantes. D'accord ?
Lolita Rivé : Une à deux fois par semaine, leurs deux classes de CPCE1 de l'école OUI Lumière se rendent au jardin potager, dans le quartier de Montplaisir.
Enfant : Cet arbre, c'est le protecteur du jardin, il s'appelle Michel.
Maîtresse : C’est quoi comme arbre ?
Enfant : Un zèdre !
Enfant : on fait pousser de la menthe, on découvre plein d'insectes que moi j'ai jamais connus. Et c'est extraordinaire moi je trouve le jardin et tout ça.
Lolita Rivé : Les élèves font pousser de la menthe, des fleurs et des légumes. Ils font du compost et observent les insectes à la loupe. Pour certains enfants, c'est leur premier rapport à la nature.
Laetitia Raguin : Au début de l'année, on a des élèves qui n'ont jamais touché la terre, ou alors qui pensent que la terre, c'est sale. Ils associent la terre aux excréments.
Lolita Rivé : Laetitia raguin.
Laetitia Raguin : Ils ont peur aussi de toutes les petites bêtes qu'ils voient, une fourmi, un gendarme. Ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Et puis, petit à petit, il y a aussi le côté mimétisme, c'est-à-dire qu'on a effectivement des élèves qui ont nourri un rapport à la nature avec la famille, des élèves qui font du jardin avec leur papy, qui connaissent déjà, qui ont déjà des connaissances. Et donc ces élèves-là, vu qu'ils vont commencer à s'investir un petit peu dans les activités qu'on va proposer et qu'ils vont montrer une certaine aisance, les autres vont avoir envie un peu de faire pareil et d'arriver finalement à faire la même chose, quoi !
Maîtresse : Et vous allez me coller votre brin d'herbe qui mesure 5 centimètres.
Enfant : Moi je préfère commencer par les branchettes.
Enfant : Ah ouais bonne idée, c'est le plus dur à trouver.
Enfant : On cherche une branche de 10 centimètres, et on a le droit de la couper.
Enfant : Waouh Daphné, elle est beaucoup plus grande. Voilà, maintenant on a trois morceaux qui mesurent 15 centimètres.
Lolita Rivé : Virginie et Laetitia adaptent leurs séances de grammaire ou de géométrie au jardin. Les élèves apprennent à mesurer ce qu'ils trouvent. Un brin d'herbe ou une branchette, plutôt qu'une ligne dans un manuel. Ils découvrent le cycle de la vie des végétaux en faisant pousser des tulipes, plutôt que sur des polycopiés. Et ils apprennent à respecter les êtres vivants en fréquentant des coccinelles et des cèdres.
Enfant : En classe, c'est comme si moi j'étais, si je reste trop longtemps en classe, c'est comme si j'étais en prison.
Enfant : Enfermés dans une boîte ! Moi je préfère être dehors pour travailler. Je trouve que je suis plus détendu et je suis plus attentif dehors. Parce qu'avant en fait, on était coincé dans une salle et maintenant on travaille plus dehors, c'est mieux, on découvre des choses, on apprend et en même temps on joue, moi je trouve, on s'amuse en même temps.
Virginie Sigaud : On regarde les enfants et on voit déjà qu'ils sont tous actifs et puis ils sont vraiment dans ce qu'ils font.
Lolita Rivé : Virginie Sigaud
Virginie Sigaud : Ils aiment ça, ils sont plus libres, ils se sentent plus libres. Ils n'ont pas le poids du groupe qui les observe en fait. Donc s'ils se trompent, ce n'est pas grave, on peut essayer, réessayer, réessayer. En fait, il y a des enfants qui en classe n'ont vraiment pas confiance en eux. Ils se sentent en échec et au jardin, ils vont prendre confiance en eux. Ils vont se dire que je suis aussi capable que les autres. Par exemple, ce petit garçon qui ne voulait pas parler. Lui il s'éclate dans les activités aux jardins en classe, il est très très renfermé en fait.
Lolita Rivé : Des études ont montré que le contact avec la nature réduit le stress, et favorise l'attention, mais aussi la mémoire, surtout chez les enfants qui ont des troubles de l'attention et de l'apprentissage.
Enfant : C'est quoi ? Cours ! Sabrine, cours !
Enfant : Ben moi je dirais un verbe, non ? C'est un verbe !
Enfant : Non, non ! C'est un pronom personnel !
Enfant : Je sais pas !
Enfant : Réfléchir ! Réfléchir ! Réfléchir c'est un verbe !
Virginie Rigaud : Les personnes qui n'ont jamais, qui n'ont jamais pris soin de la nature en cultivant un jardin, en faisant pousser de la ciboulette, enfin je dis n'importe quoi, mais qui n'ont jamais eu ce jeu « je prends soin de la nature », ils ne peuvent pas prendre soin de la nature en étant adultes. C'est quelque chose qui s'apprend enfant. Effectivement les enfants qui ne sont jamais sortis, qui ne sortent pas de chez eux, qui ne vont pas au jardin, qui ne vont pas au parc, qui ne vont pas au bord de l'eau, qui vont pas... Voilà, qu'on passe contact de nature, comment on peut leur reprocher de ne pas s'occuper de la nature ? Ils ne connaissent pas, ils ne vont pas s'engager. Et nous, en faisant classe dehors, on pense que justement, on va les amener à, plus tard, eh bien prendre soin de la nature, ils sauront faire.
Lolita Rivé : En France, près de 5000 écoles, collèges et lycées pratiquent la classe dehors. Ça représente moins de 1,5% des établissements scolaires. Ces initiatives sont souvent fragiles, car elles dépendent de la bonne volonté individuelle et du soutien de l'institution.
Enfant : On enlève toute la menthe ?
Maîtresse : Mais vous la prenez bien au bout. Non pas tout, mais là, ici. Il y en a trop et vos fèves, elles vont pas mouiller.
Maîtresse : Oulala, t'as vu ça ? Mais toi t'as tout arraché en même temps ! T'as de la chance, c'était de la mauvaise herbe !
Lolita Rivé : Allez, on récapitule. Que faire pour que l'école respecte pleinement les droits des enfants ?
Voilà quelques idées :
Autonomiser les enfants et leur redonner de la liberté dans leurs apprentissages.
Trouver des moyens d'apprendre dehors au contact de la nature.
Revoir les rythmes scolaires, alléger les programmes et réserver les après-midis au savoir créatif, artistique et sportif.
Se donner les moyens d'inclure les enfants handicapés et adapter les apprentissages à leur spécificité.
Introduire des systèmes de démocratie directs dans la classe et dans l'école pour que les enfants aient du pouvoir sur leur quotidien.
Laisser les enfants libres de se mouvoir, de boire et d'aller aux toilettes autant que possible. Et enfin mieux former les profs et diminuer le nombre d'élèves par classe.
Ce n'est évidemment pas au prof de faire cette révolution seule. Il faut des parents d'élèves soutenants, qui interpellent les autorités. Et surtout, un État et des collectivités qui donnent les moyens pour que l'école devienne ce qu'elle devrait être. Un lieu d'émancipation et de découverte qui respecte les droits des enfants.
Dans le prochain épisode, on se demandera pourquoi on a chassé les enfants de l'espace public et comment imaginer des villes à hauteur d'enfants.
Enfant : Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la rue qui est bloquée et juste pour que nous on puisse jouer.
Enfant : Ouais, c'est cool, c'est comme si on était les rois du monde un peu.
Enfant : Même si c’est juste une rue.
Voix off : Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.
Épisode 5 : "Va jouer dehors !"
"Va jouer dehors!" lancent parfois les parents, exaspérés, à leurs enfants bruyants. Problème : dehors il n'y a souvent pas d'endroit où aller pour la majorité des enfants (70% vivent en ville). Entre les dangers de la circulation et le manque d'espaces et d'infrastructures adaptées, beaucoup d'enfants sont en fait forcés de rester "des enfants d'intérieur". Quelle place leur laisse-t-on ?
Lolita Rivé, professeure des écoles, nous emmène dans des terrains d’aventures où l’on creuse, construit, fait du feu, dans une rue aux enfants fermée à la circulation pour leurs jeux… Parce qu’ils et elles aussi ont droit à une ville à leur hauteur.
Qui C'est Qui Commande ? Episode 5
Voix de journaliste : Le mouvement “no kids” qui fait la promotion d'espace sans enfants. Alors certains adultes effectivement souhaitent partir en vacances ou aller dîner au restaurant sans être exposés à des comportements qui peuvent être, c'est vrai, un petit peu agaçants.
Voix de femme : C'est plus seulement les films réservés aux adultes mais maintenant il y a les hôtels, les restaurants, les fêtes de mariage, cette tendance no kids, pas d'enfants, c'est tant !
Lolita Rivé : Les enfants sont-ils devenus indésirables pour qu'on ne veuille plus les voir dans l'espace public ? Aux mariages, en vacances ou même au restau.
Voix de garçon : Je me demande qui fait le plus de bruit entre tout le monde. Je pense que c'est plus les adultes qui le font.
Lolita Rivé : La tendance “no kids”, sans enfants, se déploie depuis les années 2000, à l'étranger d'abord et maintenant en France.
Voix de fille : Mais moi je dis que c'est eux parce que souvent quand ils viennent chez des gens par exemple, on fait que de les entendre, on ferme la porte, on les entend toujours.
Lolita Rivé : La discrimination par l'âge, c'est interdit par la loi. On n'imagine pas entrer dans un hôtel interdit au plus de 60 ans. Pourtant, les lieux garantis sans enfants représentent déjà 3% de l'offre touristique en France. Et s'ils sont rentables économiquement, ça risque de se répandre. Mais en fait, le vrai problème, ce serait pas que tout notre espace public est “no kids” ? Je veux dire, pas pensé pour les plus jeunes. L'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant dit que
Voix d’homme : L'enfant a le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
Lolita Rivé : Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a même rajouté que
Voix d’homme : l'accès à des espaces sûrs et inclusifs dans les espaces publics est essentiel.
Lolita Rivé : Alors, comment créer des espaces communs qui répondent à nos besoins à tous, tout en étant à hauteur d'enfant ? Comment redonner leur place aux enfants dans l'espace public ?
Voix de garçon : Ah non mais oui, mais ils ont une place dans la société, non mais c'est pas les adultes qui commandent hein ! Non mais dis donc !
Voix-off : Qui c’est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivé sur les enfants et leurs droits. Episode 5 “Va jouer dehors !”.
Voix de femme : On est arrivés. Merci madame.
Voix de fille : C'est moi !
Voix de femme : Ah pardon. Là t'as le bras assez long c'est bon ?
Lolita Rivé : S'occuper d'enfants, c'est changer de regard sur l'espace qu'on habite, comme si on changeait de lunettes. On réalise à quel point la ville n'est pas pensée pour eux. Les portes claquent, les poignées sont trop dures, les boutons trop hauts, les trottoirs trop étroits et encombrés par des poubelles et les pots d'échappement à hauteur de leur nez. Et je ne vous parle pas des toilettes publiques ou des tables allongées uniquement présentes côté femme.
Voix de femme : Ca serait bien que les gens s'arrêtent.
Lolita Rivé : Ce manque d'accessibilité, il n'y a pas que les enfants et leurs parents qui le subissent.
Voix de femme : Merci madame. Viens, viens, viens. On est parti. C'est parti, elle attend pour nous. Vas-y chérie.
Lolita Rivé : Parce que l'aménagement urbain a été pensé pour un homme adulte, valide, qui consomme et travaille. Ça veut dire qu'on a surtout fait en sorte de pouvoir se déplacer efficacement du domicile au travail en journée. Sans penser aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Ma fille de 4 ans adore grimper partout, sur les murets, les grilles d'immeubles, les rebords de fenêtres. Des passants lui ont déjà dit que c'était pas pour jouer, ou qu'il ne fallait pas toucher. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'en ville, le seul endroit où les enfants ont le droit d'explorer, ce sont les parcs et les aires de jeux ? Ces parkings à enfants par classe d'âge, comme les appellent le philosophe Thierry Paco. Pourquoi la ville n'est pas faite pour jouer ?
Clément Rivière : En fait, les enfants sont moins présents dans les villes qu’ils ne l'étaient par le passé.
Lolita Rivé : Clément Rivière est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille.
Clément Rivière : Au cours des trois, quatre dernières décennies, on sait, grâce à un ensemble de recherches qui ont été conduites par des sociologues, par des économistes, par des psychologues, par des géographes, que les enfants, ils passent moins de temps sans adultes dans les espaces publics. Leur rayon de mobilité diminue et par ailleurs, l'âge auquel ils réalisent les premiers trajets en autonomie est retardé. Donc c'est à la fois une amplitude d'autonomie moins grande dans l'espace, un temps passé qui se réduit et puis un âge d'autonomie qui se décale dans le temps.
Lolita Rivé : Selon une étude de l'ADEME, l'Agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les enfants commencent à se déplacer seuls vers 11 ans et demi. C'est un an plus tard que leurs parents quand ils étaient petits. Seulement 9% des enfants de CM2 vont tout seuls à l'école. En 6e, ils sont 36%.
Clément Rivière : Ça met en jeu plein de choses différentes qui sont à la fois liées à des évolutions sociales qu'on peut considérer comme étant bénéfiques pour les enfants. Par exemple, le fait d'avoir pour la plupart d'entre eux arrêté de travailler. Ça renvoie aussi à l'évolution des conditions de logement, puisqu'en fait des logements plus grands, de meilleure qualité, ont tendance à faire en sorte que les habitants, notamment les enfants, soient un peu moins dehors. Ça renvoie aussi à des évolutions de la façon dont les villes sont aménagées, notamment la place des voitures, qui, tout au long du XXe siècle, se sont mises à occuper la ville pour circuler et pour stationner. Et les villes ont été redessinées, pensées aussi en fonction de cette place centrale de l'automobile. Donc la disparition dans un certain nombre de villes, de terrains de jeu, de friches, est liée à cette nécessité nouvelle de pouvoir garer les voitures.
Lolita Rivé : On est passés de 2 millions de voitures dans les années 50 à 40 millions d'automobiles en France aujourd'hui. Évidemment, ça prend de la place.
Voix de femme : Ouais, voilà, comme ça, c'est top, tu peux la poser. On peut aller chercher des tables.
Lolita Rivé : Des associations, comme Les Potes en Ciel à Lille, essayent de redonner de la place aux enfants dans la ville.
Voix de femme : Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de trucs !
Lolita Rivé : Chaque année, ils organisent une rue aux enfants. C'est une rue entièrement fermée à la circulation pour que les plus jeunes se la réapproprient le temps d'un après-midi.
Voix de femme : On a des valises à déguisements, on a des cordes à sauter, de quoi peindre, parce qu'on va peindre, on va peindre la rue, on va mettre plein de couleurs, plein de jeux libres, type échasse, craies, on a du matériel de construction aussi.
Marylène Gars : La ville, c'est un terrain d'aventure gigantesque en fait pour les enfants. Avant on se posait même pas la question de “est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas”, ils le faisaient et aujourd'hui on le fait plus.
Lolita Rivé : Marylène Gars, de l'association “Les Potes en Ciel”.
Marylène Gars : Et ça a des impacts quand même assez graves en fait sur leur autonomie, leur liberté, leur capacité à découvrir le monde. Il y a cette question aussi de la mobilité. Plus t'es tôt dehors en autonomie, plus t'es capable de faire plein de choses dans la ville en fait et de pas avoir peur les premières fois où tu vas le faire.
Voix de fille : Je vais me faire maquiller, donc en papillon.
Voix de femme : Alors on y va, papillon. Quelle couleur ce papillon, dis-moi ?
Voix de fille : Euh, j'aime bien l'orange, le bleu. L’orange, le jaune et le vert.
Voix de garçon : Je suis très content qu'il y ait la rue aux enfants parce que à la part la kermesse et les toutes petites fêtes qu'on organise en hiver, ça change un peu. Et ce qui est incroyable c'est que c'est la rue qui est bloquée juste pour que nous on puisse jouer et je trouve ça incroyable.
Voix de fille : Pendant quelques heures, pour les enfants, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de choses qui vont nous embêter. Et on va pouvoir jouer, on va pouvoir faire la fête, entre guillemets. On va pouvoir faire ce qu'on veut, en quelque sorte. C'est comme si on était les rois du monde, un peu. C'est juste une rue, mais du coup c'est cool.
Lolita Rivé : En quelques minutes, la rue se remplit d'enfants surexcités, trop heureux d'avoir un terrain de jeu qui leur est spécialement destine, d’être pour une fois au centre de ce qui se passe dehors. Et au milieu des enfants enthousiastes, il y a des grands un peu déboussolés.
Voix de femme : Oui, je viens chercher ma petite fille. Elle est partie par là, j'ai dû la perdre, l'égarer pour son plus grand bonheur. C'est génial. Il faudrait qu'il y ait plus de rues encore comme ça, les enfants se mélangent, les parents discutent entre eux. Qui peut être contre les enfants qui s'amusent, qui apportent de la joie dans une ville ? Qui peut être contre ? Je ne sais pas.
Lolita Rivé : Mais donc vous aimez bien être dans la rue, quand on ferme les rues comme ça ?
Voix de fille : Ben moi, moi je me sens protégée, enfin, en fait c'est le seul moment où je peux vraiment me défouler dans la rue.
Voix de fille : Même à la sortie de l'école, comme ça, vu que c'est fermé, enfin pas tout le temps, mais on peut voir les copains sur la route et tout, et être avec eux après l'école.
Voix de fille : Ce qui est bien, c'est que c'est animé, donc c'est ça que les gens aiment bien. C'est pas que du blanc et des bruits, ça donne de la joie.
Lolita Rivé : 90% des parents mettent en avant l'insécurité routière pour expliquer qu'ils ne laissent pas leurs enfants se déplacer seuls. Mais ce n'est pas l'unique raison. Près de l'entrée de l'école, un groupe de 7 filles de CM2 sont à l'atelier collage.
T'as le droit de te balader seul ou pas ?
Voix de fille : J'aimerais bien, sauf que j'ai un peu une maman poule, donc ça risque pas d'arriver tout de suite.
Voix de fille : Mais j'aimerais bien aussi me balader avec mes amis ou toute seule. Je trouve que c'est un passage à l'âge où t'es un peu plus indépendant. J'aimerais être un peu plus relâchée. On me protège un peu trop parce qu'en ce moment mes parents écoutent un peu la radio et ils voient que beaucoup d'enfants se font agresser, maltraiter ou tuer dans la rue donc ils ont un peu plus peur et je peux les comprendre.
Voix de fille : Moi j'ai un peu peur des personnes bizarres dans la rue. Là je rentre toute seule de l'école mais à part ça j'ai pas trop envie de sortir seule ça m'apporte à rien.
Clément Rivière : Un durcissement très fort des discours politiques et médiatiques autour de figures qui sont des figures plus ou moins fantasmées de danger et notamment du danger pour les enfants.
Lolita Rivé : Clément Rivière, sociologue.
Clément Rivière : Ce qui a des effets sur les parents qui vont être perpétuellement exposés à des histoires préoccupantes, sordides, traumatisantes, et qui vont peut-être les conduire à ne pas laisser leurs enfants faire des choses qu'ils auraient pu leur laisser faire sinon. Comme ne serait-ce qu'aller à l'école tout seul, ou aller voir des copains dans la rue, ou aller jouer au foot en bas de chez soi. Quand on nous présente sans cesse des enlèvements d'enfants terribles, bah il y a un message derrière, le message c'est garder vos enfants chez vous, sinon vous êtes un mauvais parent.
Lolita Rivé : 8 parents sur 10 craignent que leur enfant se fasse agresser dans la rue s'il est seul.
Clément Rivière : Les mêmes gens qui vont avoir tendance à instrumentaliser les faits divers et à dire qu'en fait c'est très risqué dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, de laisser les enfants dehors, ça va pas du tout. En fait, dès qu'on leur parle de l'autre grande crainte des parents qui est celle de l'accident de la circulation, alors là s'il s'agit de toucher à la place de la voiture dans la ville tout de suite, la vie des enfants et leur liberté leur paraît beaucoup moins importante. Là tout d'un coup on touche un point, une ligne rouge comme on dit aujourd'hui. Et donc les mêmes gens qui vont pointer du doigt les supposés violeurs, tueurs d'enfants, etc., sont pas prêts, je pense, à remettre en question de manière significative la place de la voiture dans la ville.
Voix de fille : Pas de voiture ? Pas de voiture.
Voix de femme : Olé !
Lolita Rivé : Quand je regarde ma fille filer en trottinette avec insouciance sur les trottoirs, j'aimerais la protéger de tout. Je sais qu'un jour, je vais devoir la mettre en garde sur la ville et ses dangers. Et je parle plus des voitures. Je parle de tout le reste. Tout ce à quoi les petites filles qui ne sont plus si petites doivent faire attention. La façon de s'habiller, de se comporter. Tous les conseils que j'ai moi-même reçus au début de l'adolescence.
Clément Rivière : Les filles et les garçons ne sont pas préparés de la même façon à la ville et aux usages des espaces publics.
Lolita Rivé : Dans son livre, Leurs enfants dans la ville, Clément Rivière étudie la socialisation des enfants à l'extérieur.
Clément Rivière : Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de décrire comment les parents essayent de préparer leurs filles, de former leurs filles à la place spécifique qu'elles occupent dans la société urbaine, qui est une place qu'on pourrait qualifier de dominée ou de secondaire, avec un accès moindre aux espaces publics, à la fois en termes d'horaires, mais aussi plus de contrôle de la façon dont elles vont être habillées, dont elles vont se présenter aux autres dans les espaces publics. La substance du message qui est transmis aux filles est un peu la même dans toutes les familles. C'est l'idée qu'elles doivent, d'une certaine manière, faire profil bas.
Lolita Rivé : Et le genre n'est pas le seul critère qui change le rapport des enfants à la ville. Le milieu social, l'endroit où ils grandissent, ou le fait d'avoir un handicap joue énormément.
Clément Rivière : Parler de manière générique des enfants, c'est aussi un peu problématique puisqu'il y a des différences qui renvoient au contexte dans lequel ils grandissent et puis aussi au type d'éducation, au type de manière dont leur temps notamment est investi par les parents qui peuvent des fois présenter des contrastes très importants. Il y a des enfants qui ont très peu de temps disponible et donc en fait ils ont très peu de temps à passer dehors notamment parce qu'ils ont peu de temps disponible pour jouer.
Voix de fille : Le lundi, je fais de la piscine le soir. Mardi, j'ai danse classique le soir. Mercredi, rugby. Jeudi, j'ai piscine. Et vendredi, j'ai yoga.
Clément Rivière : C'est plutôt des enfants qui grandissent dans des milieux favorisés. Au fond, si on combine ça avec le temps passé devant les écrans qui grandit aussi, il n'y a plus beaucoup de temps pour être dehors. D'un côté, on est dans un moment où on s'interroge justement sur le fait que les enfants sont trop dedans, sont trop devant les écrans et peut-être ne s'approprient pas assez leur environnement. Et d'un autre côté, il y a aussi, alors ce n'est pas les mêmes gens évidemment, mais des discours récurrents sur la jeunesse et un peu l'enfance aussi désoeuvrée, qui serait dans la rue, qui finalement serait livrée à elle-même. Donc là, il y a quand même une stigmatisation importante de manières d'être dans la ville ou d'être dehors qui sont plutôt caractéristiques des classes populaires et qui sont pointées du doigt par un certain nombre de discours politiques notamment.
Lolita Rivé : Ma fille est blanche, je sais qu'elle a moins de chance d'être contrôlée par la police que les jeunes racisés dans la rue. Publié en avril 2025, le rapport d’Aline Daillère et Magda Boutros a montré que certains jeunes, noirs ou arabes, écopent d'amendes à répétition, au point d'être endettés.
Voix de femme : Vas-y, mets ton deuxième pied, il faut que tu regardes devant toi. Vas-y, pousse, pousse, pousse, regarde loin devant toi. Vas-y, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, ouais, regarde devant toi, regarde devant toi.
Lolita Rivé : Dans la rue aux enfants, l'association roule nordiste a ramené une dizaine de vélos pour initier les enfants aux deux roues.
Voix de femme : Ah ça va, elle a un petit équilibre déjà !
Lolita Rivé : En octobre 2024, le Haut Conseil de la Famille de l'enfance et de l'âge a constaté que plus de 37% des adolescents avaient un mode de vie trop sédentaire. Peu d'activités physiques, beaucoup de temps devant les écrans. Les enfants français sont en train de devenir des enfants d'intérieur et c'est un enjeu de santé publique. D'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, les enfants devraient faire au moins une heure d'activités physiques par jour. C'est 30 minutes pour les adultes. Dans les faits, parmi les enfants de moins de 10 ans, quasiment 40% en font moins. Chez les ados c'est pire, ce chiffre monte à 73%. A l'inverse, le temps passé devant les écrans a tendance à augmenter. Les enfants de 2 ans passent en moyenne 1h par jour devant les écrans. 1H30 pour les enfants de 5 ans et pour les ados, c'est 5h par jour en moyenne. Et on sait aujourd'hui que le temps d'écran et l'usage des réseaux sociaux fragilisent la santé mentale des adolescents. Moi, j'ai grandi sans smartphone. Ça fait boomer de dire ça, mais je pense que c'est une chance. J'habitais dans un pavillon dans le sud de la Seine-et-Marne. Derrière chez moi, il y avait des champs, une prairie avec un poney et la forêt. On passait notre temps dehors, dans le jardin ou à faire des tours de pâté de maison à vélo. On était très libres. À côté, ma fille a une vie parisienne très sédentaire et je suis sur ses côtes en permanence.
Voix de femme : Tu t’arrêtes au bout là, ok ? Tiens-toi les mains chérie. Allez, traîne pas, Zouz avance !
Lolita Rivé : Mais on idéalise aussi souvent l'enfance à la campagne. Car en contrepartie, on dépend entièrement de nos parents pour nous emmener en voiture partout parce que les transports en commun, c'est pas ça. Il faut avoir les moyens de se payer le permis à 18 ans, pour être enfin autonome, et d'autres s'achètent un scooter dès 14 ans. Mais les routes sont dangereuses. J'ai perdu plusieurs amis en deux roues avant d'être majeure. Explorer la forêt aussi, ça peut être dangereux. Je me souviens des coups de feu des chasseurs qui nous faisaient sursauter. Il fallait mettre des vêtements colorés pour ne pas être pris pour une biche et surtout ne pas sortir des sentiers. Vive la liberté... Concernant l'air pur de la campagne, qui serait meilleur que l'air pollué de la ville, eh bien, ça dépend d'où vous grandissez.
Voix de journaliste : En France, depuis 1980, les cancers infantiles augmentent chaque année de 1%. 2500 nouveaux cas par an. C'est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant.
Lolita Rivé : Cash investigation 2016.
Voix de journaliste : Existe-t-il un lien entre ces maladies et l'exposition aux pesticides ? Pour les scientifiques français, il n'y a plus guère de doute.
Lolita Rivé : Il y a aujourd'hui en France ce qu'on appelle des clusters de cancers pédiatriques, comme en Normandie, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime ou dans le Jura. Les produits toxiques utilisés pour l'agriculture sont en train d'empoisonner les enfants. Ça semble être le b.a.-ba, mais la Défenseure des droits a rappelé en 2024 le droit des enfants de grandir dans un environnement sain, de pouvoir respirer, boire et manger sans craindre pour leur santé.
Lolita Rivé : Que ce soit à la campagne ou en ville, est-ce qu'il existe des endroits pensés pour les enfants, où on ne leur dit pas quoi faire et comment le faire ?
Voix de garçon : Noah, tu te mets tes pieds dedans ?
Lolita Rivé : Des lieux où ils peuvent aller seuls et faire ce que bon leur semble.
Voix de garçon : Ah, nous on est dans notre petit bain de pieds là, tranquille.
Lolita Rivé : Avoir du temps libre et jouer en sécurité.
Mathieu Wainsten : Je te propose si tu veux, il faut essayer de défaire des petits bouts de bois pour faire des petits tuteurs pour protéger les plantes
Lolita Rivé : C'est ce qu'a voulu faire Mathieu Wainsten, à Bagnolet. L'animateur a obtenu de la ville de récupérer 500 m² de terrain envahi par les dépôts sauvages. Il en a fait un terrain d'aventure destiné aux enfants.
Voix de femme : Bonjour, tu t'appelles comment ?
Voix de fille : Asma !
Voix de femme : T'as quel âge Asma toi ?
Voix de fille : Moi j'en ai neuf. Moi je suis à la Petite plage. Il y a des arbres, il y a la cuisine à côté, il y a une table, un bateau avec un cheval dedans. Il y a encore le derrière du jardin parce que c'est un grand jardin.
Voix de fille : Moi mon endroit préféré c'est où il y a les cerises parce que je mange tout le temps les cerises.
Voix d’homme : Tu plantes un pied de tomates ?
Lolita Rivé : À la petite plage de Bagnolet, tous les enfants sont les bienvenus gratuitement.
Voix de fille : Si vous voulez, je peux vous faire visiter la caravane là-bas, si vous voulez. Ah bah là, je fais un peu de plantations.
Lolita Rivé : Mais dans les faits, ceux qui viennent sont souvent assez abîmés, par des contextes familiaux dysfonctionnels, des conditions de vie difficiles.
Voix d’homme : Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aya ?
Voix de fille : Aya elle va rentrer direct, tu vas peut-être...
Voix d’homme : Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? Au moins, déjà que je comprenne.
Lolita Rivé : Ici, il trouve une deuxième famille.
S'il n'y avait pas le terrain d'aventure, tu t'irais où ? Tu ferais quoi ?
Voix de fille : Je serais chez moi toute la journée, mais au moins il y a le terrain d'aventure qui nous sauve.
Lolita Rivé : Quand t'es enfermé à la maison, tu fais quoi ?
Voix de fille : On joue au UNO, je sais pas, je joue avec ma Switch, ou soit on regarde la télé. Apparemment ça nous bousille le cerveau. Il y a des choses que j'ai le droit à faire au terrain d'aventure, c'est que j'ai le droit de faire de la cuisine. J'ai le droit de m'énerver et à partir quelque part parce qu'à la maison il n'y a que deux chambres, ça veut dire que c'est compliqué parce que soit tout le monde vient tous dans ma chambre, ça veut dire que c'est énervant, alors que là ça va mieux, c'est moins énervant.
François Grandeau : Regardez, de l'autre côté, j'ai fait un trait pour que ce soit bien...
Voix de fille : Comme ça ?
François Grandeau : Ah tu peux y aller encore, non non encore encore encore, regarde, cette pointe là tu la ramènes sur cette pointe là.
Lolita Rivé : François Grandeau a été un des premiers à gérer des terrains d'aventure à Paris. Il y accueillait les enfants de la rue dans les années 90.
François Grandeau : Mais les enfants, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin qu'on leur lâche un peu les baskets, qu'on les laisse un peu tranquilles. Ils ont besoin d'être dans leur monde et qu'on le respecte. Ça empêche pas qu'on soit vigilants, ça empêche pas qu'on les laisse pas faire n'importe quoi non plus. Mais malgré tout, ils ont besoin de faire leurs expériences et qu'on les laisse tranquilles. La philosophie du terrain d'aventure, c’est le terrain d'aventure, c'est l'enfant. Il n'est pas vu en tant que futur adulte ou futur citoyen. On n'est pas là, nous adultes, pour l'amener à quelque chose. On n'est pas là pour lui faire découvrir, non, on est là pour le faire vivre son état d'enfant.
Lolita Rivé : Le terrain d'aventure, c'est l'antithèse du centre de loisir ou du sport.
François Grandeau : Un centre de loisir, l'animateur, il est là, il est au centre. Nous, au contraire, on fait tout pour disparaître. Il y a énormément d'observations, on va regarder les gamins, on va regarder, d'abord, il faut les connaître à fond, il faut savoir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ne sont pas capables de faire, ce qu'on va pouvoir les laisser faire, là où il va falloir qu'on intervienne. Mais nous, on doit disparaître au maximum.
Lolita Rivé : L'idée des terrains, elle est sortie de la tête d'un architecte danois, Sorensen, dans les années 40. Il a observé que les enfants préféraient jouer dans les ruines, les débris et les gravats, plutôt que sur les toboggans, les tape-culs et autres balançoires.
Voix d’enfants : Moi, ici, je vais me baigner. Je vais me mouiller les pieds, moi. Non, non, mais pas encore tes pieds. C'est parce qu'il y a trop de saleté, c'est pour ça.
Lolita Rivé : En France, les terrains d'aventure doivent respecter une charte dont les principes phares sont le libre accès, la gratuité et surtout l'activité libre.
François Grandeau : L'activité libre, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément productive. Un gamin sur le terrain, il a envie de faire un trou, il a envie de touiller la terre, mais pas forcément pour faire quelque chose, simplement pour touiller la terre ou pour faire un trou. On est très vigilants quand même. Je ne laisse pas un gamin faire n'importe quoi avec une scie. Je ne laisse pas un gamin faire quelque chose dont je sais qu'il n'a pas le niveau. C'est leur terrain qu'ils doivent s'approprier, les outils qu'ils doivent s'approprier, l'espace, ils doivent aussi s'approprier leur propre sécurité. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas d'accidents. C'est pas en leur disant, oui, fais attention, machin, ne met pas si long, c'est en le laissant face au problème, et c'est à lui de résoudre les problèmes. Et là, on est de plus en plus sur, ben non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire... Oh là là, tu creuses le sol, mais mon Dieu, c'est terrible ! Oh là là, tu fais du feu, mais c'est épouvantable ! Tu fais ci, tu fais ça, tu utilises un marteau, c'est ça gros, c'est pas possible ! On est rentrés dans un système d'interdits et de normes. Il faut absolument mettre les gamins sous papier bulles, quoi !
Voix de fille : Potiron, potimaron, voilà. C'est pas le truc pour faire des soupes.
Voix de femme : On va planter là-bas, Serena.
Voix d’homme : Fais gaffe à ta tomate, tu es en train de la plier. Et je vous prépare pour un autre trou pour les tomates tout à l'heure.
Lolita Rivé : Aujourd'hui, on comptabilise à peine une soixantaine de terrains d'aventure en France, encore bridés par la réglementation et le manque de subventions. En comparaison, en Allemagne, il y en a plus de 400.
Lolita Rivé : Les terrains d'aventure font partie d'un mouvement plus large, de remise en question de la ségrégation des enfants. Le pionnier de la ville à hauteur d'enfant, c'est Francesco Tonucci, un enseignant italien, chercheur en psychologie, qui a voulu faire sortir les enfants de chez eux, pour qu'ils vivent l'expérience fondamentale de l'exploration, de l'aventure et du jeu. Il milite pour un temps libre des enfants, et même pour l'ennui, en dehors de leur famille et de l'école. Il a commencé par sa ville natale, Fano, sur la côte adriatique. Les trottoirs ont été élargis, des rues fermées aux voitures, la vitesse de circulation limitée et les terrains de sport ouverts gratuitement, le soir et les week-ends. Pour lui, une ville bonne pour les enfants, c'est une ville bonne pour tout le monde.
Voix de fille (chante) : Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région
Lolita Rivé : Aujourd'hui, près de 300 villes en France veulent prendre en compte les besoins des enfants et ont signé une charte ville à hauteur d'enfant. C'est le cas de Lille qui a émis une cinquantaine de recommandations. Je vous en cite quelques-unes. Mettre la signalétique à hauteur du regard des enfants, à 1 mètre 20, comme l'a fait la ville de Bâle en Suisse. Piétoniser les zones autour des lieux qui accueillent des enfants et multiplier les rues scolaires. Végétaliser les cours de récré. Rendre les transports en commun plus accessibles, avec des ascenseurs et des portiques adaptés à leur petite taille. À Clermont-Ferrand, ils ont même associé chaque arrêt de tramway à un animal. Pas besoin de savoir lire pour se déplacer. Rendre la ville plus ludique, en mettant des instruments ou des malles de jeux en libre service dans les rues. Permettre que les enfants dessinent sur certains murs et trottoirs. Augmenter la durée des feux piéton pour laisser le temps au plus lent de traverser. Ouvrir les cours d'école et les stades, les soirs et les weekends, comme en Suède. Mais on pourrait aussi rajouter la gratuité des transports jusqu'à 18 ans, comme c'est le cas à Lille, et l'aménagement de rames dédiés aux jeux des enfants dans les trains, comme ça existe en Suisse, en Finlande ou au Japon, où on peut voir des wagons avec des toboggans, des piscines à boules ou des bibliothèques. Il y a des choses à faire, mais comme toujours, il faut une volonté politique forte. Et justement, pour prendre en compte les besoins des enfants, est-ce qu'il ne faudrait pas les faire participer aux décisions politiques ? Dans l'épisode 6, on entendra des enfants engagés, ni résignés, ni blasés. S'il y a bien des personnes qui peuvent nous aider à changer le monde, ce sont les enfants.
Voix de garçon : C'est un espèce de paradoxe hyper violent. Tous ces préjugés là de jeunes qui veulent rien faire et dès que tu commences à vouloir faire des trucs on te met des bâtons dans les roues.
Voix-off : Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.
Voix de fille (chante) : Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis mais sur le biceps il avait un tatouage avec un coeur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur, on lisait "Maman je t'aime". Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou
On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout, sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
Épisode 6 : "De quoi tu te plains?"
Trop jeunes, trop naïfs, pas sérieux, incompétents : les enfants et les adolescents sont souvent perçus comme incapables de s’engager en politique. Pourtant, partout, des jeunes personnes manifestent, débattent, s’organisent. Mais leurs idées sont souvent balayées, comme si leur parole n’avait pas de valeur.
Dans ce dernier épisode, Lolita Rivé enquête sur la place des enfants dans la vie politique. Elle rencontre des lycéens engagés, suit les débats d’un conseil municipal d’enfants, et revient sur les figures emblématiques qui ont bouleversé le débat public. Comment la société organise-t-elle l’incapacité politique des enfants ? Et si on pouvait voter dès l’enfance?
Lolita Rivé trace des pistes pour construire une société « enfantiste » qui écoute les plus jeunes, qui respecte pleinement leurs droits, et où les adultes acceptent d’abandonner une partie de leur pouvoir pour inventer un monde plus juste et moins violent.
Qui C'est Qui Commande ? Episode 6
Jeune femme : Dans les préjugés, je dirais qu'il y a cette idée de l'adolescent fainéant, avachi sur son lit avec son téléphone qui scrolle TikTok toute la journée, qui répond pas, qui parle dans sa barbe, enfin ce genre de choses.
Présentatrice TV : La jeunesse mondiale se lève pour le climat. Manifestatio planétaire initiée par Greta Thunberg...
Jeune femme : Il y a un peu cette image d'une jeunesse pas active, des jeunes qui s'en fichent de tout, et le débat est vraiment coupé de manière générationnellement.
Présentatrice TV : Le mouvement est parti tôt ce matin des lycées professionnels de Poitiers. Le cortège a entamé le tour des établissements pour grossir au fil des heures. La plupart se sentent concernés par le projet de réforme des retraites.
Jeune homme : On se dit, c'est des jeunes, ils sont cons. Moi je suis vieux, ça fait 60 ans, je suis sur cette planète, je sais comment ça se passe. Eux ils ont 14, 15 ans, 16, machin des années. Enfin ils sont jeunes, ils savent rien à la vie.
Présentatrice TV : Une semaine après les résultats du premier tour, les lycéens et les étudiants ont donc repris les cours à Paris et dès cet après-midi ils organisaient une grande manifestation.
Lolita Rivé : On les dit incompétents, incapables, superficiels. Pourtant, les enfants et les adolescents s'expriment, s'opposent et s'engagent.
Jeune homme : On a eu beaucoup de moqueries sur juste nos actions en général, sur le fait que c'était débile de faire ça, qu'on devrait bien sûr aller à l'école forcément, et que ça sert à rien vraiment de faire des actions comme ça, ça va rien changer en fait, qu'on est impuissant, qu'en plus on est des enfants donc on est encore plus impuissant.
Lolita Rivé : La Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 12.
Speaker 8 : Dit que « que les enfants sont capables de discernement, ont le droit d'exprimer librement leur opinion sur les questions qui les concernent et que leur avis doit être pris en compte ».
Lolita Rivé : Mais à partir de quel âge, et sur quel genre de sujet, et par quels moyens peuvent-ils donner leur avis ?
Jeune homme : Moi je pense qu'on ne nous prend pas assez au sérieux, qu'on ne nous considère pas responsables et pas matures, comme si on était insignifiants quoi, et que nous on devait juste suivre le mouvement et attendre que notre tour arrive entre guillemets quoi.
Lolita Rivé : J'ai rencontré des enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui s'engagent pour une cause et qui refusent d'être mis sur la touche. Les enfants et les jeunes ne veulent plus attendre leur tour. Ils veulent qu'on les écoute maintenant.
Jeune homme : C'est un espèce de paradoxe qui est hyper violent. En fait, tous ces préjugés-là de jeunes qui veulent rien faire et dès que tu commences à vouloir faire des trucs, on te met des bâtons dans les roues à mort et tu te dis pourquoi vous venez de me dire que je fais rien ?
Voix off : Ça donnerait quoi un monde où les plus jeunes participent à la vie politique ? Qui c’est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivé sur les enfants et leurs droits. Episode 6 De quoi tu te plains ?
Voix d’homme : Bonjour jeune conseiller ! De quelle école tu viens, toi ?
Voix de garçon : Simone Signoret
Voix d’homme : Simone Signoret ! Bonjour Madame la conseillère.
Lolita Rivé : Ce mercredi d'avril, sur le perron de la mairie du 8e arrondissement de Lyon, le maire Olivier Berzane salue de jeunes collègues.
Lolita Rivé : « Vous portez quoi là autour de l'épaule ? »
Garçon : Une écharpe tricolore parce qu'on a été élue au CAE, conseil d'arrondissement des enfants. On a été élus par notre classe et du coup, parfois, des mercredis, on vient à la mairie pour faire le conseil.
Lolita Rivé : C'est jour de conseil pour la vingtaine d'enfants élus du conseil d'arrondissement. Chaque groupe d'enfants porte un projet qu'ils ont choisi en début d'année après avoir sondé toute l'école. Lyon fait partie des quelques villes qui ont fait le choix de faire participer les enfants à la politique locale.
Olivier Berzane : Est-ce que vos projets avancent bien ?
Fille : Nous, c'est réaménager notre salle informatique parce que là, ça ne va plus du tout, les ordinateurs, ils ne fonctionnent vraiment pas, c'est très tôt de les remplacer.
Garçon : Nous, c'est la propreté dans l'école et le quartier de Lyon.
Fille : Nous, on a avancé sur le projet du stade qu’on voudrait ouvrir aux gens les jours où il n'y a pas d'école.
Fille : Nous, dans notre école, on a fait un coin calme. On veut un coin calme parce qu'il y a des enfants qui, pendant la récréation, ne veulent pas jouer et ne veulent pas de bruit, ils veulent juste se reposer.
Olivier Berzane : Un grand merci à vous, bonne séance de travail et puis on se revoit très bientôt pour présenter tout ça au conseil d'arrondissement avec les élus adultes. D'accord ? Bonne matinée les enfants, merci à vous, vous pouvez vous applaudir.
Lolita Rivé : Les jeunes élus sont accompagnés par les Enfants s'organisent, une association lyonnaise qui forme enfants et adultes.
Femme : Si vous regardez bien les petits points noirs là, il y a un point qui revient à chaque étape.
Enfant : L'action collective ?
Femme : Oui, exactement. L'action collective à l'interpellation, pour but de collectivement, on montre qu'on a vraiment envie de se faire entendre. Donc ça peut être une manifestation, ça peut être aller directement à la mairie, ça peut faire des pancartes et dire qu'on a envie que ça change, etc. Ça c'est une action dans le but d'essayer de faire entendre notre voix.
Lolita Rivé : Depuis le début de l'année scolaire, ces enfants apprennent la démocratie d'interpellation.
Solène Compingt : La démocratie d'interpellation, c'est l'idée que des citoyens, à leur initiative, interpellent, c'est-à-dire vont demander des comptes ou des changements de fonctionnement ou des améliorations de politique publique qui les concernent. Solène Compingt a co-fondé l'association Les Enfants s'organisent. À la différence de la démocratie représentative où on élit des personnes à qui on délègue un pouvoir. À l'origine, en tout cas, ça a été l'idée de prendre les méthodes d'organisation syndicale des entreprises et de les sortir de l'entreprise, du rapport entre ouvriers et patrons. Et de les mettre au service d'habitants, de citoyens qui habitaient dans des quartiers défavorisés pour qu'ils s'organisent pour revendiquer des améliorations de leurs conditions de vie auprès des institutions publiques et privées.
Lolita Rivé : L'association forme des enfants dans les écoles, les associations, ou comme ici, au conseil d'arrondissement. Parmi tous ces enfants, il y a...
Enfants : Victoria. Aris. Olivier. Lina. Oliver. Bonjour, moi je m'appelle Kamil.
Lolita Rivé : Ce sont les élus de l'école Simone Signoret, ceux qui veulent remplacer leurs ordinateurs préhistoriques. Leur objectif, c'est de rencontrer la responsable informatique de la ville de Lyon, pour la convaincre de soutenir leur projet.
Femme : La prochaine étape, c'est quoi ? C'est la rencontre ?
Enfant : On va lui envoyer la lettre et après elle nous dit si on peut venir et après on va avoir Axèle Camus. On va lui dire qu'elle nous aide à appeler des pros comme elle pour rénover notre salle informatique. Mais bon, soyons optimistes et espérons qu'elle va dire oui.
Lolita Rivé : L'objectif de l'association Les Enfants s'organisent, c'est déjà de faire entendre ce que les enfants ont à dire. Pas seulement en les consultant, comme c'est souvent le cas, mais en les rendant acteurs et actrices du changement qu'ils veulent voir.
Solène Compingt : Effectivement la façon dont on considère les enfants dans notre société les rend complètement incompétents au niveau de leur action citoyenne et politique. Nous on le voit sur des groupes d'enfants et notamment de classes défavorisées socialement, c'est des enfants qui n'ont jamais été habitués à ce qu'on leur demande leur avis. Et donc quand pour la première fois on leur dit mais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez qui va, qui va pas, injuste, qui vous met en colère. Dans votre école, dans votre quartier, il y a beaucoup d'enfants, au départ, qui ne savent pas du tout quoi dire, en fait, parce qu'on ne l'aura jamais demandé. La façon dont on traite les enfants, dont on déconsidère la parole, dont on laisse très peu de place, fait que ces enfants, en fait, ne sont pas du tout entraînés à savoir ce qu'ils veulent, à donner leur avis, à s'exprimer, à argumenter.
Lolita Rivé : Peut-être qu'apprendre concrètement la démocratie dès le plus jeune âge, ça nous aiderait à nous sentir davantage concernés par ce qui se passe autour de nous et dans notre pays. Il est vrai que les jeunes ne votent pas beaucoup en France. Pour le second tour des législatives 2022, 72% des moins de 30 ans ne sont pas allés voter. Mais l'abstention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique ou au débat social.
Jeune femme : En politique, on nous dit, allez voter. Finalement, quand on regarde, quand il y a un président par exemple qui gagne, c'est les deux tiers de la France qui n'en voulaient pas.
Lolita Rivé : Au Conseil Communal des Jeunes, d'ici les Moulineaux, près de Paris, des adolescents m'ont raconté leur envie de s'engager, mais aussi leur frustration à se sentir mis sur le banc.
Jeune femme : Juste à l'échelle du lycée, j'ai testé l'année dernière, j'ai été déléguée, j'ai été très déçue. Parce que, en fait, c'est pas de la participation, c'est de la consultation, en fait. Donc, on arrive, on pense qu'on va avoir un poids dans le conseil de classe, ou je sais pas, ou pouvoir mettre des choses en place. Et en fait, tout est déjà rédigé. C'est juste une approbation des autres professeurs, éventuellement, une discussion, un mini-détail, une virgule qui va changer. Mais finalement, que le jeune soit là ou pas, il n'y a rien qui va changer.
Lolita Rivé : Si les jeunes se détournent de la politique, c'est pas tout simplement parce qu'on ne les implique pas.
Éric Delemar : Les enfants sont totalement sous le joug des adultes et n'ont aucun pouvoir au fond.
Lolita Rivé : Éric Delemar, défenseur des enfants.
Éric Delemar : On les consulte de façon très disparate sur le territoire. On évalue à peu près 2000 communes qui ont des conseils municipaux d'enfants. Dans certains, ils ont un budget, ils ont des projets, ils sont accompagnés. Voilà, dans d'autres, c'est loin d'être le cas, dans d'autres, il n'y en a pas du tout et c'est vraiment pas une priorité. C'est pour ça qu'avec la Défenseure des droits, nous n'arrêtons pas de dire, mais c'est un enjeu pour nos démocraties, pour nos civilisations. D'écouter la parole des enfants, c'est la première manifestation de violences, de ne pas écouter les enfants. Donc il faut pas attendre de leur dire « tiens, pourquoi à 18 ans tu ne votes pas ? » Bah ouais, mais enfin ça fait 18 ans que vous ne me demandez pas mon avis. Donc peut-être que là, il faut aussi, de manière démocratique, écouter, prendre le temps d'écouter la parole des enfants.
Lolita Rivé : Pourtant, historiquement, les enfants se sont déjà organisés politiquement. Dans son livre La domination adulte, Yves Bonnardel répertorie quelques luttes d'enfants qui ont eu lieu en Europe. Comme la grève des écoliers anglais de 1911, où pendant 15 jours, des milliers d'enfants ont refusé d'aller à l'école et ont réclamé des cours moins longs, des vacances pour ramasser les pommes de terre, des crayons gratuits et l'abolition de la ceinture. Ou encore le Jugendbewegung, un mouvement de jeunesse très puissant en Allemagne au début du XXe siècle. Il regroupe plusieurs centaines de milliers de jeunes qui rejettent l'Etat, la famille et l'école. Le mouvement sera interdit par le nazisme. Plus récemment, les sociologues Stéphane Beaud et Michel Pialoux ont même analysé les révoltes urbaines non pas comme une violence gratuite des jeunes de banlieue, mais comme une réponse politique au sentiment d'injustice et d'exclusion de ces jeunes. Alors pourquoi tous ces mouvements de la jeunesse ne sont pas pris au sérieux ?
Abel Jeudon : Ca ne sert à rien d'acheter des ceintures en peau de bois, on peut avoir des vrais bois vivants quoi.
Lolita Rivé : À Étampes, dans le sud de Paris, Abel Jeudon enroule un boa autour de sa taille.
Abel Jeudon : Après je sais pas, madame boa elle mange bien. Ah ouais ? Si elle mange bien, je te jure.
Lolita Rivé : Autour de lui, des dizaines de serpents, grenouilles, lézards, tortues. J'ai essayé d'enregistrer, mais ils ne font pas de bruit malheureusement. Abel n'a que 19 ans, mais ça fait un moment qu'il dirige l'association S.O.S. P'tite Bête. Il l'a créé quand il avait seulement 12 ans.
Abel Jeudon : Donc j'ai commencé l'engagement parce que j'avais envie de faire quelque chose pour les animaux. C'était quand même ça le sujet principal qui m'intéressait. Et donc j'ai été bénévole à la SPA. Dix ans et demi, je suis devenu bénévole là-bas. Je me suis rapidement rendu compte qu'en fait il n'y avait rien qui existait, ou quasiment rien, qui existait pour les reptiles. L'objectif de l'assaut, à la base, c'est surtout de sauver des animaux. Des animaux dont peu de gens s'occupent. Dont la plupart des gens s'en fichent ou voire même en ont peur ou les détestent.
Jeune femme : Faites attention, ça mort.
Lolita Rivé : Ah bon ? Elle a des dents ?
Jeune femme : C'est un bec. Mais c'est carnivore en fait.
Lolita Rivé : A 12 ans, Abel ne peut pas ouvrir de compte en banque. Alors le réseau national des Junior Associations va l'aider à se lancer. Dans le sous-sol de chez son père, il se met à recueillir des reptiles abandonnés par leur propriétaire. Il les soigne avant de leur trouver une nouvelle famille. Au collège, il organise même des ateliers de sensibilisation dans d'autres écoles pendant sa pause déjeuner. Mais il a du mal à conjuguer les cours avec son engagement et il ne se sent pas soutenu par ses profs.
Abel Jeudon : C'est un espèce de paradoxe hyper violent. En fait, tous ces préjugés-là de jeunes qui veulent rien faire et dès que tu commences à vouloir faire des trucs, on te met des bâtons dans les roues, mais à mort, et tu te dis pourquoi vous venez de me dire que je fais rien ? C'est extrêmement étrange. Il faut faire, mais pas trop, parce que si tu fais trop, tu commences à déranger, tu commences à prendre la place des adultes aussi. Faut pas non plus trop t'imposer, faut pas non plus avoir des idées trop radicales. Et donc ouais, il y a des limites et en fait la fenêtre elle est minuscule.
Jeune femme : Je change le dernier aquarium et je vide celui des cryptos et après je pense qu'on aura fini.
Lolita Rivé : Abel est maintenant le président du Réseau National des Juniors Associations. Il aide d'autres enfants à lancer leur projet.
Abel Jeudon : C'est pas assez considéré, la parole des enfants, et à tort, parce qu'il y a tellement d'idées de ouf. En rentrant dans un peu cet univers-là de l'engagement des jeunes, j'ai rencontré des centaines de jeunes qui m'ont tous bluffé, et qui m'ont tellement plus appris qu'énormément de profs, qu'énormément d'adultes qui avaient cette posture de prétendue sachant. En fait, en laissant du temps, je pense que tous les enfants pourraient apprendre tellement de choses qu'il n'y aurait même pas besoin que ce temps-là soit rattrapé, ce temps-là de courant moins. Rattraper et moi j'ai vraiment vu la différence qu'en 6e ma moyenne devait être à 13 ou 14 et et en 5e j'ai créé mon assaut et j'étais à 17 de moyenne toute l'année et c'est pas parce que j'ai plus révisé ou quoi c'est juste parce qu'en fait je m'épanouissais à côté et que juste ça, ça m'enrichissait tellement, ça déjà me rendait joyeux. Et du coup, c'était plus simple de faire le reste, de réviser tout ça, et je savais aussi que quand j'aurai fini de réviser, je pourrais aller m'occuper de mes animaux, donc ça me motivait.
Jeune femme : C'est pas les mêmes, les deux-là ? Ça, c'est une péloméduza. Ça, c'est une émyde à cou rayé. Et ici, c'est une pelusio. Donc, c'est les trois espèces d'aquatiques qu'on a en ce moment.
Solène Compingt : Pourquoi c'est important d'écouter les enfants ? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une expertise d'usage. Les enfants, ils usent la ville. Je veux dire, ils utilisent les transports, ils utilisent leur école, leur cours d'école, leur quartier, leur square. Je veux dire, ils ont un vécu. Ce n'est pas des fantômes qui passent à travers la vie et qui réalisent que la vie existe à 18 ans. Donc ces enfants, ils ont des choses à dire sur ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. À partir du moment où on ne prend pas en compte une partie de la population qui est impactée par une décision, nécessairement, et ça c'est ce que montrent toutes les études sur l'intelligence collective, la décision sera moins intelligente, moins respectée, moins adaptée.
Jeune femme : Ah, il y a Romeo et Juliette qui n'ont pas été remises dans leur....
Abel : Il a mangé du coup le basilic au final ?
Jeune femme : Euh, je ne pense pas.
Lolita Rivé : Son engagement précoce donne envie à Abel de rejoindre d'autres luttes. À 16 ans, il s'engage pour le climat, avec Youth for Climate, ce mouvement mondial de la jeunesse écologiste et anticapitaliste inspiré par Greta Thunberg.
Greta Thunberg (extrait interview TV) : My name is Greta Thunberg, I am 15 years old and I live in Sweden. I school strike outside the swedish parliament house until the swedish listen.
Lolita Rivé : C'est en 2018 que le monde entier découvre la jeune suédoise. Elle a 15 ans et débute une grève scolaire pour le climat devant le Parlement suédois. Seule avec sa pancarte. Le mouvement mondial Friday for Future s'étend dans le monde entier avec ce mot d'ordre : à quoi ça sert d'aller en cours si on n'a pas d'avenir ?
Voix TV : The 16 year old Greta Thunberg. Greta Thunberg. Greta Thunberg…
Voix TV : On peut dire qu'il y a eu aujourd'hui un effet Greta. Oui. Elle avait beaucoup d'attention.
Lolita Rivé : Poussés par la détermination de Greta Thunberg, des enfants organisent des grèves et des marches pour le climat dans le monde entier. On parle même aujourd'hui d'éco-anxiété pour exprimer ce sentiment démocratisé par la jeune activiste. Il toucherait un jeune sur deux.
Laelia Benoît : Donc l'éco-anxiété, l'anxiété climatique, c'est l'ensemble des réactions émotionnelles liées à la destruction climatique et au changement environnemental.
Lolita Rivé : Laelia Benoît, pédopsychiatre et autrice d'infantisme, parue chez Seuil en 2023.
Laelia Benoît : Engendrer des émotions d'anxiété, comme dans le mot, mais tout un tas d'autres émotions aussi, comme la colère, l'indignation, la honte, la culpabilité, la tristesse, et aussi des émotions plus positives qui donnent envie d'agir, comme l'espoir ou l'élan. Donc des médecins, psychiatres, mais aussi des psychologues ont explicité que les causes d'anxiété n'est pas un problème individuel, il ne faut pas pointer du doigt les personnes en disant Ah tu as une fragilité ? S'agit de prendre conscience que les personnes sont éco-anxieuses parce que le changement climatique est un problème réel et grave et qu'elles ont une réaction émotionnelle qui est saine, légitime et adaptée vis-à-vis de la gravité de la situation.
Greta Thunberg : This is all wrong. I shouldn’t be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!
Lolita Rivé : En 2019, Greta Thunberg interpelle l'Assemblée des Nations unies et dénonce l'inaction des dirigeants. Très critiquée, notamment par des chefs d'État, Greta reçoit le traitement que les jeunes qui s'engagent subissent très souvent.
Laelia Benoît : Greta Thunberg a été énormément attaquée avec des arguments infantistes. Donc, elle est trop petite, elle est trop jeune, elle sait pas ce qu'elle dit, elle est nécessairement manipulée, qu'elle pouvait pas avoir de libre arbitre, qu'elle était la marionnette de ses parents, des adultes autour d'elle. Les jeunes en particulier, ils ont beau prendre la parole, sortir dans la rue, manifester, exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis de la situation, demander des actions. En fait, ce qui leur est renvoyé, c'est « sois jeune et tais-toi ». Et ça, c'est sous-tendu par les préjugés de discrimination contre les enfants et adolescents. Parce qu'en fait, on est tellement obnubilé par le fait que les enfants et adolescents seraient des citoyens de seconde catégorie, que quand ils sont dans la rue pour manifester et pour exprimer leur voix sur un sujet, au lieu de les écouter, on s'étonne qu'ils soient dans la rue, on s'étonne qu'ils manifestent, on s'étonne qu'ils ratent l'école. Et donc, on parle du fait que des enfants sont dans la rue. Au lieu de parler de la raison.
Lolita Rivé : Lesquels ils sont dans la rue. Lorsqu'il rejoint le mouvement Youth for Climate, à 16 ans, Abel Jeudon, le sauveur de reptiles, participe à des actions de désobéissance civile. Il décroche des publicités dans la rue en ciblant de grands industriels.
Abel Jeudon : On passait vraiment pour les enfants qui font un peu des petites grèves comme ça, et c'est mignon quoi. La première fois où je me suis fait arrêter, où vraiment on a eu beaucoup de moqueries sur juste nos actions en général, sur le fait que c'était débil de faire ça, qu'on devrait bien sûr aller à l'école forcément, et que ça sert à rien de faire des actions comme ça dans les pubs, ça va rien changer en fait. On est impuissants, et en plus on est des enfants, donc on est encore plus impuissants.
Lolita Rivé : Les jeunes activistes décident d'adopter d'autres moyens d'action. Ils vont même jusqu'à s'introduire dans des entreprises pour dénoncer la destruction de l'environnement.
Abel Jeudon : Et du coup, la répression s’est durcie. On a été interpellés assez violemment. Enfin, j'ai eu des amis qui ont eu des interpellations vraiment violentes avec notamment des étranglements de plusieurs minutes et des trucs assez violents. Ouais, il y a eu un gros changement et où c'était assez choquant de voir comment des adultes pouvaient traiter des enfants de cette manière-là.
Lolita Rivé : Au défenseur des droits, Éric de Delemar reçoit des réclamations de jeunes militants dont les droits n'ont pas été respectés.
Eric Delemar : Ne pas considérer les enfants comme des interlocuteurs dignes d'avoir quelque chose à dire sur le climat, c'est exactement déconsidérer les deux. Les enfants nous l'ont dit, eh bien nous, on est comme la planète, on nous dit qu'on est l'avenir de l'humanité mais nos droits n'avancent pas vite et on nous, nous n'entend pas, on n'entend pas la planète et on n'entend pas la jeunesse. La jeunesse, elle a quelque chose à dire et s'il doit y avoir un mouvement international au monde, c'est la préservation de notre planète. Et nous, on a des instructions par exemple où des jeunes ont manifesté pacifiquement. Contre cette dégradation de l'environnement et se sont fait malmener parfois par les forces de l'ordre alors qu'au fond ils viennent pacifiquement se battre contre la chose la plus chère au fond à leurs yeux et à nos yeux qu'est l'environnement et l'avenir de notre humanité.
Voix indistinctes
Lolita Rivé : L'éco-anxiété et l'inquiétude face au changement climatique, c'est plus seulement une préoccupation de privilégiés. Dans les banlieues aussi, les jeunes s'organisent.
Féris Barkat : Alors nous on va aborder le sujet du gaz à effet de serre, qui peut me dire la phrase s'il vous plaît ?
Lolita Rivé : Banlieue Climat, une organisation co-fondée en 2023 par Féris Barkat, forme chaque année des centaines de jeunes des quartiers populaires aux questions environnementales.
Féris Barkat : Je te laisse expliquer ?
Jeune homme : En fait, la Terre elle tourne autour du soleil, elle capte son rayonnement et ce gaz à effet de serre justement il fait en sorte que le rayon du soleil reste dans l'atmosphère.
Lolita Rivé : Cette semaine, une vingtaine de jeunes de Montpellier, Strasbourg, Trappes ou encore Villeurbanne sont accueillis à l'école du climat à Saint-Ouen, le siège de l'association.
Jeune homme : Les gaz à effet de serre, les plus communs comme vous le connaissez tous, il y a le CO2, tout le monde sait ce que c'est le CO2 à peu près.
Lolita Rivé : Le groupe rencontre des chercheurs, des chercheuses et apprend à expliquer les causes du changement climatique pour transmettre à leur tour.
Jeune homme : Donc selon vous, qui produit le plus de gaz à effet de serre ?
Voix : Les entreprises ? Les voitures ?...
Lolita Rivé : Pour certains, c'est la première rencontre avec les enjeux climatiques mais aussi avec la politique.
Féris Barkat : Comme je vous ai dit, l'écologie, on en entend parler tard. Pour nous, ça ne nous concerne pas. On voit des ministres, des personnalités publiques qui s'expriment là-dessus, mais nous, on ne se sent pas concernés.
Jeune homme : Je pensais que c'était aux « hauts placés » de s'occuper de ça. En ayant fait la formation, c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était un sujet qui nous concernait tous. Et surtout, nous les jeunes de banlieue en priorité, car il y a par exemple des usines qui sont construites pas loin de nos quartiers, et du coup, les déchets qui rejettent, ça impacte nos familles.
Lolita Rivé : La formation est reconnue par l'État, elle a été créée avec des chercheurs du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Elle a même donné envie à certains jeunes de changer de plan de vie, comme Sophia.
Sophia : Au début, je voulais faire un master soit commerce, soit marketing. Et donc, bon, ce sont des masters qui sont très intéressants, etc. Mais à un moment, je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai envie de grandir en participant à un schéma qui ne me plaît pas ? Donc, je ne veux pas participer à cette société de surconsommation et au capitalisme. Et donc, actuellement, j'ai pris le choix de m'orienter vers un master relation internationale qui va me permettre de travailler pour des ONG. Dans la diplomatie, je peux travailler aussi dans des associations. Forcément, le salaire chargé de mission humanitaire et le salaire d'un commercial, malheureusement, c'est pas le même. Et donc, à ce moment-là, j'ai quand même fait le choix de mettre mes valeurs en priorité.
Jeune homme : C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon !
Lolita Rivé : Même s'ils ont envie d'agir, la plupart des jeunes se sentent complètement abandonnés par les adultes.
Sophia : On a l'impression que le sujet est totalement délaissé par les autres générations et que les autres générations nous disent seulement « en fait, c'est votre sujet, vous vous en occupez » alors que c'est un problème qui concerne absolument tout le monde. Enfin, souvent, on dit, nous, on est la génération climat, la génération qui va faire bouger les choses, etc. Mais le problème, c'est que le fait d'utiliser ce genre d'expression, selon moi, ça met totalement à l'écart les autres générations. Donc, les autres générations vont se conforter dans l'idée que, en fait, c'est plus notre problème, parce que dans 30 ans, 40 ans, on ne sera plus là. Et donc, oui, moi, parfois, je me sens un petit peu... Peut-être un peu frustrée. On peut se sentir impuissant. Face à ça, et on se dit en fait, si les politiques environnementales ne mettent pas l'argent nécessaire pour changer les choses, pour faire en sorte que les entreprises limitent par exemple leurs émissions de CO2 que ça, au final, nous, quelle est notre place dedans ?
Lolita Rivé : Sensibiliser les enfants d'aujourd'hui aux questions environnementales, c'est indispensable. Mais si on le fait sans leur donner les clés pour agir, le pouvoir de changer eux-mêmes les choses, ça revient à les condamner à l'impuissance. Et ce travail, il ne peut pas incomber seulement à quelques associations, syndicats et collectifs qui se mobilisent sur le terrain.
Solène Compingt : On n'apprend à aucun moment à s'organiser collectivement quand on estime qu'on vit des injustices sociales par exemple ou que notre parole n'est pas prise en compte. Et donc du jour en lendemain à 18 ans, on se retrouve à devoir voter et c'est le seul acte politique et le premier acte politique qu'on nous demande et on est bien démuni en général. Tout comme un adulte, souvent pour la première fois, à 25 ans, à 35 ans, on va se retrouver face à un employeur. Qui a des pratiques illégales ou dégradantes face à un bailleur social qui ne prend pas du tout en compte ses besoins d'amélioration de son logement. Et ces adultes-là sont complètement démunis et se trouvent seuls et impuissants face à des choses qu'ils estiment injustes et écrasantes pour eux parce qu'ils n'ont jamais été éduqués, ils n'ont jamais appris ce que c'est que l'organisation collective. Et le fait de pouvoir défendre ses droits et se faire entendre malgré le statut social qu'on a dans une société.
Lecture – voix de femme : L'urne est en hauteur, volumineuse, anguleuse. Et avant que la petite trappe en plastique ne bascule, il faut patienter le bulletin en position. Un nombre pénible de secondes. Du moins quand on tient à bout de bras un enfant de 4 ans qui veut absolument l'y glisser pour nous. Combien de lumbagos, à chaque élection, chez les parents soucieux d'encourager l'esprit civique de leur enfant en lui octroyant ce geste symbolique ? On en profitera pour prendre une photo. C'est trop mignon, un enfant qui joue à voter. Il y a un décalage humoristique. Le visage du petit faux électeur est si sérieux. Les adultes le contemplent avec tendresse. Illusion comique. J'espère que tu avais bien lu tous les programmes avant de décider. Clin d'œil complice. Et toi Jean-Michel, tu les avais bien lu tous les programmes ? Ne répond personne. Le jeu est terminé. L'enfant touche à nouveau le sol, retourne au monde réel. Le monde réel solide, stable, raisonnable. Celui où les enfants ne votent pas. Clémentine Beauvais, Pour le droit de vote dès la naissance (Tracts Gallimard)
Lolita Rivé : Dans son essai, pour le droit de vote dès la naissance, la professeure en sciences de l'éducation, Clémentine Beauvais, s'étonne qu'on parle de suffrage universel alors que 20% de la population en est exclue. Si l'idée de donner le droit de vote aux enfants, lancée par l'américain John Wall en 2021, l'a d'abord fait rire, la chercheuse raconte pourquoi ce serait pour elle une obligation morale et démocratique de laisser voter les enfants dès qu'ils s'en sentent capables. Parce que cette non-participation des mineurs au processus démocratique a des conséquences profondes. L'abstention massive des jeunes aux élections, comme on l'a dit, mais aussi un manque de confiance dans la démocratie. Un élève de Terminal sur 4 dit n'avoir aucune confiance dans le système démocratique. Cette question du droit de vote des enfants doit devenir un débat de société.
Laelia Benoît : Si les enfants deviennent un électorat, il y aura un certain nombre de conséquences dans les discours qui sont tenus vis-à-vis d'eux. Il pourra certainement y avoir des discours d'hémagogues, en simplifiant les choses à l'extrême pour essayer de faire passer des idées qui sont fausses, mais il y aura aussi un effort d'explicitation, de simplification du langage qui est bienvenu. Ce que ça va imposer aussi, c'est un rôle réel pour l'école, d'enseignement, de la politique. Pour que les enfants puissent être informés, puissent apprendre à questionner les discours qui sont faits, puissent apprendre à demander quelles sont les données derrière, quel est votre budget pour arriver à mettre en place cette idée, quelles sont les propositions alternatives.
Enfants : C'est ton idée, hein, les enfants nationaux ! Ok, les enfants ? Eh ben, je suis plus d'accord ! On va commencer ?
Lolita Rivé : Retour à Lyon, où Lina, Oliver, Victoria, Aris, Olivier et Kamil se préparent pour un rendez-vous important.
Voix de femme : Vous aviez envoyé un mail il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez du mail que vous avez envoyé ? Vous l'avez envoyé à une dame qui s'appelle Mme Camus ?
Enfants : Oui, Axèle Camus.
Voix de femme : Axèle Camus ? Et donc c'était l'élue qui se charge de la salle informatique. Mais elle a répondu en disant que ce n'est pas à elle de se déplacer. Vous devez d'abord voir ça avec la responsable de secteur, Mme Grand.
Lolita Rivé : Comme le protocole l'exige, c'est la responsable de secteur de la mairie qui vient à leur rencontre dans leur école.
Géraldine Grand : Bonjour ! Madame Grand, Géraldine Grand.
Enfant : Bonjour, nous sommes les délégués du CAE de l'école Simone Signoret. Le problème, notre salle informatique dysfonctionne et nous sommes pénalisés dans l'application des programmes et de la maîtrise de l'outil informatique alors que cela devrait faire partie de notre quotidien.
Enfant : Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une formation d'informaticiennes ?
Géraldine Grand : Bien sûr, je ne peux pas être experte dans tous les sujets que je vous ai cités. C'est pour ça que je vous ai bien dit, je fais le lien entre le terrain, donc l'école, et les services compétents.
Enfant : Vraiment je sais que c'est un petit peu pénible, mais il faut aussi pas oublier le budget.
Géraldine Grand : La ville de Lyon, actuellement, elle est très consciente que le parc informatique dans toutes les écoles, il est obsolète. Remplacer tous les ordinateurs, c'est évidemment un budget énorme. Mais il y a une option, ce ne sont pas des ordinateurs fixes sur des tables, mais ce sont des tablettes. Concernant les délais, je ne vais pas vous dire à 100%, mais je pense que pour la rentrée, c'est envisageable, la rentrée scolaire.
Enfant : Merci d'avoir répondu à nos questions. On est contents qu'il y ait des solutions.
Enfant : Merci beaucoup !
Lolita Rivé : Aujourd'hui, les jeunes élus ont été entendus. Des victoires comme celle-là, Solène Compingt en a vu beaucoup.
Solène Compingt : Une victoire qui m'a marquée, c'est des enfants qui n'étaient pas contents sur ce qu'ils mangeaient à la cantine. Ils trouvaient qu'en gros c'était dégueulasse ce qu'ils mangeaient à la cantine et ils avaient envie d'avoir plus leurs mots à dire. Et il y a toute une campagne qui s'est menée autour de cette thématique-là. Un des aboutissements de cette campagne-là, ça a été que la commission menu de la ville de Lyon, qui est composée d'agents publics, d'une diététicienne et de parents délégués, Et cette instance-là, maintenant, comporte des enfants qui peuvent y siéger, qui goûtent ce qu'ils vont manger et qui ont un mot à dire sur les menus qu'il leur est proposé.
Lolita Rivé : Remporter une victoire, aussi petite soit-elle, avoir fait déplacer des élus ou des responsables adultes, avoir obtenu gain de cause, ça donne des armes aux enfants. Voir des envies d'aller plus loin.
Enfant : Je voudrais être politicienne en fait. Avant j'avais pas cette idée en tête mais quand en fait j'ai commencé à faire CAE, j'ai trouvé que c'était bien qu'en aidant les autres et en m'aidant moi aussi moi-même, je trouve que c'est cool.
Enfant : Au début, je ne pensais pas faire de la politique, mais moi aussi, j'ai envie de faire de la politique et oui, je veux bien continuer à m'engager. Du coup, par exemple, si on voudrait vraiment faire ce qu'on veut, c'est qu'on aurait pour chaque année une moyenne de budget. On devrait tout le temps avoir ça. Comme ça, on sait ce qu'on peut faire. Il ne faut pas que ça change suivant le maire qui est élu. Il y en a un qui nous donne quasi rien et l'autre beaucoup. Il vaut mieux qu'ils nous donnent tous la même chose. Comme ça, on fait nos projets. Ce serait ça, avoir du pouvoir.
Solène Compingt : On tient à ce que ces enfants arrêtent d'intégrer la domination des adultes comme quelque chose de normal et qu'ils arrivent à considérer que c'est une injustice que leur parole n'est pas suffisamment prise en compte par les adultes. Et on a envie aussi qu'ils retiennent que c'est possible qu'en tout cas on apprend des tas de choses dans l'organisation collective, que même si ce qu'on demandait n'a pas tout à fait été obtenu comme on le souhaitait, on a fait bouger des lignes. On a appris des choses.
Lolita Rivé : J'ai demandé à Solène Compingt ce que ça changerait si les enfants étaient tous éduqués à la démocratie et à l'action collective.
Solèhne Compingt : Le rêve, si tous les enfants étaient éduqués et avaient l'occasion de mener des projets d'une démocratie d'interpellation, déjà ça pourrait renouveler complètement tous les corps intermédiaires dans notre société, donc les syndicats du travail, les associations qui se vident complets, qui se vieillissent, qui se vident de leur jeunesse et qui n'arrivent plus à recruter des jeunes. Je pense qu'on verrait beaucoup plus de jeunes dans les partis politiques qui eux aussi se vieillissent.
Voix de femme : Dans l'ensemble vous êtes fiers de vous ?
Enfant : Moi oui ! Ultra ultra archi-archi-infini-fière
Voix de femme : Est-ce que vous avez l'impression de vous ressortir du rendez-vous là ? Vous êtes contents, fiers de vous ?
Enfants : On est ultra contents !
Solène Compingt : Ça pourrait réparer la démocratie représentative. Il y a une crise de la démocratie représentative assez terrible où le taux de vote est en chute libre. Les gens sont complètement désabusés et ne croient plus du tout en cette démocratie représentative. Et du coup, le danger de ne plus croire à ça et de se désinvestir complètement de ces institutions publiques-là, c'est de faire venir des gouvernements autoritaires.
Voix de femme : Vous avez eu ce que vous demandez ?
Enfants : Oui, tu vois le smiley avec la bouche comme ça avec la bouche ouverte ? On en est là? Ouais ouais le meilleur truc.
Solène Compingt : Un des meilleurs moyens pour lutter contre l'écho-anxiété. Donc là, on a une jeunesse qui se prend en plein fouet la crise climatique et ça génère énormément d'angoisse et de repliements sur soi. Et d'éduquer et d'expérimenter, de s'entraîner à de l'organisation collective, ça permet de voir qu'en fait, il y a toujours eu des changements possibles par l'organisation collective et la construction de rapports de force, de rapports de pouvoir.
Lolita Rivé : Il est temps de prendre en compte les enfants dans nos décisions. Et pour ça, il y a des choses concrètes qu'on pourrait faire. Créer un Conseil national d'enfants et d'adolescents avec un vrai pouvoir législatif. Encourager des budgets locaux gérés par des enfants. Former à la participation démocratique dans toutes les écoles. Ouvrir une discussion sur l'âge du vote. Quant à la question climatique, continuer de ne pas en faire une priorité politique, c'est une violence pour les enfants qui seront les premiers à en subir les conséquences. Comme le défenseur des droits le préconise dans son rapport de 2024, il faut de toute urgence contraindre les pays et les entreprises à protéger l'environnement, prendre en compte la santé vulnérable des enfants dans les politiques publiques, leur garantir à tous un accès à une alimentation saine. Réduire la pollution de l'air et multiplier les espaces de verdure. Et bien sûr, prendre en compte la parole des enfants dans les décisions publiques qui affectent leur vie.
Lolita Rivé : Après l'écoute de ce podcast, j'aimerais vous avoir convaincus d'une chose au moins. C'est que la place des enfants est politique. Si on veut un monde moins violent, plus juste, plus libre aussi, on ne peut plus continuer de traiter les enfants comme on le fait. Il faut les remettre au centre de nos sociétés. Ça peut sembler vertigineux, mais c'est un combat essentiel et inévitable. Il est temps de lancer cette révolution culturelle, de changer de regard sur les enfants, de respecter leurs droits. Alors parlons-en autour de nous. Osons prendre clairement le parti des enfants quand ils sont injustement traités. Acceptons de questionner notre pouvoir sur eux. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Rappelons-nous de l'enfant qu'on a été. Et on va la vivre, cette révolution.
Lolita Rivé : Pour ma fille, pour mes élèves et pour tous les enfants, il est temps.
Enfant : Je suis désolée maman aussi, j'ai raconté ta vie, je sais que tu as t'fâcher, mais bon... Au revoir les fans ! Au revoir Lolita ! Mais ça va sortir en quoi ?
Lolita Rivé : Je remercie toutes les personnes qui ont accepté de m'offrir leur temps pour intervenir dans ce podcast. Merci à Jessica Bajic pour son talent, sa douceur et sa solidité à toute épreuve. Merci à Victoire Tuaillon, sans son cerveau et son cœur, encore une fois, ce projet n'aurait pas existé. Merci à Quentin Bresson d'avoir patiemment tissé chacun de ses épisodes. A Mai Lan Chapiron pour ses arpèges et sa voix mélodieuse. Merci à toute l'équipe du Défenseur des droits pour leur soutien et leur confiance et au studio Sonic pour la production. Christophe, Etienne Élodie, Louise et Mélodie. Je remercie Hazel, Charlotte et Cameron de m'avoir prêté leur voix. Ma cousine Juliette et sa famille pour leur accueil et leurs encouragements. Pour leur relecture et leurs remarques pleines de pertinence, Gabrielle Allégret, Charlotte Puiseux et Teddy Ambroise. Merci au gang du flipper de m'offrir ces choses si précieuses, le rire, la sororité et la fête. Et enfin, pour leur soutien vital, leur amour et leur présence inconditionnelle, ma famille, mes parents et mes frères, Thibaut, bien sûr, et ma merveilleuse fille.